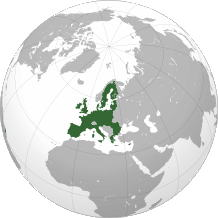Le moteur d'inférence d'Amazon vient de me recommander cet ouvrage, l'imposture économique.
Je ne sais pas s'il est bon ou pas, mais il me semble qu'il mériterait qu'on le lise.
Voici ce qu'en dit l'éditeur :
L’Imposture économique est la traduction du livre « coup de poing » de l’économiste australien Steve Keen paru sous le titre Debunking Economics. Cet ouvrage, « fondateur » pour l’économiste Gaël Giraud (qui a assuré la direction scientifique de la traduction et en signe la préface), démonte une à une les grandes pièces de l’édifice dogmatique : aucune des théories qui composent le « dur » de l'économie universitaire depuis la fin du xixe siècle ne résiste à l'analyse, depuis la micro-économie du consommateur jusqu'à la théorie néo-keynésienne de la déflation, en passant par l'efficience des marchés financiers et la théorie du capital. Et, sur les ruines de l'orthodoxie défaite, Steve Keen jette les bases solides d’une « autre économie », suggérant d’autres manières, beaucoup plus cohérentes et scientifiques, de penser l’économie.
Le livre a suscité de nombreux débats lors de sa publication en anglais : il répond aux questions que chacun se pose sur la pertinence des arguments économiques exposés depuis la crise des subprimes, et invite à engager une réforme profonde de l’enseignement et de la recherche en économie dans le monde.
et ce que dit Amazon de l'auteur :
Steve Keen est australien. Professeur d'économie et de finance, spécialiste de la modélisation macroéconomique monétaire, il est directeur du département Économie, Histoire et Politique de l'université de Kingston à Londres. Son rôle de premier plan et son travail de pionnier lui ont valu le Révère Award for Economics de la Real-World Economics Review et d'être reconnu par ses pairs comme l'économiste «qui a, le premier et le plus clairement, prévu et donné l'alerte sur l'effondrement de la finance mondiale."
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
L'imposture économique
2 messages
• Page 1 sur 1
Re: L'imposture économique
On trouvera ici un résumé intéressant du livre : http://www.regards.fr/IMG/pdf/l-9.pdf
Réformer la science économique, un pari intéressant. En tout cas, il est vrai que le principe même d'une science est de se remettre en question, et sur ce point, on est loin du compte.
Peut-être une piste d'évolution de notre société, si l'on accorde crédit au postulat d'Immanuel Wallerstein selon qui le capitalisme toucherait à sa fin. Un changement d'ère serait imminent, ou peut-être a-t-il déjà commencé d'ailleurs. Les intellectuels à la fin de la féodalité ont-ils vraiment eu conscience qu'ils entraient dans une nouvelle ère, le capitalisme? J'en doute. Dès lors, il me paraît fort probable que même si cette nouvelle ère avait déjà commencé, nous n'en aurions probablement pas conscience. L'histoire le dira à ceux qui nous suivent...
http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2008/12/16/le-capitalisme-touche-a-sa-fin_1105714_1101386.html
Peut-être allons-nous voir l'émergence d'une société et d'un monde plus collaboratif? Les multinationales comme les institutions publiques internationales n'ont-elles pas ouvert cette voie, en développant une collaboration internationale très efficace entre leurs collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui nombreux sur terre à apprécier cette manière de travailler ensemble.
En réformant la science économique (qui fige notre système économique actuel), en gardant à l'esprit que "Le seul bien, c'est celui qui permet d'obtenir pour le plus grand nombre une vie rationnelle et intelligente.", on pourrait penser que les changements majeurs à venir, et ceux qui ont déjà lieu, sont peu-être une chance pour l'humanité de prendre son destin en main.
Un retour à l'homo sapiens (Qui a le palais délicat, connaisseur ; qui a du goût, qui comprend, qui connaît. Intelligent, raisonnable, sage, sensé.), après un détour par l'homo economicus (est capable de maximiser sa satisfaction en utilisant au mieux ses ressources, sait analyser et anticiper le mieux possible la situation et les événements du monde qui l'entoure afin de prendre les décisions permettant cette maximisation)? Et pourquoi pas...
« L'imposture économique », le livre qui ébranle la pensée néolibérale
PAR DAN ISRAEL
Les économistes néoclassiques ne vivent pas dans le monde réel, mais dans un univers parallèle, basé sur des hypothèses hasardeuses et non démontrables, qui empêchent une vraie réflexion sur l'état de nos sociétés. Telles sont les conclusions ravageuses de L'Imposture économique, un livre iconoclaste de l’économiste australien Steve Keen, qui retourne contre la pensée dominante les armes de l'analyse économique la plus traditionnelle.
Le programme est énoncé sans fard et sans crainte des superlatifs dès les premières pages du livre. Il s’agit de « provoquer une révolution scientifique, attendue de longue date en économie ». Pas moins. L’auteur de cette profession de foi s’appelle Steve Keen. Cet économiste australien est aujourd’hui directeur du département Économie, Histoire et Politique de l’université de Kingston à Londres. Son livre, L'Imposture économique, qui paraît en France le 9 octobre aux éditions de l’Atelier, est paru dès 2001 pour sa première édition dans le monde anglo-saxon, sous le titre Debunking economics, « Démystifier l’économie ».
Il s’y emploie à dynamiter méthodiquement les bases de la théorie néoclassique, la pensée économique qui sous-tend toute l’idéologie néolibérale contemporaine. Un par un, Steve Keen examine les axiomes de la micro- économie, censés décrire le fonctionnement des consommateurs et des entreprises. Il ne le fait pas à coup de méthodes extravagantes ou en faisant appel à des théories farfelues. Au contraire, il les expose à la lumière de certains des auteurs classiques de la discipline et les analyse avec les armes mêmes de la pensée économique la plus traditionnelle.
Après avoir été passées à ce crible, ces théories, parfois aussi centrales que les « lois » de l’offre et de la demande, ne tiennent plus guère debout. « La prétendue science économique est un agrégat de mythes qui fait passer l’ancienne conception géocentrique du système solaire de Ptolémée pour un modèle puissamment sophistiqué », balance, cruel, l’auteur. « L’une des nombreuses raisons qui ont permis aux économistes de réussir à prendre le contrôle des politiques sociales, c’est l’affirmation d’une certaine légitimité intellectuelle face à quiconque s’oppose à leurs recommandations, rappelle-t-il. L’objet de ce livre est de montrer que cette affirmation est fallacieuse. »
Le livre sort avec une certaine pompe dans l’Hexagone, l’auteur étant sur le territoire ces jours-ci pour participer à plusieurs réunions publiques . Il est appuyé par Gaël Giraud, un économiste français hétérodoxe qui s’est imposé dans le débat politique français en publiant, fin 2012, une note extrêmement sévère sur le projet de loi de séparation des activités bancaires, qu’il jugeait tout à fait insuffisant . Auteur de la préface, Giraud a supervisé la traduction française du livre de Keen. Il juge, dans une passionnante interview à Mediapart, qu’« il s’agit d’un texte majeur qui fera date ». « Ce livre est une interpellation. Celle d’un universitaire économiste qui apostrophe sa communauté et, par-delà celle-ci, notre société tout entière », écrit-il.
Car il faut prendre la mesure du monde dans lequel vivent et raisonnent les économistes. Un monde parallèle, qui ne reflète la réalité que de très loin. Et à rebours de toute démarche scientifique réelle. « Plutôt que démarrer par un phénomène qui nécessite une explication, comme le ferait une science, les économistes commencent avec une opinion sur la façon dont devrait être la réalité. Par exemple, avec leur abstraction favorite, le marché où devrait régner une “concurrence pure et parfaite”. Aucun marché sur la planète n’a jamais approché cette abstraction, mais ils tentent de modéliser l’économie entière “comme si” elle était principalement constituée de ces phénomènes non existants », rappelle Steve Keen à Mediapart.
Les économistes travaillent donc, rappelle Giraud dans sa préface, dans « un univers sans monnaie et sans secteur bancaire, où le capital s’accumule tout seul sans être produit par personne (…). Une galaxie imaginaire peuplée de gentlemen dotés d’une puissance de calcul infinie, capables d’anticiper le niveau de tous les prix (…) jusqu’à la fin des temps ». Un univers que Keen s’emploie à mettre à bas.
Les lois de l'offre et de la demande ne tiennent pas la route
Le livre est écrit d’une plume alerte, un brin moqueuse, mais soucieuse de pédagogie. Le langage plutôt accessible (qui nous enjoint par exemple de « calculer le schmilblick ») ne masque pas la rigueur théorique à l’œuvre. À tel point que certains passages de déconstruction économique sont à réserver aux lecteurs avertis, entrepreneurs, économistes ou étudiants désireux de s’informer à d’autres sources que les programmes universitaires classiques. Car Steve Keen parle le langage commun à tous les économistes qui se respectent, fait de modélisation et de formules mathématiques (même s’il épargne à ses lecteurs la moindre équation dans ses quelque 500 pages de démonstration passionnée). « Les économistes néoclassiques utilisent des équations et des modèles qui paraissent compliqués à quiconque n’est pas spécialisé en physique ou en mathématiques, et ils semblent donc posséder un savoir plus grand que le simple mortel, explique l’auteur à Mediapart. Il faut une profonde connaissance des maths et de la science pour comprendre qu’il s’agit d’une pseudo-science.
» Parmi les cibles de Keen, on trouve la fameuse « loi » de la demande, selon laquelle « chaque consommateur s’efforce d’obtenir le plus haut niveau possible de satisfaction en fonction de son revenu ». Or, explique le livre, « cette théorie n’est pas solide ». Si les économistes apportent une analyse cohérente du comportement d’un seul individu, ils ne parviennent en revanche pas à faire passer la modélisation au degré supérieur, en analysant le comportement de tous les individus formant ensemble une société. Pour le faire, ils sont contraints de postuler qu’il n’existe soit qu’un seul individu, soit qu’une seule marchandise dans toute la société ! « Les conditions qui sont nécessaires pour “assurer” la validité de la loi de la demande au niveau du marché constituent en fait la preuve par l’absurde que cette loi ne peut s’appliquer », estime Keen.
Il en va de même avec la non moins célèbre courbe de l’offre, base de l’analyse économique de la production des entreprises, qui, selon l’économiste australien,« n’existe pas ». Quant à la courbe croissante du coût marginal, qui explique que, à« court terme », la productivité d’une entreprise chute à mesure que la production augmente, de telle sorte que de plus hauts niveaux de production conduisent à des prix plus élevés, elle serait sans aucun fondement dans la plupart des cas : « Seules les marchandises qui ne peuvent être produites dans des usines (comme le pétrole) sont susceptibles d’avoir des coûts de production qui se comportent selon les attentes des économistes » !
Attaques à droite, mais aussi à gauche
Mais si ces règles de base sont en fait invalides, pourquoi n’ont-elles pas été dénoncées depuis des années ? En fait, elles l’ont régulièrement été, et souvent par des penseurs reconnus des écoles classiques et néoclassiques. Mais leurs analyses ont été soit noyées (peut-être volontairement) dans des chiffres et des formules mathématiques alambiquées, soit ignorées par le monde universitaire. Et puis, explique l’auteur à Mediapart, « le principal facteur qui avantage la théorie néoclassique est que, pour faire marcher une économie, on n’a pas besoin de la théorie économique au sens où on a besoin d’une science de l’ingénierie pour construire un pont : si l’économie était aussi nécessaire que l’ingénierie, ses défauts auraient été identifiés et corrigés il y a bien longtemps, parce que les économies de tous les pays se seraient effondrées comme des ponts mal construits ».
Au fil des pages, les théories les plus basiques sur le comportement des producteurs, des salariés ou des consommateurs tombent à l'eau. Keen montre aussi comment la pensée néoclassique néglige le rôle de l'incertitude et des anticipations de gain dans les comportements économiques. Pire encore, la plupart des modèles oublient de conceptualiser le rôle du crédit et de la monnaie, en omettant de faire apparaître les banquiers dans leurs calculs !
L’auteur, qui se définit comme « post-keynésien », utilise ses constats et ses découvertes pour déplorer la mainmise de la pensée néoclassique dans le débat universitaire, mais aussi et surtout politique depuis le début des années 1980. Depuis la sortie de la première édition de son livre en 2001, il échange d’ailleurs des argumentaires musclés avec les tenants de cette pensée, qui tentent de mettre à mal ses analyses. Pour se faire une idée de l’argumentaire critiquant son livre, on peut se reporter à cet article hébergé sur le site du magazine Forbes, qui reconnaît que Keen pointe de réelles erreurs de calcul et de modèle, mais qui plaide qu’elles sont sans conséquence pour la description de l’économie réelle.
Bien plus surprenant, Keen a aussi maille à partir avec des économistes de l'aile gauche, et notamment avec l’un des plus célèbres d’entre eux, le Prix Nobel Paul Krugman. Sur son blog, Krugman l’attaque par exemple ici ou ici, et Keen fait de même là ou là. On trouve un résumé de leur débat sur le rôle de la monnaie et des banques par ici. Pourquoi ces querelles régulières, de la part de deux hommes qui partagent des critiques similaires sur le système capitaliste actuel ? Parce que leur évaluation des théories classiques est presque contraire, comme Gaël Giraud l’explique à merveille dans l’entretien accordé à Mediapart. Steve Keen complète : « Nous pouvons être dans le même camp pour un débat sur les politiques économiques à mener (et nous le sommes souvent), même si nous avons des opinions totalement différentes sur la façon dont l’économie fonctionne réellement. »
La « nature mensongère » des manuels d’économie
Au fil de son ouvrage, l’économiste australien déplore que la formation des économistes les empêche presque totalement de déceler les erreurs qui parsèment la théorie qui leur est inculquée, puis que le système même fasse triompher cette « pédagogie paresseuse ». Pour un universitaire, il est en effet extrêmement risqué en terme de carrière de critiquer l’école néoclassique dominante. Keen pointe aussi « la nature mensongère des manuels d’économie » les plus connus, pour leur propension à masquer les faiblesses théoriques des thèses qu’ils défendent : « Les économistes sont si engagés en faveur de leur méthodologie de prédilection qu’ils ignorent ou banalisent les points où leur analyse dévoile ses plus grandes faiblesses. Pour que l’économie mérite vraiment la noble appellation de “science sociale”, ces échecs devraient la conduire à abandonner cette méthodologie et à en rechercher une autre, plus solide.
» Steve Keen cache à peine son ambition de bouleverser le monde de l’analyse économique avec la même amplitude que l’a fait Keynes dans les années 1930. Pour l’instant, on en est loin. Malgré ses échanges musclés avec certains économistes, son travail a été, au moins dans un premier temps, largement ignoré par les spécialistes de la discipline. Mais depuis la crise financière démarrée en 2008, son statut évolue, et pour cause. « Dans la première édition, je faisais remarquer à plusieurs reprises qu’une telle crise était probable dans un futur proche, et le facteur que je citais comme la cause – l’éclatement d’une bulle spéculative financée par la dette – est effectivement ce qui l’a provoquée, raconte-t-il. Mes idées ont aujourd’hui plus de valeur parce que l’événement que je pronostiquais est arrivé. »
Les dernières pages de son livre sont consacrées à la présentation de diverses écoles de pensée alternatives, toutes critiques de la théorie dominante. Aujourd’hui, force est de constater qu’elles ne s’imposent pas dans les discours, académiques ou politiques.« Elles auront plus de succès quand une seconde crise adviendra dans les pays anglo-saxons ou lorsqu’une première crise éclatera en Chine », rétorque Keen, qui prévoit une nouvelle crise majeure dans les cinq à dix ans, « parce que le niveau de la dette est toujours trop haut, et que le renouveau de ces économies fait une fois de plus grimper le niveau de la dette privée. » L’économiste se veut optimiste : « Il n’y a pas de messie en économie, mais il y a de nombreuses autres écoles de pensée à partir desquelles une théorie économique décente pourrait être bâtie, et je pense que leur heure arrivera dans la prochaine décennie. »
Réformer la science économique, un pari intéressant. En tout cas, il est vrai que le principe même d'une science est de se remettre en question, et sur ce point, on est loin du compte.
Peut-être une piste d'évolution de notre société, si l'on accorde crédit au postulat d'Immanuel Wallerstein selon qui le capitalisme toucherait à sa fin. Un changement d'ère serait imminent, ou peut-être a-t-il déjà commencé d'ailleurs. Les intellectuels à la fin de la féodalité ont-ils vraiment eu conscience qu'ils entraient dans une nouvelle ère, le capitalisme? J'en doute. Dès lors, il me paraît fort probable que même si cette nouvelle ère avait déjà commencé, nous n'en aurions probablement pas conscience. L'histoire le dira à ceux qui nous suivent...
http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2008/12/16/le-capitalisme-touche-a-sa-fin_1105714_1101386.html
"Le capitalisme touche à sa fin"
LE MONDE | 16.12.2008 à 10h43 | Propos recueillis par Antoine Reverchon
Signataire du manifeste du Forum social de Porto Alegre ("Douze propositions pour un autre monde possible"), en 2005, vous êtes considéré comme l'un des inspirateurs du mouvement altermondialiste. Vous avez fondé et dirigé le Centre Fernand-Braudel pour l'étude de l'économie des systèmes historiques et des civilisations de l'université de l'Etat de New York, à Binghamton. Comment replacez-vous la crise économique et financière actuelle dans le "temps long" de l'histoire du capitalisme ?
Immanuel Wallerstein : Fernand Braudel (1902-1985) distinguait le temps de la "longue durée", qui voit se succéder dans l'histoire humaine des systèmes régissant les rapports de l'homme à son environnement matériel, et, à l'intérieur de ces phases, le temps des cycles longs conjoncturels, décrits par des économistes comme Nicolas Kondratieff (1982-1930) ou Joseph Schumpeter (1883-1950). Nous sommes aujourd'hui clairement dans une phase B d'un cycle de Kondratieff qui a commencé il y a trente à trente-cinq ans, après une phase A qui a été la plus longue (de 1945 à 1975) des cinq cents ans d'histoire du système capitaliste.
Dans une phase A, le profit est généré par la production matérielle, industrielle ou autre ; dans une phase B, le capitalisme doit, pour continuer à générer du profit, se financiariser et se réfugier dans la spéculation. Depuis plus de trente ans, les entreprises, les Etats et les ménages s'endettent, massivement. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière partie d'une phase B de Kondratieff, lorsque le déclin virtuel devient réel, et que les bulles explosent les unes après les autres : les faillites se multiplient, la concentration du capital augmente, le chômage progresse, et l'économie connaît une situation de déflation réelle.
Mais, aujourd'hui, ce moment du cycle conjoncturel coïncide avec, et par conséquent aggrave, une période de transition entre deux systèmes de longue durée. Je pense en effet que nous sommes entrés depuis trente ans dans la phase terminale du système capitaliste. Ce qui différencie fondamentalement cette phase de la succession ininterrompue des cycles conjoncturels antérieurs, c'est que le capitalisme ne parvient plus à "faire système", au sens où l'entend le physicien et chimiste Ilya Prigogine (1917-2003) : quand un système, biologique, chimique ou social, dévie trop et trop souvent de sa situation de stabilité, il ne parvient plus à retrouver l'équilibre, et l'on assiste alors à une bifurcation.
La situation devient chaotique, incontrôlable pour les forces qui la dominaient jusqu'alors, et l'on voit émerger une lutte, non plus entre les tenants et les adversaires du système, mais entre tous les acteurs pour déterminer ce qui va le remplacer. Je réserve l'usage du mot "crise" à ce type de période. Eh bien, nous sommes en crise. Le capitalisme touche à sa fin.
Pourquoi ne s'agirait-il pas plutôt d'une nouvelle mutation du capitalisme, qui a déjà connu, après tout, le passage du capitalisme marchand au capitalisme industriel, puis du capitalisme industriel au capitalisme financier ?
Le capitalisme est omnivore, il capte le profit là où il est le plus important à un moment donné ; il ne se contente pas de petits profits marginaux ; au contraire, il les maximise en constituant des monopoles - il a encore essayé de le faire dernièrement dans les biotechnologies et les technologies de l'information. Mais je pense que les possibilités d'accumulation réelle du système ont atteint leurs limites. Le capitalisme, depuis sa naissance dans la seconde moitié du XVIe siècle, se nourrit du différentiel de richesse entre un centre, où convergent les profits, et des périphéries (pas forcément géographiques) de plus en plus appauvries.
A cet égard, le rattrapage économique de l'Asie de l'Est, de l'Inde, de l'Amérique latine, constitue un défi insurmontable pour "l'économie-monde" créée par l'Occident, qui ne parvient plus à contrôler les coûts de l'accumulation. Les trois courbes mondiales des prix de la main-d'oeuvre, des matières premières et des impôts sont partout en forte hausse depuis des décennies. La courte période néolibérale qui est en train de s'achever n'a inversé que provisoirement la tendance : à la fin des années 1990, ces coûts étaient certes moins élevés qu'en 1970, mais ils étaient bien plus importants qu'en 1945. En fait, la dernière période d'accumulation réelle - les "trente glorieuses" - n'a été possible que parce que les Etats keynésiens ont mis leurs forces au service du capital. Mais, là encore, la limite a été atteinte !
Y a-t-il des précédents à la phase actuelle, telle que vous la décrivez ?
Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de l'humanité, contrairement à ce que renvoie la représentation, forgée au milieu du XIXe siècle, d'un progrès continu et inévitable, y compris dans sa version marxiste. Je préfère me cantonner à la thèse de la possibilité du progrès, et non à son inéluctabilité. Certes, le capitalisme est le système qui a su produire, de façon extraordinaire et remarquable, le plus de biens et de richesses. Mais il faut aussi regarder la somme des pertes - pour l'environnement, pour les sociétés - qu'il a engendrées. Le seul bien, c'est celui qui permet d'obtenir pour le plus grand nombre une vie rationnelle et intelligente.
Cela dit, la crise la plus récente similaire à celle d'aujourd'hui est l'effondrement du système féodal en Europe, entre les milieux du XVe et du XVIe siècle, et son remplacement par le système capitaliste. Cette période, qui culmine avec les guerres de religion, voit s'effondrer l'emprise des autorités royales, seigneuriales et religieuses sur les plus riches communautés paysannes et sur les villes. C'est là que se construisent, par tâtonnements successifs et de façon inconsciente, des solutions inattendues dont le succès finira par "faire système" en s'étendant peu à peu, sous la forme du capitalisme.
Combien de temps la transition actuelle devrait-elle durer, et sur quoi pourrait-elle déboucher ?
La période de destruction de valeur qui clôt la phase B d'un cycle Kondratieff dure généralement de deux à cinq ans avant que les conditions d'entrée dans une phase A, lorsqu'un profit réel peut de nouveau être tiré de nouvelles productions matérielles décrites par Schumpeter, sont réunies. Mais le fait que cette phase corresponde actuellement à une crise de système nous a fait entrer dans une période de chaos politique durant laquelle les acteurs dominants, à la tête des entreprises et des Etats occidentaux, vont faire tout ce qu'il est techniquement possible pour retrouver l'équilibre, mais il est fort probable qu'ils n'y parviendront pas.
Les plus intelligents, eux, ont déjà compris qu'il fallait mettre en place quelque chose d'entièrement nouveau. Mais de multiples acteurs agissent déjà, de façon désordonnée et inconsciente, pour faire émerger de nouvelles solutions, sans que l'on sache encore quel système sortira de ces tâtonnements.
Nous sommes dans une période, assez rare, où la crise et l'impuissance des puissants laissent une place au libre arbitre de chacun : il existe aujourd'hui un laps de temps pendant lequel nous avons chacun la possibilité d'influencer l'avenir par notre action individuelle. Mais comme cet avenir sera la somme du nombre incalculable de ces actions, il est absolument impossible de prévoir quel modèle s'imposera finalement. Dans dix ans, on y verra peut-être plus clair ; dans trente ou quarante ans, un nouveau système aura émergé. Je crois qu'il est tout aussi possible de voir s'installer un système d'exploitation hélas encore plus violent que le capitalisme, que de voir au contraire se mettre en place un modèle plus égalitaire et redistributif.
Les mutations antérieures du capitalisme ont souvent débouché sur un déplacement du centre de "l'économie-monde", par exemple depuis le Bassin méditerranéen vers la côte Atlantique de l'Europe, puis vers celle des Etats-Unis ? Le système à venir sera-t-il centré sur la Chine ?
La crise que nous vivons correspond aussi à la fin d'un cycle politique, celui de l'hégémonie américaine, entamée également dans les années 1970. Les Etats-Unis resteront un acteur important, mais ils ne pourront plus jamais reconquérir leur position dominante face à la multiplication des centres de pouvoir, avec l'Europe occidentale, la Chine, le Brésil, l'Inde. Un nouveau pouvoir hégémonique, si l'on s'en réfère au temps long braudélien, peut mettre encore cinquante ans pour s'imposer. Mais j'ignore lequel.
En attendant, les conséquences politiques de la crise actuelle seront énormes, dans la mesure où les maîtres du système vont tenter de trouver des boucs émissaires à l'effondrement de leur hégémonie. Je pense que la moitié du peuple américain n'acceptera pas ce qui est en train de se passer. Les conflits internes vont donc s'exacerber aux Etats-Unis, qui sont en passe de devenir le pays du monde le plus instable politiquement. Et n'oubliez pas que nous, les Américains, nous sommes tous armés...
Peut-être allons-nous voir l'émergence d'une société et d'un monde plus collaboratif? Les multinationales comme les institutions publiques internationales n'ont-elles pas ouvert cette voie, en développant une collaboration internationale très efficace entre leurs collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui nombreux sur terre à apprécier cette manière de travailler ensemble.
En réformant la science économique (qui fige notre système économique actuel), en gardant à l'esprit que "Le seul bien, c'est celui qui permet d'obtenir pour le plus grand nombre une vie rationnelle et intelligente.", on pourrait penser que les changements majeurs à venir, et ceux qui ont déjà lieu, sont peu-être une chance pour l'humanité de prendre son destin en main.
Un retour à l'homo sapiens (Qui a le palais délicat, connaisseur ; qui a du goût, qui comprend, qui connaît. Intelligent, raisonnable, sage, sensé.), après un détour par l'homo economicus (est capable de maximiser sa satisfaction en utilisant au mieux ses ressources, sait analyser et anticiper le mieux possible la situation et les événements du monde qui l'entoure afin de prendre les décisions permettant cette maximisation)? Et pourquoi pas...
- Demos
- Messages: 47
- Enregistré le: Jeu 02 Juil 2015 16:49
2 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Analyses et informations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité