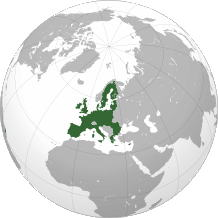Décryptant les rapports entre monnaie et souveraineté, cette étude, à la fois dense et pédagogique, aidera les non-spécialistes à donner un sens aux interactions économiques et politiques complexes dans lesquelles ils sont immergés.
L'auteur appelle à des avancées institutionnelles jugées indispensables pour compléter l’euro, doublées d'une politique européenne d'investissement.
Il dresse d'abord le constat de la paralysie politique de l'Europe :
L'euro est une monnaie incomplète, privée du lien organique entre la banque centrale et l'Etat souverain. D'où la violence de la crise dans la zone euro. Un Etat fédéral européen étant hautement improbable, l'union monétaire ne pourra fonctionner que sur la base de partages partiels de souveraineté. ( … )
La gestion de la crise grecque est l’illustration la plus emblématique de la persistance dans l’erreur.
Trois plans d’aide ont été appliqués et des avancées minimales dans la consolidation des structures financières de l’Europe ont été faites en 2011 et 2012 lors du déchaînement de la crise financière qui a forcé à des «compromis de la dernière chance ».
Près de cinq ans d’une mise sous tutelle de la Grèce y ont abouti à un recul du PIB de 25 %, une chute de l’investissement de 40 %, une hausse de plus de 13 points du taux de chômage (atteignant 26 % en 2014) et une amputation de 23 % des salaires du secteur public ; tout cela pour une augmentation de la dette publique de 109 % à 175 % du PIB ! La crise sociale résultant de ces « performances » a mené au pouvoir une force politique portant des idées nouvelles. On aurait pu espérer que ce changement fasse bouger les lignes, d’autant que la zone euro dans son ensemble est enlisée dans un équilibre autoentretenu de croissance trop faible pour faire reculer le chômage. Mais les instances dirigeantes de l’Europe (Conseil Ecofin, groupe euro, Conseil européen) restent enfermées dans des postures stéréotypées et bardées de règles arbitraires qui les empêchent de considérer le principe de réalité.
La Banque centrale européenne (BCE), qui porte seule un intérêt commun en tant qu’instance fédérale, a cherché à mettre les gouvernements devant leurs responsabilités.
Après avoir éclairci les rapports entre monnaie et souveraineté, il tire les conséquences de l’incomplétude de l’euro :
Les conséquences ravageuses de cette incomplétude ont éclaté dans la crise. Parce que les Etats de la zone euro ne sont pas placés sous l’autorité d’un ordre constitutionnel commun, tout se passe comme si les dettes publiques nationales étaient dégradées en dettes privées. Le lien organique entre l’Etat et la banque centrale ( ... ) est coupé. Les Etats peuvent donc devenir insolvables.
L'absence de coordination macroéconomique et budgétaire de la zone euro est en effet une impasse :
Les déficiences de l’union monétaire viennent du manque de capacité de régulation politique au niveau européen. La méthode de la concertation intergouvernementale par petits pas est à la fois inefficace et non démocratique, donc sans légitimité. La concertation intergouvernementale ne résiste pas aux forces centrifuges exacerbées par la crise. Car les Etats, dans leurs rapports réciproques, ne peuvent exprimer vis-à-vis de l’UEM que des intérêts nationaux, donc particuliers. Ils ne cherchent qu’à faire reconnaître leurs intérêts par rapport aux autres. Depuis la crise, les conflits d’intérêts se sont aiguisés. Un intérêt commun, capable d’engendrer un compromis, n’apparaît que dans les situations extrêmes où tout l’édifice menace de s’écrouler. Il est nécessairement minimaliste.
(...)
Les pays ont continué à être jugés à partir de programmes de stabilité à moyen terme devenus obsolètes, parce que fondés sur des hypothèses de croissance à moyen terme grossièrement erronées. En outre, la surveillance macroéconomique devait introduire une mesure de symétrie dans les ajustements entre pays excédentaires et pays déficitaires en balances des paiements pour ne pas faire porter exclusivement l’ajustement sur les pays déficitaires les plus fragiles. Or l’Allemagne a exhibé des excédents de plus en plus grands et dépassé le seuil jugé raisonnable sans déclencher la moindre obligation d’augmenter sa demande intérieure pour le réduire. Enfin, la procédure de va-et-vient impliquée par le semestre européen est demeurée entièrement verticale et dépourvue de tout contrôle démocratique : chaque gouvernement dialogue séparément avec la Commission. Les inter n’ont pas force de loi européenne puisqu’ils ne sont pas avalisés par un parlement souverain (…) L’incapacité à promouvoir une coopération raisonnée, recherchant des objectifs économiques communs, contingente à la situation de l’ensemble de la zone, donc flexible et évolutive, s’est traduite par son contraire : une accumulation de règles arbitraires, imposée pour éviter le déchaînement des intérêts contradictoires.
Ces règles ont empêché toute initiative pour sortir la zone euro du marasme.
Il pointe le dévoiement du système économique :
La cassure structurelle du lien entre salaire et productivité est bien plus qu’une question d’inégalités de répartition. C’est une dévalorisation du travail dans sa capacité productive : insuffisance dramatique de l’éducation à promouvoir les qualifications requises pour l’innovation, affaiblissement des protections inscrites dans le droit du travail et les contrats collectifs, transformations de la gouvernance des entreprises au profit de la maximisation de la valeur actionnariale à court terme, amputation systématique de la fiscalité sur le capital et incapacité de plus en plus accusée des Etats à produire les biens publics.
Un régime de croissance dans lequel la part des salaires primaires dans le PIB baisse continuellement, et où le revenu moyen des 90 % de la population du bas de l’échelle stagne en termes réels, ne peut éviter la dégradation de l’emploi que par une augmentation continuelle de l’endettement total par rapport au PIB.
En complément d'avancées institutionnelles, il plaide pour une politique européenne d'investissement ainsi financée :
Le financement de ces investissements se prête à la création d’un Fonds stratégique européen qui émettrait des obligations hors
du périmètre des dettes publiques nationales. Elles seraient un support idéal pour la politique de bilan de la BCE".
En savoir plus : http://www.leconomiepolitique.fr/monnaie-et-souverainete--comment-completer-l-euro_fr_art_1362_72470.html