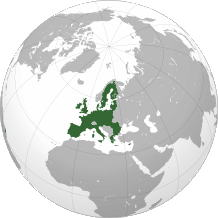Au début d'un nouveau siècle, il est bien imprudent de dire qu'un événement retiendra plus tard l'attention des historiens. La crise financière de 2007-2008, ainsi que ses conséquences économiques, ne semblent pas cependant à ce jour, dans son domaine, un élément mineur destiné à être oublié.
Elle met en lumière la folie d'un système que les hommes ne maîtrisent plus et les métaphores utilisées souvent pour en parler (tempête, raz de marée, tsunami.....) montrent bien que pour de nombreux analystes, il s'agit de phénomènes incontrôlés comme les grandes catastrophes naturelles.
Cette crise était-elle aussi évitable ?
Cela semblait être le cas dans les semaines et les mois qui ont suivi ces évènements. On a entendu sur tous les continents, les voix des responsables politiques promettre des réformes d'envergure pour éviter le retour d'une telle catastrophe.
Passés ces premiers moments d'émotion, la peur du changement, le manque de courage, les intérêts particuliers et les égoïsmes nationaux se sont empressés de revenir à la manœuvre.
Le débat a porté très vite sur ce qui avait été longtemps considéré, juste après la crise, comme la cause fondamentale de ces dérèglements, à savoir la séparation des banques de dépôts et de marché. Il en est résulté une absence de véritable réflexion sur les objectifs que devait respecter la réforme du système financier. Les accents de la campagne électorale française, sur le sujet, ont été, de ce fait, bien pauvres, imprégnés d'un manichéisme primaire et aux antipodes des problèmes fondamentaux qui concernent le plus grand nombre.
Pouvait-il en être autrement dans des États qui réagissent plus aux exigences des calendriers électoraux qu'aux mouvements de fond sur lesquels reposent les sociétés humaines ?
Les États-Unis, la Grand Bretagne, L'Europe et ses États membres sont bien cependant entrés dans un processus de réformes, mais de façon non coordonnée; comme si, à la dimension globale de la crise économique et des formidables moyens financiers mis en œuvre, il fallait donner des réponses locales !
Les instances internationales telles le G2O, le Comité de Bâle ou même l'Union Européenne ont montré leur incapacité partielle à fédérer cette riposte.
Les nouvelles dispositions mettent souvent l'accent sur la supervision et l'auto-contrôle, sans se risquer à trop de directivité. Nul ne sait trop ce que le cantonnement ou la filialisation, version modifiée de la séparation des banques, apporteront dans l'avenir.
Les obstacles à de véritables changements ont nom libéralisme triomphant, lobbies, pensée unique, égoïsmes nationaux et autres visions à court terme.
Il est à craindre que les populations lassées de tant de faux semblants et de désintérêts pour leur cause, au profit d'un petit nombre, ne finissent par bouder le processus démocratique ou à l'utiliser pour le triomphe des divers populismes, voire pire.
Nos élites ont-elles conscience de la responsabilité qu'elles portent et des conséquences possibles que l’analyse historique devrait leur enseigner ?
C'est ce thème qui est plus longuement développé dans le texte joint au travers de l'étude :
Des leçons de la crise
Du contenu de la réforme bancaire
Du rôle des groupes de pression
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
L'improbable réforme bancaire
6 messages
• Page 1 sur 1
L'improbable réforme bancaire
- Fichiers joints
-
Commentaire: Réformes financières et lobbies
 réformes financières et Lobbies-4.doc [195.5 Kio]
réformes financières et Lobbies-4.doc [195.5 Kio]
Téléchargé 1139 fois
- KERHUNE
- Messages: 56
- Enregistré le: Mer 26 Oct 2011 19:59
Re: L'improbable réforme bancaire
Bonjour,
Est-il possible de préciser ce que les terme filialisation et cantonnement recouvrent par rapport à une réelle séparation banque de dépôt/de marché?
merci
Est-il possible de préciser ce que les terme filialisation et cantonnement recouvrent par rapport à une réelle séparation banque de dépôt/de marché?
merci
- benjamin
- Messages: 21
- Enregistré le: Sam 26 Nov 2011 18:30
Re: L'improbable réforme bancaire
Le terme ''cantonnement'' est la traduction du terme britannique ''ring fencing'' qui veut dire aussi littéralement "encerclement par une barrière". Il est employé à propos de la réforme britannique. Il vise à isoler les activités relatives aux banques de dépôt et les activités sans risque. Ce cantonnement pourra se faire par voie de filialisation mais les discussions sont toujours en cours puisque la réforme ne devra voir le jour qu'en 2019 seulement. Le terme filialisation est lui, plus adapté, à la réforme française, par exemple, car il y a là une volonté délibérée de ne pas casser les groupes bancaires et le concept de banque universelle. Le principe de la filialisation consiste donc à laisser les activités incriminées (à risque) dans le groupe consolidé. En effet, une banque universelle ou n'importe quelle banque est au plan juridique, comptable et financier le fruit de l'agrégation (consolidation) de nombreuses sociétés liées par des participations à une société mère (holding) ou même entre elles. Ce n'est pas le parti qu'avait pris le GLASS STEAGALL ACT dans les années tente où les entités avaient été totalement séparées. Elles ne dépendaient pas d'une société mère commune et n'avaient pas non plus de lien de participation.
L'enjeu de cette question va au delà du simple débat de la filialisation ou du cantonnement par la création d'une filiale.
Il existe certes à ce niveau car les activités bancaires sont déjà divisées en filiales. Celles-ci sont hautement interdépendantes. Elles participent à un ensemble consolidé et sont liées par un réseau de participations et de créances et dettes qui font que, si une partie vient à faire défaut, elle entraîne le reste du groupe. Si les réformes engagées dans ce sens n'interdisent pas ce type de liens juridiques ou financier, la réforme n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau. Le Parlement français a rajouté au texte initial l'obligation pour la filiale d'avoir un financement autonome des activités mais il faudra voir le décret d'application ainsi que l'usage que les banques en feront.
Ensuite, même si on arrive à cloisonner réellement ces activités sans risque ou plus précisément celles qui gèrent nos dépôts, il reste que même sans lien juridique et financier, les banques se prêtent et empruntent. Or, si les réformes ne sont pas identiques en Europe et aux États-Unis comment pourra-on éviter qu'une institution financière considérée à risque dans un pays, mais non dans un autre, n'emprunte à une activité sans risque dans cet autre pays et ne l'entraîne dans son défaut ? Cela aurait aussi existé si certains pays étaient revenus à une séparation stricte et d'autres non.
C'est ce qui fait dire à certains que la véritable réforme mis en œuvre à ce jour, est une réforme de la supervision (plus de pouvoir des autorités de régulation, auto-contrôle, filières de risques, plan de résolution, réforme des agences de notation) qu'une amorce de séparation des activités. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, la crise financière est due à deux facteurs essentiels: l'appétit incontrôlé de profit qui a conduit à des pratiques frauduleuses (subprimes, titisation opaque et même plus proche de nous, la vente de produits dérivés aux collectivités locales) et la dissémination mondiale au travers des inter-connexions bancaires favorisée par la déficience des systèmes de contrôle. Une véritable réforme devrait conduire à séparer les banques qui détiennent les dépôts et qui fiancent l'économie en leur interdisant tout lien de capital ou de financement dans un sens ou dans l'autre avec les autres activités financières. Ce n'est pas ce qui a été fait et ce n'est malheureusement pas parce qu'il existait une meilleure solution pour protéger ces mêmes dépôts....!
L'enjeu de cette question va au delà du simple débat de la filialisation ou du cantonnement par la création d'une filiale.
Il existe certes à ce niveau car les activités bancaires sont déjà divisées en filiales. Celles-ci sont hautement interdépendantes. Elles participent à un ensemble consolidé et sont liées par un réseau de participations et de créances et dettes qui font que, si une partie vient à faire défaut, elle entraîne le reste du groupe. Si les réformes engagées dans ce sens n'interdisent pas ce type de liens juridiques ou financier, la réforme n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau. Le Parlement français a rajouté au texte initial l'obligation pour la filiale d'avoir un financement autonome des activités mais il faudra voir le décret d'application ainsi que l'usage que les banques en feront.
Ensuite, même si on arrive à cloisonner réellement ces activités sans risque ou plus précisément celles qui gèrent nos dépôts, il reste que même sans lien juridique et financier, les banques se prêtent et empruntent. Or, si les réformes ne sont pas identiques en Europe et aux États-Unis comment pourra-on éviter qu'une institution financière considérée à risque dans un pays, mais non dans un autre, n'emprunte à une activité sans risque dans cet autre pays et ne l'entraîne dans son défaut ? Cela aurait aussi existé si certains pays étaient revenus à une séparation stricte et d'autres non.
C'est ce qui fait dire à certains que la véritable réforme mis en œuvre à ce jour, est une réforme de la supervision (plus de pouvoir des autorités de régulation, auto-contrôle, filières de risques, plan de résolution, réforme des agences de notation) qu'une amorce de séparation des activités. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, la crise financière est due à deux facteurs essentiels: l'appétit incontrôlé de profit qui a conduit à des pratiques frauduleuses (subprimes, titisation opaque et même plus proche de nous, la vente de produits dérivés aux collectivités locales) et la dissémination mondiale au travers des inter-connexions bancaires favorisée par la déficience des systèmes de contrôle. Une véritable réforme devrait conduire à séparer les banques qui détiennent les dépôts et qui fiancent l'économie en leur interdisant tout lien de capital ou de financement dans un sens ou dans l'autre avec les autres activités financières. Ce n'est pas ce qui a été fait et ce n'est malheureusement pas parce qu'il existait une meilleure solution pour protéger ces mêmes dépôts....!
- KERHUNE
- Messages: 56
- Enregistré le: Mer 26 Oct 2011 19:59
Re: L'improbable réforme bancaire
KERHUNE a écrit:Le terme ''cantonnement'' est la traduction du terme britannique ''ring fencing'' qui veut dire aussi littéralement "encerclement par une barrière". Il est employé à propos de la réforme britannique. Il vise à isoler les activités relatives aux banques de dépôt et les activités sans risque. Ce cantonnement pourra se faire par voie de filialisation mais les discussions sont toujours en cours en Grande Bretagne puisque la réforme ne devra voir le jour qu'en 2019. Le terme filialisation est lui, plus adapté, à la réforme française, par exemple, car il y a là une volonté délibérée de ne pas casser les groupes bancaires et le concept de banque universelle. Le principe de la filialisation consiste donc à laisser les activités incriminées (à risque) dans le groupe consolidé. En effet, une banque universelle ou n'importe quelle banque est au plan juridique, comptable et financier le fruit de l'agrégation (consolidation) de nombreuses sociétés liées par des participations à une société mère (holding) ou même entre elles. Ce n'est pas le parti qu'avait pris le GLASS STEAGALL ACT dans les années trente où les entités avaient été totalement séparées. Elles ne dépendaient pas d'une société mère commune et n'avaient pas non plus de lien de participation.
L'enjeu de cette question va au delà du simple débat de la filialisation ou du cantonnement par la création d'une filiale.
Il existe, certes, à ce niveau car les activités bancaires sont déjà divisées en filiales. Celles-ci sont hautement interdépendantes. Elles participent à un ensemble consolidé et sont liées par un réseau de participations et de créances et dettes qui font que, si une partie vient à faire défaut, elle entraîne le reste du groupe. Si les réformes engagées dans ce sens n'interdisent pas ce type de liens juridiques ou financier, la réforme n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau. Le Parlement français a rajouté au texte initial l'obligation pour la filiale d'avoir un financement autonome des activités mais il faudra voir le décret d'application ainsi que l'usage que les banques en feront.
Ensuite, même si on arrive à cloisonner réellement ces activités sans risque ou plus précisément celles qui gèrent nos dépôts, il reste que même sans lien juridique et financier, les banques se prêtent et empruntent entre elles. Or, si les réformes ne sont pas identiques en Europe et aux États-Unis, comment pourra-on éviter qu'une institution financière considérée à risque dans un pays, mais non dans un autre, n'emprunte à une activité sans risque dans cet autre pays et ne l'entraîne dans son défaut ? Cela aurait aussi existé si certains pays étaient revenus à une séparation stricte et d'autres non.
C'est ce qui fait dire à certains que la véritable réforme mis en œuvre à ce jour, est plus une réforme de la supervision (plus de pouvoir des autorités de régulation, auto-contrôle, filières de risques, plan de résolution, réforme des agences de notation) qu'une amorce de séparation des activités. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, la crise financière est due à deux facteurs essentiels: l'appétit incontrôlé de profit qui a conduit à des pratiques frauduleuses (subprimes, titisation opâque et même plus proche de nous, la vente de produits dérivés aux collectivités locales) et la dissémination mondiale au travers des inter-connexions bancaires favorisée par la déficience des systèmes de contrôle. Une véritable réforme devrait conduire à séparer les banques qui détiennent les dépôts et qui financent l'économie en leur interdisant tout lien de capital ou de financement dans un sens ou dans l'autre avec les autres activités financières. Ce n'est pas ce qui a été fait et ce n'est malheureusement pas parce qu'il existait une meilleure solution pour protéger ces mêmes dépôts....!
- KERHUNE
- Messages: 56
- Enregistré le: Mer 26 Oct 2011 19:59
Re: L'improbable réforme bancaire
Merci Kerhune pour ces éclaircissements, il vaudrait donc mieux cantonner que filialiser pour assurer une frontière entre argent utile (celui qui nous sert à manger, nous vêtir, habiter...) et argent de spéculation (le poker des financiers). Toutefois, tu sembles dire qu'une telle séparation ne sert à rien si elle n'est pas appliquée mondialement...Vaudrait-il mieux créer une autre monnaie pour bien séparer ces deux mondes? Où cela reviendrait-il au même?
Je dois avouer que ça m'est difficile de bien penser à cette échelle...Quelles seraient donc les propositions alternatives, potentiellement efficaces? Ne peut-on compter que sur un changement de mentalité des acteurs de la finance???
merci.
Je dois avouer que ça m'est difficile de bien penser à cette échelle...Quelles seraient donc les propositions alternatives, potentiellement efficaces? Ne peut-on compter que sur un changement de mentalité des acteurs de la finance???
merci.
- benjamin
- Messages: 21
- Enregistré le: Sam 26 Nov 2011 18:30
Re: L'improbable réforme bancaire
La crise financière de 2008 a plongé les économies européennes dans un marasme dont l'issue est incertaine dans la mesure où, outre le choc sur les économies, cette crise a accentué les déséquilibres autour de la dette et rendu quasi impossible le retour aux équilibres budgétaires.
Encore, ne s'agit-il que de dégâts collatéraux, le risque principal d'effondrement de l'ensemble du système financier ayant pu être évité, grâce rappelons-le, à la politique de la Banque Centrale Européenne agissant presque dans l'illégalité sous les critiques de plusieurs pays au nom de l’orthodoxie libérale.
A présent que le mal est fait et que l'action de la BCE a permis d'éviter le pire, on aurait pu penser qu'un certain courage politique s'attaque en profondeur aux racines de ce mal, à savoir la fragilité d'un système financier hypertrophié prenant des risques inconsidérés avec la garantie des gouvernements et donc des contribuables.
Les pays ont avancé, pour partie, sans concertation de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, la puissance du lobby bancaire, le repli national et le manque de cohérence à l'intérieur de l'U.E. ont conduit à une réforme en trompe l’œil.
Si le renforcement des fonds propres sous l'autorité du comité de Bâle répond de façon satisfaisante à la situation, les procédures de contrôle prudentiel et de résolution risquent de se montrer coûteuses et peu efficaces tandis que les principes de séparation bancaire n'ont vraiment été mis en place qu'en Grande Bretagne.
Lire la suite......
Encore, ne s'agit-il que de dégâts collatéraux, le risque principal d'effondrement de l'ensemble du système financier ayant pu être évité, grâce rappelons-le, à la politique de la Banque Centrale Européenne agissant presque dans l'illégalité sous les critiques de plusieurs pays au nom de l’orthodoxie libérale.
A présent que le mal est fait et que l'action de la BCE a permis d'éviter le pire, on aurait pu penser qu'un certain courage politique s'attaque en profondeur aux racines de ce mal, à savoir la fragilité d'un système financier hypertrophié prenant des risques inconsidérés avec la garantie des gouvernements et donc des contribuables.
Les pays ont avancé, pour partie, sans concertation de part et d'autre de l'Atlantique. En Europe, la puissance du lobby bancaire, le repli national et le manque de cohérence à l'intérieur de l'U.E. ont conduit à une réforme en trompe l’œil.
Si le renforcement des fonds propres sous l'autorité du comité de Bâle répond de façon satisfaisante à la situation, les procédures de contrôle prudentiel et de résolution risquent de se montrer coûteuses et peu efficaces tandis que les principes de séparation bancaire n'ont vraiment été mis en place qu'en Grande Bretagne.
Lire la suite......
- KERHUNE
- Messages: 56
- Enregistré le: Mer 26 Oct 2011 19:59
6 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Finance et spéculation
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Feu la réforme bancaire Européenne......
par KERHUNE » Lun 08 Déc 2014 11:20 - 0 Réponses
- 1585 Vus
- Dernier message par KERHUNE

Lun 08 Déc 2014 11:20
- Feu la réforme bancaire Européenne......
-
- Secret bancaire : le long chemin vers la transparence européenne
par voxpop » Mer 09 Jan 2013 23:09 - 5 Réponses
- 2071 Vus
- Dernier message par scripta manent

Sam 22 Mar 2014 21:51
- Secret bancaire : le long chemin vers la transparence européenne
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité