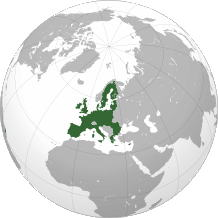Loi travail française : un texte dicté par Bruxelles ?
Deux articles parus presque simultanément traitent de cette question. Quelle que soit la réponse, le raisonnement pour y parvenir éclaire de façon intéressante le fonctionnement de l’Europe.
L’article de Médiapart daté du 12 juin 2016, signé Martine Orange, s’intitule « Comment l’Europe a pesé sur la loi El Khomry ». Comment expliquer l’intransigeance absolue du gouvernement français en dépit de la fronde sociale dans tout le pays ? Pour les détracteurs de l’UE, c’est l’Europe qui a dicté cette loi qui œuvre à casser le modèle social français et qui veut imposer le même schéma libéral dans tous les pays de l’Union. On se rappelle la mise en garde de Yanis Varoufakis, ex-ministre des Finances grec à l’été 2015 parlant d’un plan caché du ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble : « La vraie cible du docteur Schäuble c’est l’Italie et la France, l’Etat-providence français, son droit du travail, ses entreprises nationales ». La concomitance des réformes du marché du travail en Europe (déjà faite en Italie, en cours en Belgique) a été relevée par de nombreux observateurs.
A l’automne 2014, le projet de budget français pour 2015 prévoit de faire une nouvelle entorse aux règles de Maastricht : contrairement aux engagements pris auparavant, son déficit budgétaire (de 4% du PIB en 2014) ne sera pas ramené à 3% en 2015 mais seulement en 2017. Des commissaires européens et des Etats membres demandent que le budget français soit retoqué. Selon le magazine allemand Der Spiegel, généralement bien informé, les ministres français Sapin et Macron auraient ensuite fait le voyage de Berlin pour rencontrer leurs homologues allemands afin de travailler ensemble sur un nouveau projet de budget français, mais aussi un plan détaillé de réformes structurelles que la France s’engage à mettre en oeuvre.
A l’issue de cette rencontre berlinoise, la France échappe à la sanction pour déficits excessifs agitée par Bruxelles et gagne deux ans pour revenir dans les règles communes. A quel prix ?
Le 14 juillet 2015, le Conseil européen publie les recommandations sur le programme de réformes structurelles de la France en 2015. Ce document passe en revue la situation économique y compris le marché du travail : « Les réformes menées récemment n’ont donné aux employeurs que peu de possibilités pour déroger aux accords de branche par des accords d’entreprise. Cela limite la capacité des entreprises à moduler leurs effectifs en fonction de leurs besoins. » Cet aspect des réformes (contenu dans l’article 2 de la loi) est un des plus contestés.
L’article cite également un « proche du dossier » selon lequel : « Il y a sans doute eu une incitation européenne et peut-être même une forte pression allemande. Mais la haute administration française et nombre de responsables politiques n’ont pas besoin d’être contraints sur le sujet. Ils sont convaincus du bienfondé de la doctrine libérale européenne ». La deuxième partie de l’article traite des influences respectives de l’Elysée, Matignon et le ministère du Travail dans la rédaction du texte de loi.
Le deuxième article daté du 13 juin du correspondant à Bruxelles du journal Libération, Jean Quatremer, jette un éclairage un peu différent. Lorsqu’on lit la « recommandation du conseil concernant le programme national de réforme de la France pour 2015 » proposée par la Commission européenne le 13 mai 2015 on a bien l’impression de lire ce qui allait devenir quelques mois plus tard le projet de loi travail, et plus précisément son article 2 si contesté sur les accords d’entreprise : pour réduire la « segmentation » entre CDI et CDD, l’exécutif européen préconise de
« réviser les cadres juridiques régissant les contrats de travail » et de permettre aux sociétés de « déroger aux accords de branche » pour
« adapter les salaires et le temps de travail à leur situation économique ».
En réalité, selon l’auteur, ceux qui dénoncent l’ingérence de Bruxelles inversent la causalité. Il cite un responsable français : « Ce n’est pas la Commission qui décide de quoi que ce soit dans ce domaine, mais les États membres qui proposent des réformes destinées à faire converger leurs économies afin d’éviter qu’un pays devienne un problème pour tous les autres, comme on l’a vu lors de la crise de la zone euro ». En 2010, la décision a été prise de resserrer la coopération économique plus lâche prévue dans le Traité de Maastricht. Dorénavant en novembre chaque année la Commission rédige des rapports qui pointent les déséquilibres macroéconomiques dans les politiques économiques et budgétaires menées par les États pendant l’année écoulée. Sur la base de ces textes, le Conseil européen des Chefs d’État et de gouvernement adopte à l’unanimité en mars des « recommandations de politique économique ». A partir de là, chaque pays présente son « programme national de réformes » et la Commission l’intègre dans ses « recommandations pays par pays » qui seront adoptées en juin par le Conseil européen des Chefs d’État et de gouvernement par consensus et en juillet par le Conseil des ministres des Finances (à la majorité qualifiée si nécessaire). Après une période difficile de mise en place de ce processus, un dialogue bien rôdé s’est instauré entre les administrations nationales, qui tiennent à leurs prérogatives, et la Commission.
Ne figurent dans les « recommandations par pays » que les réformes que les États sont prêts à effectuer, pas celles dont rêve l’exécutif européen, ce qui est logique, puisqu’elles doivent passer par le Conseil européen des Chefs d’État où les décisions se prennent à l’unanimité. De fait la réforme El Khomri était déjà en germe dans le « programme national de réformes » présenté le 15 avril 2015. Certes il satisfait la Commission et les partenaires européens de Paris, inquiets de la dégradation du marché du travail en France, mais ceux qui dénoncent l’ingérence de Bruxelles font comme si la France ne partageait pas une monnaie commune avec 18 autres pays, ce qui implique une coordination des politiques.
Reste que cette coordination pose un problème de « légitimité politique » puisque le Parlement européen n’a pas droit au chapitre dans ce processus et beaucoup de parlements nationaux ne sont saisis qu’en bout de chaîne des textes mettant en musique ce qui a été décidé à Bruxelles. Mais introduire un contrôle démocratique suppose de changer les traités, ce qui n’est pas à l’ordre du jour aujourd’hui.
--------
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Loi travail française: un texte dicté par Bruxelles?
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers Les institutions européennes
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité