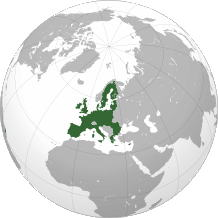Annoncé en juillet 2014 par Jean-Claude Juncker, alors candidat à la présidence de la Commission européenne, le plan européen d’investissement progresse à marche forcée. Il a été mis à l’ordre du jour du Conseil européen de la mi-décembre (réunion périodique des chefs d’Etat et de gouvernement), soit un mois et demi après que la « Commission Juncker » soit entrée en fonction. Tel un lapin bondissant d’un chapeau, ces 315 milliards d’investissement en trois ans font une irruption remarquée sur la scène européenne. Cette célérité s’explique : les montages financiers de ce plan étaient à l‘étude depuis de longs mois au sein de la précédente Commission.
Ni les chiffres, ni les mécanismes n’étant à ce jour divulgués de façon définitive, on se contentera de raisonner sur les ordres de grandeur annoncés.
La contribution propre des institutions européennes se limiterait à 21 milliards d’euros, dont 5 milliards de la Banque européenne d’investissement (BEI) - qui peine aujourd’hui à employer ses fonds et trouverait là un « débouché » salutaire - et 16 milliards de crédits antérieurement budgétés par l’Union sur la période 2014-2020. Ces 21 milliards pourraient doter un « Fonds européen pour les investissements stratégiques » (FEIS) ayant sa propre capacité d’emprunt, qui permettrait de tripler les fonds d’origine publique. Les Etats pourraient aussi être mis à contribution et bénéficier, à ce titre et dans cette limite, d’un assouplissement des ratios budgétaires de Maastricht.
Le solde, soit environ 80 % du besoin de financement, est attendu de l’entreprise privée, par autofinancement ou, plus largement, par le biais de prêts bancaires, lesquels pourraient bénéficier de garanties publiques.
Les facilités consenties par la BCE aux banques européennes n’ayant pas suffi à relancer l’investissement privé, il s’agit de doper celui-ci par une participation du secteur public au risque, sous forme de cofinancement et de garanties de bonne fin. Cette participation s’imposera d’autant plus que les secteurs prioritaires d’investissement - efficacité énergétique, réseaux (transports, énergie, informatique, télécommunications), éducation et formation - ne sont pas nécessairement porteurs de rendements attractifs à court terme.
L’extrême réticence du marché à tirer actuellement parti des liquidités et des taux proposés par la BCE tendrait à montrer qu’il faudra déployer un large appareil de séduction pour faire naître les projets. Difficile exercice ! Si le curseur est trop bas (part du financement public trop faible, garanties publiques insuffisantes …), les projets ne sortiront pas. Si le curseur est trop haut, ils sortiront dans des conditions exagérément avantageuses pour l’entreprise privée. Une enquête de Médiapart (publiée le 16 novembre 2014) en donne un exemple : « La relance « made in Bruxelles » plombe la facture de gaz des Espagnols pour trente ans. C'est l'un des nouveaux mécanismes de financement public-privé censés relancer l'économie en Europe. Le premier « project bond » soutenu par la BEI a servi à la construction d'une réserve de gaz au large de l'Espagne. Mais après des séismes, le chantier est à l'arrêt. Et ce sont les espagnols qui vont indemniser l'entreprise. »
Le débat de fond sur ces financements « innovants » n’est pas d’ordre technique. Il est d’ordre politique : jusqu’où la puissance publique acceptera-t-elle de se dessaisir de sa souveraineté de décision quant au choix et aux modalités des projets, au profit de la sphère privée ? Jusqu’à quelles extrémités sa paupérisation budgétaire la conduira-t-elle ?
L’expérience des partenariats publics/privés (PPP) nous a montré que les « expédients » budgétaires pouvaient coûter fort cher dans la durée, aussi bien financièrement qu’en perte de contrôle sur des actifs ou des missions. Les dégâts des PPP sont tels au Royaume-Uni (qui a pris l’initiative de ces procédures en 1992) que le comité parlementaire au Trésor a pu écrire : « Le coût moyen du capital (d’un PPP) est de 8 %, le double des emprunts de l’Etat ». Quant à notre Cour des comptes, elle a conclu en octobre 2011 que « A périmètre comparable, la gestion publique semble moins onéreuse » et s’inquiète de la « soutenabilité budgétaire » de ces dispositifs.
Il fut un temps où l’Etat pouvait s’engager dans la définition et le financement autonomes de grands projets ou infrastructures. Chacun y trouvait son compte : la puissance publique, qui jouait pleinement son rôle de maître d’ouvrage ; l’entreprise qui négociait les marchés de réalisation des projets.
Mais l’Etat s’est délibérément placé sous la tutelle d’un nouveau maître que Montesquieu (L’esprit des lois) avait si bien débusqué : « Comme celui qui a l’argent est toujours le maître de l’autre, le traitant se rend despotique sur le prince même : il n’est pas législateur, mais il le force à donner des lois. »
Dans le cas présent, « celui qui a l’argent » n’est pas l’Etat et la faiblesse des moyens qu’il peut mobiliser est de nature à déséquilibrer les pouvoirs de négociation au profit de l’entreprise privée. Ce qui risque de sortir de tout cela, c’est encore la privatisation de domaines stratégiques et la « socialisation des pertes et privatisation des profits ».
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Les 315 milliards du « plan Juncker » : quel sera le prix à payer pour séduire les investisseurs ?
3 messages
• Page 1 sur 1
Re: Les 315 milliards du « plan Juncker » : quel sera le prix à payer pour séduire les investisseurs ?
Il faudra, sans doute, se rendre à l'évidence, tôt ou tard, que le respect du dogme néo-libéral ou du traité constitutif ne sortira pas l'Europe de l'ornière. Ou alors, reconnaissons l'émergence d'un curieux avatar du capitalisme où les profits resteront privés mais où les pertes seront de plus en plus socialisées. Si l'ont veut réduire la dette publique, le meilleur moyen n'est pas de l'exposer à un aléa supplémentaire. Pourquoi ne pas rendre impératif le respect d'un équilibre budgétaire hors investissements tout en permettant à la BCE d'effacer les compléments de dettes liés à la crise de 2008 et en lui donnant le pouvoir de geler, en pension, les excédents bancaires de masse financière ainsi créés, pour éviter les bulles spéculatives, et les réinjecter ensuite en fonction de l'évolution de la croissance ?
- KERHUNE
- Messages: 56
- Enregistré le: Mer 26 Oct 2011 19:59
Re: Les 315 milliards du « plan Juncker » : quel sera le prix à payer pour séduire les investisseurs ?
Pendant ce temps, " la Chine dessine la nouvelle finance mondiale ", comme le titre Le Monde Economie de ce jour (31 mars 2015).
Extraits :
" Il a suffi de quelques mois à la Chine pour remettre en cause le système financier international. Au 31 mars, échéance fixée par la Chine, près d’une quarantaine de pays, du Brésil à la Russie en passant par la France et le Danemark, ont fait part de leur volonté de participer en tant que membres fondateurs au projet de Banque asiatique d’investissement en infrastructures (BAII) lancé par la République populaire.
(...)
Pour faire campagne au nom de la nouvelle banque, la diplomatie chinoise a envoyé dans les chancelleries occidentales un haut fonctionnaire, Jin Liqun, fin connaisseur du système pour avoir été lui-même vice-président de la BAD. Il a notamment fait miroiter des sièges au conseil d’administration de la BAII à ceux qui s’engageraient les premiers : en principe, seuls trois sièges, sur les vingt prévus, seront réservés aux pays non asiatiques. L’argumentaire des Chinois pour justifier la création de la BAII repose sur un déficit présumé en infrastructures dans les pays asiatiques, estimé à 8 000 milliards de dollars dans un rapport de la BAD datant de 2010 : il serait nécessaire de le combler pour parvenir à une croissance soutenue de la région dans les décennies à venir. "
Voilà qui relativise la portée du " plan Juncker d'investissements " : 315 milliards d'euros en 3 ans, dont 21 milliards de fonds publics.
Pour en savoir plus : Le Monde
Extraits :
" Il a suffi de quelques mois à la Chine pour remettre en cause le système financier international. Au 31 mars, échéance fixée par la Chine, près d’une quarantaine de pays, du Brésil à la Russie en passant par la France et le Danemark, ont fait part de leur volonté de participer en tant que membres fondateurs au projet de Banque asiatique d’investissement en infrastructures (BAII) lancé par la République populaire.
(...)
Pour faire campagne au nom de la nouvelle banque, la diplomatie chinoise a envoyé dans les chancelleries occidentales un haut fonctionnaire, Jin Liqun, fin connaisseur du système pour avoir été lui-même vice-président de la BAD. Il a notamment fait miroiter des sièges au conseil d’administration de la BAII à ceux qui s’engageraient les premiers : en principe, seuls trois sièges, sur les vingt prévus, seront réservés aux pays non asiatiques. L’argumentaire des Chinois pour justifier la création de la BAII repose sur un déficit présumé en infrastructures dans les pays asiatiques, estimé à 8 000 milliards de dollars dans un rapport de la BAD datant de 2010 : il serait nécessaire de le combler pour parvenir à une croissance soutenue de la région dans les décennies à venir. "
Voilà qui relativise la portée du " plan Juncker d'investissements " : 315 milliards d'euros en 3 ans, dont 21 milliards de fonds publics.
Pour en savoir plus : Le Monde
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
3 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Notes du portail
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Jean-Claude Juncker entonne des cantiques dans un casino
par scripta manent » Jeu 13 Juin 2013 11:44 - 0 Réponses
- 3449 Vus
- Dernier message par scripta manent

Jeu 13 Juin 2013 11:44
- Jean-Claude Juncker entonne des cantiques dans un casino
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité