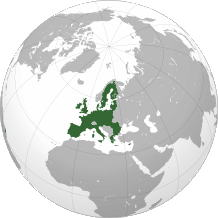Initiative de la société civile, le Tribunal Monsanto, qui est un tribunal d’opinion, a été établi en partant du constat qu’aucun outil juridique ne permet aujourd’hui de poursuivre la multinationale Monsanto en pénal pour ses activités dommageables pour l’environnement et la santé humaine. Quand elle est mise sur la défensive dans des actions au civil, cette société cherche à conclure un règlement à l’amiable pour éviter l’émergence d’une jurisprudence défavorable. Chaque année elle provisionne des sommes colossales pour faire face aux procès et tant qu’il demeurera plus profitable pour les actionnaires de faire courir des risques à la collectivité, ces pratiques subsisteront. Au delà de Monsanto, il s’agit de monter un procès exemplaire pour dénoncer toutes les multinationales ayant un comportement qui ignore les atteintes à la santé et à l’environnement causées par leurs activités. Même si le tribunal ne peut émettre qu’un avis consultatif, il a pour ambition d’influencer le droit international dans le sens d’une plus grande protection contre ces agissements.
Les audiences du tribunal, pendant lesquelles une trentaine de témoins et experts des cinq continents ont été auditionnés, se sont déroulées du 15 au 16 octobre 2016 à La Haye. Elles ont été présidées par cinq juges de renommée internationale qui ont rendu leur avis le 15 avril 2017. La société Monsanto, invitée à se défendre, n’a pas souhaité participer. Les arguments mis en avant par les juges dans leur avis s’appliquent aux activités de la société Monsanto dans le monde entier, et trouvent largement un écho en Europe, où les questions soulevées par les OGM et les substances présentes dans les produits Monsanto comme le glyphosate, font débat dans les instances européennes, ainsi qu’en témoignent plusieurs articles sur le site « citoyensunisdeurope.eu ».
Nous résumons ci-après les points essentiels de l’avis du tribunal, en prenant dans l’ordre les six questions posées aux juges :
1. Monsanto a –t-elle agi en conformité avec le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, reconnu en droit international des droits de l’homme (résolutions du conseil des Droits de l’Homme de l’ONU) ? Aujourd’hui 140 Etats ont consacré ce droit au niveau constitutionnel. Les audiences du Tribunal ont permis de recueillir des témoignages à propos d’impacts variés de produits Monsanto sur la santé humaine (notamment celle des agriculteurs), sur les sols, les plantes et organismes aquatiques, la santé animale et la biodiversité. Ont également été mis en lumière les impacts sur les communautés et peuples autochtones dans de nombreux pays, ainsi que l’absence d’information adéquate fournie à ces groupes par Monsanto. Sur la base de l’ensemble de ces constats, le Tribunal conclut que les activités de Monsanto ont un impact négatif sur le droit à un environnement sain.
2. Monsanto a-t-elle porté atteinte au droit à l’alimentation, reconnu notamment par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur les droits de l’enfant et la Convention sur l’élimination des discriminations contre les femmes ? Le Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif dans ce domaine, car elles affectent la disponibilité de l’alimentation pour les individus et les communautés et leur capacité à se nourrir eux-mêmes directement ou à choisir des semences non génétiquement modifiées. De plus, les semences génétiquement modifiées sont parfois inabordables pour les paysans et représentent une menace pour la biodiversité. Les activités de Monsanto causent des dommages aux sols, à l’eau et d’une manière générale à l’environnement. Le Tribunal conclut qu’il y a ainsi atteinte à la souveraineté alimentaire et souligne les cas où la contamination génétique de leurs champs par les cultures voisines a obligé les agriculteurs à payer des royalties à Monsanto, voire à abandonner leurs cultures non OGM. Il y a bien atteinte au droit à l’alimentation du fait d’un marketing agressif sur les OGM qui oblige les agriculteurs à racheter de nouvelles semences chaque année. C’est le modèle agro-industriel qui est dénoncé avec d’autant plus de vigueur qu’il existe d’autres modèles, tels que l’agroécologie, qui permettent de respecter le droit à l’alimentation.
3. Monsanto a-t-elle porté atteinte au droit au meilleur état de santé que toute personne est capable d’atteindre, reconnu par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention sur les droits de l’enfant ? Les témoignages ont fait état de graves malformations de naissance, du développement de lymphomes non Hodgkiniens, de l’existence de maladies chroniques, d’empoisonnement ou encore de décès suite à l’exposition environnementale aux produits Monsanto. Le Tribunal rappelle que Monsanto a produit et diffusé de nombreuses substances dangereuses telles que : a) le PCB, polluant organique persistant commercialisé exclusivement par cette société entre 1935 et 1979 alors même qu’elle avait connaissance de ses effets néfastes sur la santé et qui est maintenant interdit par la Convention de Stockholm ; b) le glyphosate (intégré dans le produit Roundup) considéré dans certaines études comme étant cancérigène alors que d’autres rapports concluent l’inverse et que l’OMS le considère comme « cancérigène probable ». Des documents internes de Monsanto rendus public en mars 2017 suite à la décision d’un tribunal californien ont montré que la société a manipulé les études scientifiques, ce qui vide de sa substance la prétendue controverse scientifique sur la dangerosité du glyphosate sur la santé ; c) le recours aux OGM puisqu’il n’existe pas de consensus scientifique sur leur innocuité sur la santé humaine. La controverse s’inscrit dans une opacité sur les études, voire l’absence de possibilité mener des études indépendantes en raison de l’influence exercée par Monsanto sur les experts. Le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit à l’alimentation, expert indépendant, en appelle à l’application du principe de précaution. Le Tribunal conclut que les pratiques de Monsanto ont un impact négatif sur le droit à la santé.
4. Monsanto a-t-elle porté atteinte à la liberté indispensable de la recherche scientifique reconnue par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ? Les témoignages d’agronomes et de biologistes moléculaires ont fait état de pratiques qui, pour certaines d’entre elles ont conduit à des condamnations en justice de Monsanto : des plantations illégales d’OGM, le recours à des études déformant les impacts négatifs du Roundup, des campagnes massives discréditant des résultats de recherches scientifiques indépendantes, le recours à de faux rapports scientifiques. Le Tribunal conclut que le comportement de Monsanto affecte négativement la liberté indispensable à la recherche scientifique.
5. Monsanto est-elle coupable de complicité de crimes de guerre par la fourniture de l’Agent Orange pendant la guerre du Vietnam ? Entre 1962 et 1973, plus de 7 millions de litres de cet exfoliant contenant de la dioxine ont été pulvérisés sur près de 2,6 millions d’hectares, causant d’importants dommages à la santé au sein de la population civile vietnamienne. Les dommages causés aux combattants américains et alliés ont fait l’objet d’actions en justice et conduit à la reconnaissance de la responsabilité notamment de Monsanto. En l’état actuel du droit international et en l’absence de preuves particulières étayant l’hypothèse formulée dans cette question, le Tribunal n’est pas en mesure d’y répondre de manière définitive. Néanmoins, il semble que la société savait à quoi ses produits allaient servir et détenait les informations sur les conséquences sanitaires et environnementales de leur déversement. Si le crime d’écocide devait être érigé à l’avenir au rang de crime de droit international, les faits rapportés pourraient relever de la compétence de la Cour pénale internationale.
6. Les faits attribués à Monsanto pourraient-ils relever du crime d’écocide (atteinte grave à l’environnement ou altération grave et durable des communaux globaux ou des services écosystémiques dont dépendent certains groupes humains) ? Malgré le développement du droit international de l’environnement qui vient étayer la progression d’une conscience selon laquelle l’atteinte à l’environnement est une atteinte aux valeurs sociétales les plus élevées, un fossé demeure avec la réalité de la protection en droit dont l’environnement bénéficie. Le Tribunal estime que le droit international doit désormais affirmer de manière précise et claire la protection de l’environnement et le crime d’écocide. Il conclut que si le crime d’écocide existait en droit international, alors les activités de Monsanto, comme celles décrites dans les réponses aux questions précédentes, pourrait relever de cette infraction.
Dans la dernière partie de son avis, le Tribunal lance deux appels : le premier concerne la nécessité d’affirmer la primauté du droit international des droits de l’homme et de l’environnement. En effet, il existe un ensemble de règles juridiques protégeant les droits des investisseurs dans le cadre de l’OMC, des traités bilatéraux d’investissement et dans les accords de libre échange. Ces dispositions tendent à rendre de plus en plus difficile pour les Etats de maintenir une protection des droits humains et de l’environnement. Il y a un besoin urgent pour les Nations-Unies d’agir, faute de quoi le recours aux tribunaux arbitraux résoudra des questions fondamentales en dehors du système onusien.
Le deuxième appel concerne la nécessité de tenir responsable des acteurs non-étatiques en droit international des droits de l’homme. Les multinationales doivent être considérées comme sujets de droit pouvant être poursuivis en cas d’atteinte aux droits fondamentaux. Une asymétrie entre les droits et obligations des multinationales est clairement identifiée et dénoncée par le Tribunal.
----
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Avis du Tribunal Monsanto
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités