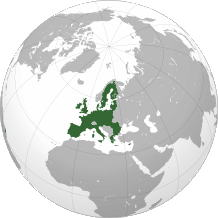Avec le creusement des inégalités de revenus et de patrimoines, une fraction de plus en plus large de la population, confrontée à la fois à une baisse de ses revenus, à une hausse du prix des biens de première nécessité (logement, alimentation, énergie) et à une restriction de l’accès au crédit, n’est plus guère en situation de répondre aux pressantes invitations à consommer dont nous sommes tous l’objet. Comment tirer parti d’un marché à faible capacité financière mais très étendu ? Telle est l’équation qu’ont cherché à résoudre certains « créatifs » du marketing.
Après la ménagère de 50 ans, l’adolescent, le 3ème âge … et bien d’autres « cibles », le « pauvre » est ainsi en passe de constituer, lui aussi, une catégorie identifiée et courtisée d’homo consommicus.
Comme à toute catégorie il faut un acronyme, celle-ci a écopé d’une sorte d’onomatopée : « BoP », pour « Bottom of Pyramid » (« Bas de la Pyramide »), quelque chose comme la « France d’en bas », mais sur le mode anglo-saxon, ce qui ne saurait étonner puisque la recrudescence des inégalités fait cortège à la mondialisation ultralibérale.
Une note d’analyse du CAS (Centre d’analyse stratégique, service du Premier ministre), publiée le 27 novembre 2012, apporte des informations et un éclairage assez particulier sur ce phénomène social, initialement circonscrit au « tiers monde », mais qui s’invite désormais dans nos contrées.
On y apprend que « certaines grandes entreprises développent des programmes originaux de lutte contre la pauvreté. Il s’agit de concilier des objectifs de rentabilité économique avec une finalité d’inclusion sociale en s’adressant aux personnes pauvres. Le “bas de la pyramide” (..) est ainsi vu comme un marché à conquérir, solvable et rentable dès lors que les entreprises adaptent leur production aux caractéristiques et demandes spécifiques des clients pauvres. À la différence des approches low cost, les démarches BoP entendent proposer les mêmes biens et le même niveau de services que dans le circuit classique. »
Cette introduction met d’emblée en relief les ambiguïtés du sujet. On nous parle de « lutte contre la pauvreté » alors que ce qui est exposé ensuite ne vise pas à améliorer le revenu des personnes concernées, mais plutôt à le capter « autrement ». La « finalité d’inclusion sociale » fait ici un curieux ménage avec l’objectif d’un « marché à conquérir, solvable et rentable ». Quant à « l’adaptation de la production aux caractéristiques et demandes spécifiques des clients pauvres » (les a-t-on consultés ?), en quoi consiste-t-elle puisqu’il s’agit de « proposer les mêmes biens et le même niveau de services que dans le circuit classique ». La suite du propos confirme que ce n’est pas si simple : « Le développement d’une offre spécifique pour les populations pauvres implique, d’une part, que l’entreprise mette sur pied un modèle économique dans lequel elle ne perd pas d’argent et, d’autre part, que les biens et services proposés soient suffisamment différenciés de l’offre classique pour prémunir l’entreprise contre les risques de cannibalisation de son modèle d’activité existant ». Eh oui, cruel dilemme !
Ces contorsions sémantiques reflètent l’extrême difficulté qu’il peut y avoir à accommoder à la sauce « sociale », une démarche dont les moteurs essentiels sont la recherche de parts de marché et la bonification de l’image de marque. S’attaquer aux pauvres (au marché des pauvres) en donnant à croire que l’on s’attaque à la pauvreté n’est pas une mince affaire. On peut comprendre que de grandes marques s’y emploient. On est par contre en droit de s’étonner que le CAS s’y laisse prendre, au point de répercuter sans façon les « éléments de langage » concoctés par les inventeurs de ce nouveau concept.
Sans doute le caractère acrobatique de cet exercice explique-t-il aussi les hermétismes et les affirmations gratuites qui émaillent la note : sur quoi l’auteur se fonde-t-il pour affirmer que « l’on (qui est ce « on » ?) constate que les entreprises ont progressivement transformé leurs modalités d’action pour montrer qu’elles prennent leur responsabilité sociale au sérieux. » ? Ce n’est pas parce qu’une question de société devient à la mode dans les colloques qu’elle est « prise au sérieux ». Il se peut en effet qu’elle y soit traitée de façon partiale et partielle, notamment lorsque des intérêts économiques mènent le jeu. Et que penser de ceci : « l’éducation des citoyens à la consommation donne de l’espace aux produits et services vendus par les entreprises. » ? La clé de cette formulation sibylline est ici : « Afin de convaincre les consommateurs des bienfaits des produits, il faudra concevoir des approches éducatives intelli¬gentes et se reposer sur des réseaux de conseil des consommateurs. ». (Enea - consulting, « Le marché BoP », février 2009). Susciter le besoin en quelque sorte …
L’auteur a notamment trouvé son inspiration dans les ouvrages de « deux enseignants dans des écoles de commerce nord-américaines », dont la conviction est que « les entreprises laissent de côté des millions de personnes pauvres, qui vivent avec moins de 1500 dollars par an, se privant ainsi d’un très large potentiel de croissance. Il s’agit en effet d’un marché énorme, évalué à 4 milliards de personnes, soit les deux tiers de la population mondiale, et 5000 milliards de chiffre d’affaires potentiel, selon un rapport de la Banque mondiale. » Voila qui a le mérite d’être clair, même si l’on mélange ici des situations bien différentes : le nouveau pauvre des pays développés et le paysan déraciné, échoué dans la banlieue d’une des mégalopoles africaines par exemple. Qu’importe, pourvu que tout cela fasse un « marché énorme », mûr pour le laminage économico-culturel.
Il s’agirait, nous dit-on « d’échapper à deux postures souvent rencontrées : du côté des organisations humanitaires, la dénonciation du profit au nom de la pureté éthique et, du côté des entreprises, une tendance à oublier une partie de l’humanité au motif qu’elle serait condamnée à la pauvreté. » Ainsi donc, les organisations humanitaires - qui d’ailleurs, pour la plupart, ne dénoncent pas le profit mais ses abus - se laisseraient aller à des « postures » malvenues ?
Parmi les solutions mises en œuvre dans les opérations de « conquête de marchés » qui nous sont présentées : « des conditionnements de petites quantités pour que les personnes puissent acheter au jour le jour, au gré de leurs rentrées d’argent. » Il serait intéressant de connaître l’incidence de cette politique sur la part du conditionnement dans le coût total du produit : acheter moins cher, fort bien, mais pas s‘il s’agit d’acheter des emballages plutôt que du contenu.
La note relève que, pour les pauvres, « les prix des biens et services (sont), à qualité de service équivalente, supérieurs à ceux pratiqués pour les riches. ». La double peine en somme. Ceci est bien connu pour le crédit. Ce peut être aussi le cas pour l’eau, du fait du non raccordement des quartiers de la misère aux réseaux collectifs. Mais la solution doit-elle être, comme dans l’exemple qui nous est donné, un approvisionnement des plus démunis en eau minérale qui, même « optimisé », reste coûteux et parcimonieux ou une politique économique et sociale évitant de transformer en prolétariat urbain les populations rurales réduites à la misère ? Et si un approvisionnement doit être organisé, ne doit-il pas plutôt résulter de la construction et de l’exploitation de réseaux publics, dans le cadre d’un aménagement raisonné du territoire ?
Double peine pour les uns. Double profit pour les autres : ce sont les mêmes intérêts qui, en amont, transforment le paysage et les conditions de vie des populations (concurrence des excédents agricoles des pays riches, substitution d’une agriculture spéculative aux cultures vivrières, déforestation, agrocarburants, …) et qui, en aval, leur proposent un accès sur mesure aux « bienfaits » de la société de consommation …
On apprend plus loin que cet « énorme marché » de 5.000 milliards de dollars annuels, pourrait n’être après tout que de « 440 milliards ». Quoiqu’il en soit, plutôt que d’un nouveau marché, dont on ne voit pas bien d’où il pourrait sortir puisque les populations concernées peuvent difficilement ne pas dépenser déjà la totalité de leur maigre revenu, sans doute vaudrait-il mieux parler d’un enjeu de répartition d’un marché existant, voire d’une simple problématique de communication. Il semble bien en effet que les questions d’image soient au cœur du dispositif : « certains auteurs soutiennent que les entreprises peuvent avoir intérêt à ne pas trop développer leurs actions BoP (..). L’idée consiste à dire que les externalités positives induites en termes d’image de marque, d’apprentissage organisationnel, de motivation des salariés, voire de fidélisation des clients traditionnels interviennent quelle que soit l’échelle du programme BoP. » Autrement dit : n’en faisons pas trop, juste ce qu’il faut pour bénéficier d’une communication « positive ».
A aucun moment la note du CAS n’évoque la problématique amont, à savoir la véritable lutte contre la pauvreté qui ne peut résulter que du respect des modes de vie à forte composante autarcique et/ou d’une hausse des revenus. L’émergence du business de la pauvreté ne peut être dissociée du contexte plus général de dérive de la pensée et du langage qui accompagne la prise de pouvoir de l’économique et du financier sur le politique et le social : à aucun moment, le CAS ne nous aura parlé des alternatives à cette parodie de solidarité, qui consiste à affamer les gens d’abord et à leur faire l’aumône ensuite. En un temps où nombreux sont ceux qui dénoncent le creusement des inégalités, au double titre qu’elles sont injustes et nuisibles à la « bonne marche des affaires », le CAS se contente ici de disserter sur la façon de s’en accommoder.
Qu’il y ait autour du « BoP » des expériences fondées sur l’authentique volonté de quelques-uns de promouvoir des solutions utiles est très probable. Mais elles ne pèsent pas lourd au regard d’une démarche qui, pour les grandes entreprises, est avant tout économique et cosmétique : se faire une place sur un marché peu solvable mais très étendu ; se présenter sous un jour avantageux au grand public, aux décideurs qui veulent bien s’y laisser prendre et à son propre personnel.
De façon générale, dans les grands groupes soumis à la pression du profit à court terme, les ravalements de façade de cette nature sont trop souvent des entreprises de récupération. Qu’ils soient roses (investissement éthique, commerce équitable …) ou verts (développement durable, …), les « labels » obtenus et affichés ne changent pas grand-chose à ce qui se passe en boutique : business as usual. Plus grave : en le travestissant, ils contribuent à la perpétuation d’un système qui génère la misère qu’ils prétendent soulager.
Tout juste l’auteur mentionne-t-il que « au-delà de la rentabilité purement économique des programmes, il faudrait aussi évaluer leur pertinence au regard de l’objectif (…). Contribuent-ils à l’objectif de lutte contre la pauvreté en permettant une meilleure intégration sociale de leurs clients-bénéficiaires ? Ont-ils tendance à augmenter ou diminuer le bien-être des personnes pauvres ? ». On se prend alors à espérer que le sujet va être abordé en profondeur.
Espoir déçu, car on passe immédiatement à la « promotion des partenariats entre entreprises et acteurs de la société civile afin de mieux cibler les besoins et les comportements de consommation des personnes situées au bas de la pyramide des revenus ; permettre un accès ciblé à ces personnes ; donner une plus forte légitimité aux entreprises privées qui souhaitent avoir un impact social. ».
Alors là, on se frotte les yeux : il s’agit en somme de mettre à contribution les organismes publics et associatifs pour qu’ils facilitent la définition des offres, servent d’intermédiaires avec les « cibles » (fourniture de fichiers et introductions ?) et participent à la promotion de l’image de marque « sociale » des entreprises …
C‘est ainsi que Danone, la Croix-rouge, deux Hauts commissariats du gouvernement (Solidarités actives contre la pauvreté et Jeunesse), la Caisse nationale d’allocations familiales, le groupe Chèque déjeuner et la Société française de pédiatrie ont participé conjointement à un projet permettant à des milliers de famille en dessous du seuil de pauvreté de bénéficier de bons de réduction sur l’achat de produits de la marque Blédina en supermarché, notamment de lait infantile mais aussi de plats cuisinés.
Fort bien, mais doit-on se satisfaire d’accueillir des familles au supermarché avec leurs « bons de réduction », où elles seront nécessairement repérées, étiquetées « pauvres », hommes, femmes et enfants … ? La dignité, n’est-ce pas aussi le droit de choisir ?
On nous assure que tout ceci a été fait « sans subvention de l’État (mais on semble ignorer que les services publics et associatifs ont un coût) et sans non plus aucun but lucratif pour l’instant. » Tout est dans le « pour l’instant ». Quel aurait été, pour le groupe Danone, le coût d’une campagne de prospection et de communication équivalente ? Compte tenu des enjeux du marché du lait infantile pour des entreprises comme Danone, et son concurrent Nestlé, on peut raisonnablement conjecturer que l’amour du prochain des animateurs du projet aura aussi trouvé sa récompense dans des retombées plus prosaïques (« et le reste vous sera donné par surcroît » …).
A l’occasion d’un séminaire organisé en décembre 2011 sur le thème « Quel rôle pour les entreprises dans la promotion de la cohésion sociale ? », le CAS évoquait l’opinion des Français sur cette question : « (Les entreprises) sont souvent oubliées dans la longue liste des acteurs de la cohésion sociale. Le récent baromètre de la cohésion sociale publié en juin 2011 en fournit une nouvelle illustration puisque seulement 1% des personnes interrogées considèrent que les entreprises sont bien placées pour améliorer la cohésion sociale. Sans surprise, c’est sur les pouvoirs publics - Etat et collectivités territoriales - que reposent les attentes de l’opinion en la matière. » Ce résultat, rassurant quant à la santé mentale de nos concitoyens, montre que, cette fois-ci, le petit chaperon rouge ne s’est pas laissé prendre : un loup déguisé reste un loup et personne, fut-ce un adepte du libéralisme à outrance, ne peut ignorer que les licenciements, plan sociaux, compressions salariales ou délocalisations ne sont pas des actions de « cohésion sociale ». Ce plébiscite n’en a pas moins dérouté les analystes du CAS, à en juger par cet addendum : « Pourtant, dans le même temps, 90 % des sondés estiment que la cohésion sociale contribue à améliorer la compétitivité économique d’un pays ». En quoi est-ce contradictoire ?
Pas découragé pour autant, le CAS conclue son analyse par cette proposition : « la question demeure celle de la possibilité de déployer des programmes BoP dans les pays développés. (…) Dans ces pays, l’établissement de partenariats avec les acteurs publics et la société civile constitue une autre voie pour proposer des services et des produits aux populations plus défavorisées. »
Il est donc décidément question, comme dans l’expérience « Danone » évoquée ci-avant, de soutenir aux plans public et associatif les initiatives des entreprises sur le marché des « BoP ».
A ce stade, il faut rappeler que le CAS, auteur de la note « d’analyse » que nous commentons, se présente comme suit : « placé auprès du Premier ministre, il a pour mission d'éclairer le gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques en matière économique, sociale, environnementale et technologique. »
Que le CAS fasse état de nouveaux comportements des grandes entreprises, on peut le comprendre. Mais certainement pas que cet « éclaireur du gouvernement » relaie sans discernement un discours fort ambigu, sans même nous épargner les subtilités du passage du « BoP 1.0 » au « BoP 2.0 », qui annonce « une nouvelle génération d’actions de lutte contre la pauvreté (…) dans laquelle le client est vu comme un partenaire à part entière de l’entreprise. »… Plus c’est gros, plus ça passe.
Et l’on nous dit que le CAS « préfigure, à la demande du Premier ministre, les principales réformes gouvernementales. » Tremblez bonnes gens.
Sur un sujet du même ordre : Philanthropie et business de la bonne conscience.
http://www.citoyensunisdeurope.eu/economie-et-societe/philanthropie-et-business-de-la-bonne-conscience-t29.html#p32
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
S'attaquer à la pauvreté ou s'attaquer aux pauvres ?
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers Notes du portail
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité