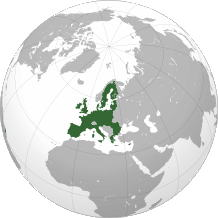En France, en matière d’énergie, c’est le débat sur le nucléaire qui occupe le devant de la scène. Le PS, qui avait déjà pris une position « molle » sur ce sujet pendant la campagne présidentielle, affiche sa désunion avec la déclaration récente d’Arnaud Montebourg, soutenu par Manuel Valls : « le nucléaire est une filière d’avenir ». Sous-entendu : les opposants à la filière sont des passéistes, des rêveurs. La vérité est que ce sont les pro nucléaires qui sont des rêveurs. Tant que l’on ne saura pas sécuriser l’énergie nucléaire, que ce soit en phase de production, de démantèlement ou de traitement des déchets, il est illusoire de penser que nous sommes à l’abri d’accidents dramatiques.
La sécurité nucléaire totale n’existe pas en l’état actuel des connaissances et technologies. Certains se sont rassurés en soutenant que Tchernobyl était le résultat d'une gabegie coupable, mais Fukushima est ensuite survenu dans un pays réputé pour sa technologie et son organisation.
Se satisfaire d’un degré « élevé » de sécurité revient à jouer avec les statistiques, dans un domaine où l'on ne devrait pourtant laisser aucune place au hasard. Concrètement, cela veut dire que si l’équipement est soumis à un évènement qui dépasse les seuils retenus, une catastrophe peut survenir. De tels calculs sont admissibles lorsque les dégâts prévisibles sont circonscrits à un petit périmètre. Ils ne le sont plus dans le cas des risques nucléaires.
En outre, ce niveau de sécurité supposé nous rassurer ne peut en pratique être maintenu que si tout un ensemble de conditions sont remplies : capacité financière à investir dans la conception, la fabrication et la maintenance des équipements ; organisation sans faille de l’exploitation. Rien de tout cela ne peut être garanti en tous temps et en tous lieux. Les privatisations soumettent les décisions à des arbitrages dans lesquels le profit a nécessairement sa part ; les crises soumettent les ressources publiques à de rudes contraintes ; elles peuvent entrainer le délitement ou le dévoiement des organisations et des pouvoirs (l'histoire abonde d'exemples en ce sens). Encore ne parlons-nous pas ici des risques de terrorisme et de prolifération de l’arme nucléaire. Rester assis sur ce volcan en arborant un sourire confiant n’est pas un signe de santé mentale.
Le temps des technocrates et des politiques se vit, pour la majorité d'entre eux, au rythme court des carrières et des élections. Le temps du nucléaire se compte lui en dizaines et centaines d'années, au cours desquelles bien des bouleversements peuvent survenir. Nous léguons les déchets "HAVL" (Haute Activité et Vie Longue) à quelques centaines de générations à venir. Le site http://www.dechets-radioactifs.com/defi-science-technique.html, de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, fournit une bonne illustration du discours lénifiant qui nous est servi par la technostructure du nucléaire. Sous le titre " Le défi de la science et de la technique " (tiens, c'est donc un défi ? ...), on y apprend que " De nombreuses recherches et études sont conduites pour concevoir des stockages pour les déchets les plus radioactifs ou ayant de longues durées de vie. Compte tenu de leur nature, ces déchets doivent être stockés dans des installations souterraines construites jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. L'enjeu : construire, exploiter et surveiller des centres de stockage souterrains et garantir leur sûreté à de telles profondeurs et sur des échelles de temps très longues... "
Qui peut prétendre savoir ce que seront les conditions environnementales, sociales, politiques à de tels horizons de temps ? Est-il admissible de raisonner en " enjeu " et de jeter des " défis " en pareille matière (fissile) ? Se rend-on compte que nous laissons ainsi à d'autres - nos successeurs sur la planète - le soin de relever ces défis ?
Les risques liés au nucléaire sont particulièrement impressionnants et médiatiques. On sait moins que la course aux ressources énergétiques vient aussi en concurrence avec les ressources alimentaires et hydrauliques de la planète.
Une guerre sournoise est en cours pour le partage des terres et de l’eau : au bénéfice de la production énergétique ou au bénéfice de la production alimentaire.
Elle se manifeste principalement sous deux formes : les agrocarburants et le gaz de schiste.
Les agrocarburants (abusivement qualifiés de biocarburants), qui contribuent très largement à la poursuite de la déforestation de la planète, détournent également des millions d’hectares de terres arables de la production agricole. Selon l’ONG Oxfam, ce sont 230 millions d’hectares (environ 4 fois la superficie totale de la France et 8 fois la surface de ses terres agricoles) qui auraient ainsi été convertis par des investisseurs depuis 2001 dans le monde. Les agrocarburants sont en outre extrêmement voraces en eau.
En ce qui concerne les gaz de schiste, Le Monde du 24 août nous apprend que, aux USA, « les sociétés de forage recherchent désespérément les milliers de mètres cubes d’eau nécessaires à la fracturation de la roche, ce qui les oppose maintenant aux fermiers qui essaient de conserver leurs précieuses ressources hydrauliques. »
La crise économique et financière a fait passer au second plan le débat environnemental.
A ce rythme, si les risques nucléaires nous épargnent, nous finirons affamés et assoiffés, mais largement pourvus de carburants pour nos véhicules climatisés.
Cet article est paru sur Le Monde.fr du 6 septembre 2012
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisés
18 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisé
Outre le court-termisme des dirigeants (qui les amène à caresser dans le sens du poil la majorité, ou à ne pas entrer en rupture avec une situation bien établie - dans notre cas, la dominance de l'électricité nucléaire en France), on ne peut écarter une suspicion d'influence significative de la part du lobby du nucléaire. De nombreux articles mettent en évidence la puissance de ce lobby, qui aurait par exemple réussi jusqu'ici à tuer dans l'oeuf tout émergence (et tout subventionnement digne de ce nom) d'une filière de production d'énergie renouvelable digne de ce nom. A long terme cela nous pénalisera sérieusement via-à-vis de nos voisins (Danemark, devenu leader mondial de l'éolien, mais aussi Allemagne).
Un de mes amis, éminent professeur de finances, me disait, il y a quelques mois : "La question n'est pas de probabiliser un accident nucléaire (car faible proba x fort coût = faible coût en espérance), mais de savoir si le pays pourrait survivre à une catastrophe nucléaire - c'est à dire regarder le coût total d'un tel accident". Il prédisait que si la France vivait un Tchernobyl (donc un accident), le pays (le gouvernement, l'Etat) n'y survivrait pas, le coût étant impossible à supporter...
Ce à quoi j'avais répondu : "On peut aussi prendre le problème sous l'angle du coût réel du kWh, lequel devrait comprendre le remboursement des sommes très lourdes investies par l'état pour développer le nucléaire (amortissement), le coût du traitement et du stockage des déchets, les coûts environnementaux (qui ne sont d'une façon générale que très rarement pris en compte), le coût de démantèlement futur des centrales, et... la prime de risque.
La prime de risque ? Supposons qu'on arrive à calculer ce qu'il en coûterait d'assurer le pays contre une catastrophe de type Fukushima en vallée du Rhone ou à Nogent sur Marne. Est-ce qu'une telle prime au kWh aurait un sens ? Autrement dit, est-on prêt à échanger notre vie actuelle perdue (évacuation totale et durable de Paris, par exemple) contre de l'argent ?
On notera d'ailleurs qu'en ce qui concerne Fukushima, le gouvernement japonais a reconnu récemment qu'il avait sérieusement envisagé la perte de Tokyo. Ca fait froid dans le dos..."
Enfin, j'en profite pour vous livrer un lien vers un article provocant : l'humanité sous-estime-t-elle le risque de sa propre extinction ? paru dans le monde du 13/03/12, et qui invite à la réflexion sur nos choix technologiques.
Un de mes amis, éminent professeur de finances, me disait, il y a quelques mois : "La question n'est pas de probabiliser un accident nucléaire (car faible proba x fort coût = faible coût en espérance), mais de savoir si le pays pourrait survivre à une catastrophe nucléaire - c'est à dire regarder le coût total d'un tel accident". Il prédisait que si la France vivait un Tchernobyl (donc un accident), le pays (le gouvernement, l'Etat) n'y survivrait pas, le coût étant impossible à supporter...
Ce à quoi j'avais répondu : "On peut aussi prendre le problème sous l'angle du coût réel du kWh, lequel devrait comprendre le remboursement des sommes très lourdes investies par l'état pour développer le nucléaire (amortissement), le coût du traitement et du stockage des déchets, les coûts environnementaux (qui ne sont d'une façon générale que très rarement pris en compte), le coût de démantèlement futur des centrales, et... la prime de risque.
La prime de risque ? Supposons qu'on arrive à calculer ce qu'il en coûterait d'assurer le pays contre une catastrophe de type Fukushima en vallée du Rhone ou à Nogent sur Marne. Est-ce qu'une telle prime au kWh aurait un sens ? Autrement dit, est-on prêt à échanger notre vie actuelle perdue (évacuation totale et durable de Paris, par exemple) contre de l'argent ?
On notera d'ailleurs qu'en ce qui concerne Fukushima, le gouvernement japonais a reconnu récemment qu'il avait sérieusement envisagé la perte de Tokyo. Ca fait froid dans le dos..."
Enfin, j'en profite pour vous livrer un lien vers un article provocant : l'humanité sous-estime-t-elle le risque de sa propre extinction ? paru dans le monde du 13/03/12, et qui invite à la réflexion sur nos choix technologiques.
- agénor
- Site Admin
- Messages: 287
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:12
Re: Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisé
Pour illustrer la sécurité tant vantée des installations nucléaires françaises voici un extrait de l'article "Les industriels mettent leurs ouvriers en danger délibérément" paru dans RUE89 sous la plume d'Alexandra Bogaert.
"Annie Thébaud-Mony a refusé la Légion d’honneur que Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, souhaitait lui accorder. Cette directrice de recherche honoraire à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) alerte depuis trente ans sur l’épidémie de cancers parmi les ouvriers. En vain. ...
…. Dans l’industrie nucléaire, 90% du travail de maintenance est fait par des entreprises sous-traitantes dont les employés supportent 80% à 90% de l’exposition aux rayonnements ionisants, dans des conditions de travail catastrophiques. On exige d’eux une grande flexibilité, une mobilité géographique forcée. Leurs conditions d’intervention s’aggravent, leur travail s’intensifie. Pour respecter des délais de plus en plus courts, ils peuvent enchaîner jusqu’au 20 heures de travail dans le bâtiment réacteur d’une centrale. On met donc en péril leur santé mais aussi la sûreté des installations nucléaires.
Quand on évoque le nucléaire, on parle des risques d’accident – présents avec ce mode de fonctionnement –, mais on n’évoque jamais les dizaines de milliers de salariés sacrifiés de cette filière, alors qu’un certain nombre d’entre eux est atteint de cancers entre 45 et 55 ans."
Voir l'article in extenso
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/09/04/les-industriels-mettent-en-danger-leurs-ouvriers-deliberement-235069
"Annie Thébaud-Mony a refusé la Légion d’honneur que Cécile Duflot, ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, souhaitait lui accorder. Cette directrice de recherche honoraire à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) alerte depuis trente ans sur l’épidémie de cancers parmi les ouvriers. En vain. ...
…. Dans l’industrie nucléaire, 90% du travail de maintenance est fait par des entreprises sous-traitantes dont les employés supportent 80% à 90% de l’exposition aux rayonnements ionisants, dans des conditions de travail catastrophiques. On exige d’eux une grande flexibilité, une mobilité géographique forcée. Leurs conditions d’intervention s’aggravent, leur travail s’intensifie. Pour respecter des délais de plus en plus courts, ils peuvent enchaîner jusqu’au 20 heures de travail dans le bâtiment réacteur d’une centrale. On met donc en péril leur santé mais aussi la sûreté des installations nucléaires.
Quand on évoque le nucléaire, on parle des risques d’accident – présents avec ce mode de fonctionnement –, mais on n’évoque jamais les dizaines de milliers de salariés sacrifiés de cette filière, alors qu’un certain nombre d’entre eux est atteint de cancers entre 45 et 55 ans."
Voir l'article in extenso
http://www.rue89.com/rue89-planete/2012/09/04/les-industriels-mettent-en-danger-leurs-ouvriers-deliberement-235069
- pierre
- Messages: 161
- Enregistré le: Dim 18 Sep 2011 15:58
Re: Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisé
Sur le même sujet, par Jean-Jacques Delfour, professeur de philosophie, ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud.
Paru sur Le Monde.fr du 7 septembre 2012.
" L'information commence à émerger : dans la centrale nucléaire de Fukushima, la piscine du réacteur 4, remplie de centaines de tonnes de combustible très radioactif, perchée à 30 mètres, au-dessus d'un bâtiment en ruine, munie d'un circuit de refroidissement de fortune, menace l'humanité d'une catastrophe pire encore que celle de Tchernobyl. Une catastrophe qui s'ajoute à celle de mars 2011 à Fukushima : 3 réacteurs percés qui déversent leur contenu mortel dans l'air, dans l'océan et dans la terre.
Les ingénieurs du nucléaire ne savent pas quoi faire face à tous ces problèmes. Ils ont déclamé que la sécurité, dans le nucléaire, était, est et sera totale, que, lorsqu'une catastrophe majeure a lieu, personne n'a de solution à proposer. Telle est l'effroyable vérité que révèle Fukushima. Tchernobyl avait été mis au compte de l'incompétence technique des Soviétiques. Impossible de resservir la même fable politique.
Si l'on fait usage de sa raison, il ne reste qu'une seule conclusion : l'incompétence des ingénieurs du nucléaire. En cas de panne du circuit de refroidissement, si l'échauffement du réacteur atteint un seuil de non-retour, il échappe au contrôle et devient un magma en fusion de radionucléides, de métal fondu et de béton désagrégé, très toxique et incontrôlable (le corium).
La vérité, posée par Three Miles Island, Tchernobyl et Fukushima, est que, une fois ce seuil franchi, les ingénieurs sont impuissants : ils n'ont pas de solution. Ils ont conçu et fabriqué une machine nucléaire mais ils ignorent quoi faire en cas d'accident grave, c'est-à-dire "hors limite". Ce sont des prétentieux ignorants : ils prétendent savoir alors qu'ils ne savent pas. Les pétroliers savent éteindre un puits de pétrole en feu, les mineurs savent chercher leurs collègues coincés dans un tunnel à des centaines de mètres sous terre, etc. Eux non, parce qu'ils ont décrété qu'il n'y aurait jamais d'accidents très graves.
Dans leur domaine, ils sont plus incompétents que les ouvriers d'un garage dans le leur. S'il faut changer le cylindre d'un moteur, les garagistes savent comment faire : la technologie existe. Si la cuve d'un réacteur nucléaire est percée et si le combustible déborde à l'extérieur, les "nucléaristes" ne savent pas ce qu'il faut faire. On objectera qu'une centrale nucléaire est plus complexe qu'une voiture. Certes, mais c'est aussi plus dangereux. Les ingénieurs du nucléaire devraient être au moins aussi compétents dans leur propre domaine que ceux qui s'occupent de la réparation des moteurs de voiture en panne : ce n'est pas le cas.
Le fait fondamental est là, affolant et incontestable : les radionucléides dépassent les capacités technoscientifiques des meilleurs ingénieurs du monde. Leur maîtrise est partielle et elle devient nulle en cas d'accident hors limite, là où on attendrait un surcroît de compétence : telle est la vérité, l'incontestable vérité. D'où l' aspect de devin à la boule de cristal des ingénieurs et des "spécialistes" du nucléaire. La contamination nucléaire ? Sans danger, affirment-ils, alors qu'ils n'en savent rien. L'état du réacteur détruit sous le sarcophage de Tchernobyl ? Stabilisé, clament-ils, alors qu'ils n'en savent rien. La pollution nucléaire dans l'océan Pacifique ? Diluée, soutiennent-ils, alors qu'ils n'en savent rien. Les réacteurs en ruine, percés, détruits, dégueulant le combustible dans le sous-sol de Fukushima ? Arrêtés à froid et sous contrôle, assurent-ils, alors qu'ils n'en savent rien.
Les effets des radionucléides disséminés dans l'environnement sur les générations humaines à venir ? Nuls, clament-ils, alors qu'ils n'en savent rien. L'état des régions interdites autour de Tchernobyl et Fukushima ? Sans nocivité pour la santé, aujourd'hui, comme pour des décennies, proclament-ils, alors qu'ils n'en savent rien. Pour qui les radiations sont-elles nocives ? Seulement pour les gens tristes, avancent-ils, alors qu'ils n'en savent rien. Ce sont des devins. L'art nucléaire est un art divinatoire. C'est-à-dire une tromperie.
Le nucléaire, qui s'annonçait comme la pointe avancée du savoir technoscientifique au point de se présenter comme une sorte de religion du savoir absolu, se révèle d'une faiblesse extrême non pas par la défaillance humaine mais par manque de savoir technoscientifique. Quelle que soit la cause contingente du dépassement du seuil de non-retour (attentat terroriste, inondation, séisme), l'incapacité de réparer et de contrôler la dissémination des radionucléides manifeste un trou dans le savoir qui menace la certitude de soi de la modernité. Les modernes prétendaient avoir rompu avec les conduites magiques. Le nucléaire est l'expérience d'une brutale blessure narcissique dans l'armature de savoir dont s'entoure l'homme moderne ; une souffrance d'autant plus grande que c'est sa propre invention qui le place en situation de vulnérabilité maximale.
En effet, le refus de considérer la possibilité réelle d'un accident hors limite a pour conséquence la négligence pratique et l'indisponibilité de fait des moyens techniques appropriés à ces situations hors limite. Ces moyens n'existent pas ; et personne ne sait si l'on peut les fabriquer. Peut-être qu'un réacteur en "excursion" est incontrôlable ou irrécupérable.
Je ne le sais pas et aucun "nucléariste" ne le sait; mais il est sûr que personne ne le saura jamais si l'on n'essaye pas de fabriquer ces outils techniques. Or l'affirmation d'infaillibilité empêche leur conception. Sans doute, ouvrir ce chantier impliquerait d'avouer une dangerosité jusqu'ici tue et de programmer des surcoûts jusque-là évités. Ainsi, l'infaillibilité des papes du nucléaire a plusieurs avantages : endormir les consciences et accroître les profits, du moins tant que tout va bien ; l'inconvénient majeur est de nous exposer sans aucun recours à des risques extrêmes.
Tout savoir scientifique ou technique est, par définition, incomplet et susceptible de modification. Affirmer l'infaillibilité d'un savoir technoscientifique ou se comporter comme si cette infaillibilité était acquise, c'est ignorer la nature du savoir et confondre celui-ci avec une religion séculière qui bannit le doute et nie l'échec. D'où l'effet psychotique de leurs discours (infaillibles et certains) et de leurs pratiques (rafistolages et mensonges). Tout observateur est frappé par cette contradiction et plus encore par son déni. Chacun est sommé d'un côté de leur reconnaître une science et une technique consommées et de l'autre côté de se taire malgré le constat de leur échec. Bref, le nucléaire rend fou. Mais ce n'est qu'un aspect de notre condition nucléaire. Contaminés de tous les pays, unissez-vous ! "
Paru sur Le Monde.fr du 7 septembre 2012.
" L'information commence à émerger : dans la centrale nucléaire de Fukushima, la piscine du réacteur 4, remplie de centaines de tonnes de combustible très radioactif, perchée à 30 mètres, au-dessus d'un bâtiment en ruine, munie d'un circuit de refroidissement de fortune, menace l'humanité d'une catastrophe pire encore que celle de Tchernobyl. Une catastrophe qui s'ajoute à celle de mars 2011 à Fukushima : 3 réacteurs percés qui déversent leur contenu mortel dans l'air, dans l'océan et dans la terre.
Les ingénieurs du nucléaire ne savent pas quoi faire face à tous ces problèmes. Ils ont déclamé que la sécurité, dans le nucléaire, était, est et sera totale, que, lorsqu'une catastrophe majeure a lieu, personne n'a de solution à proposer. Telle est l'effroyable vérité que révèle Fukushima. Tchernobyl avait été mis au compte de l'incompétence technique des Soviétiques. Impossible de resservir la même fable politique.
Si l'on fait usage de sa raison, il ne reste qu'une seule conclusion : l'incompétence des ingénieurs du nucléaire. En cas de panne du circuit de refroidissement, si l'échauffement du réacteur atteint un seuil de non-retour, il échappe au contrôle et devient un magma en fusion de radionucléides, de métal fondu et de béton désagrégé, très toxique et incontrôlable (le corium).
La vérité, posée par Three Miles Island, Tchernobyl et Fukushima, est que, une fois ce seuil franchi, les ingénieurs sont impuissants : ils n'ont pas de solution. Ils ont conçu et fabriqué une machine nucléaire mais ils ignorent quoi faire en cas d'accident grave, c'est-à-dire "hors limite". Ce sont des prétentieux ignorants : ils prétendent savoir alors qu'ils ne savent pas. Les pétroliers savent éteindre un puits de pétrole en feu, les mineurs savent chercher leurs collègues coincés dans un tunnel à des centaines de mètres sous terre, etc. Eux non, parce qu'ils ont décrété qu'il n'y aurait jamais d'accidents très graves.
Dans leur domaine, ils sont plus incompétents que les ouvriers d'un garage dans le leur. S'il faut changer le cylindre d'un moteur, les garagistes savent comment faire : la technologie existe. Si la cuve d'un réacteur nucléaire est percée et si le combustible déborde à l'extérieur, les "nucléaristes" ne savent pas ce qu'il faut faire. On objectera qu'une centrale nucléaire est plus complexe qu'une voiture. Certes, mais c'est aussi plus dangereux. Les ingénieurs du nucléaire devraient être au moins aussi compétents dans leur propre domaine que ceux qui s'occupent de la réparation des moteurs de voiture en panne : ce n'est pas le cas.
Le fait fondamental est là, affolant et incontestable : les radionucléides dépassent les capacités technoscientifiques des meilleurs ingénieurs du monde. Leur maîtrise est partielle et elle devient nulle en cas d'accident hors limite, là où on attendrait un surcroît de compétence : telle est la vérité, l'incontestable vérité. D'où l' aspect de devin à la boule de cristal des ingénieurs et des "spécialistes" du nucléaire. La contamination nucléaire ? Sans danger, affirment-ils, alors qu'ils n'en savent rien. L'état du réacteur détruit sous le sarcophage de Tchernobyl ? Stabilisé, clament-ils, alors qu'ils n'en savent rien. La pollution nucléaire dans l'océan Pacifique ? Diluée, soutiennent-ils, alors qu'ils n'en savent rien. Les réacteurs en ruine, percés, détruits, dégueulant le combustible dans le sous-sol de Fukushima ? Arrêtés à froid et sous contrôle, assurent-ils, alors qu'ils n'en savent rien.
Les effets des radionucléides disséminés dans l'environnement sur les générations humaines à venir ? Nuls, clament-ils, alors qu'ils n'en savent rien. L'état des régions interdites autour de Tchernobyl et Fukushima ? Sans nocivité pour la santé, aujourd'hui, comme pour des décennies, proclament-ils, alors qu'ils n'en savent rien. Pour qui les radiations sont-elles nocives ? Seulement pour les gens tristes, avancent-ils, alors qu'ils n'en savent rien. Ce sont des devins. L'art nucléaire est un art divinatoire. C'est-à-dire une tromperie.
Le nucléaire, qui s'annonçait comme la pointe avancée du savoir technoscientifique au point de se présenter comme une sorte de religion du savoir absolu, se révèle d'une faiblesse extrême non pas par la défaillance humaine mais par manque de savoir technoscientifique. Quelle que soit la cause contingente du dépassement du seuil de non-retour (attentat terroriste, inondation, séisme), l'incapacité de réparer et de contrôler la dissémination des radionucléides manifeste un trou dans le savoir qui menace la certitude de soi de la modernité. Les modernes prétendaient avoir rompu avec les conduites magiques. Le nucléaire est l'expérience d'une brutale blessure narcissique dans l'armature de savoir dont s'entoure l'homme moderne ; une souffrance d'autant plus grande que c'est sa propre invention qui le place en situation de vulnérabilité maximale.
En effet, le refus de considérer la possibilité réelle d'un accident hors limite a pour conséquence la négligence pratique et l'indisponibilité de fait des moyens techniques appropriés à ces situations hors limite. Ces moyens n'existent pas ; et personne ne sait si l'on peut les fabriquer. Peut-être qu'un réacteur en "excursion" est incontrôlable ou irrécupérable.
Je ne le sais pas et aucun "nucléariste" ne le sait; mais il est sûr que personne ne le saura jamais si l'on n'essaye pas de fabriquer ces outils techniques. Or l'affirmation d'infaillibilité empêche leur conception. Sans doute, ouvrir ce chantier impliquerait d'avouer une dangerosité jusqu'ici tue et de programmer des surcoûts jusque-là évités. Ainsi, l'infaillibilité des papes du nucléaire a plusieurs avantages : endormir les consciences et accroître les profits, du moins tant que tout va bien ; l'inconvénient majeur est de nous exposer sans aucun recours à des risques extrêmes.
Tout savoir scientifique ou technique est, par définition, incomplet et susceptible de modification. Affirmer l'infaillibilité d'un savoir technoscientifique ou se comporter comme si cette infaillibilité était acquise, c'est ignorer la nature du savoir et confondre celui-ci avec une religion séculière qui bannit le doute et nie l'échec. D'où l'effet psychotique de leurs discours (infaillibles et certains) et de leurs pratiques (rafistolages et mensonges). Tout observateur est frappé par cette contradiction et plus encore par son déni. Chacun est sommé d'un côté de leur reconnaître une science et une technique consommées et de l'autre côté de se taire malgré le constat de leur échec. Bref, le nucléaire rend fou. Mais ce n'est qu'un aspect de notre condition nucléaire. Contaminés de tous les pays, unissez-vous ! "
- voxpop
- Messages: 304
- Enregistré le: Ven 24 Fév 2012 11:41
Re: Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisé
Sur la question des agro-carburants, Le Monde.fr du 18 septembre 2012, nous informe que " dans un rapport intitulé " Les semences de la faim ", l'organisation humanitaire Oxfam appelle l'UE à renoncer à ses objectifs, actuels et futurs, en matière d'agrocarburants, estimant qu'ils ont poussé les prix alimentaires à la hausse. "
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2012-09-17/europes-thirst-biofuels-spells-hunger-millions-food-prices-shoot-up
http://www.oxfam.org/en/pressroom/pressrelease/2012-09-17/europes-thirst-biofuels-spells-hunger-millions-food-prices-shoot-up
- voxpop
- Messages: 304
- Enregistré le: Ven 24 Fév 2012 11:41
Re: Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisé
Même OXFAM dit encore les BIOcarburants au lieu des AGROcarburants !
Ne nous lassons pas d'enfoncer le clou : on ne peut les appeler BIO car les cultures produisant les soit-disant BIOcarburants emploient comme toute culture intensive moult engrais chimiques et pesticides, sans parler des ressources en eau et en énergie ...
Certes on peut dire qu'elles ont pris la place d'autres cultures intensives et que cela ne change donc rien de ce point de vue, mais en tout état de cause ON NE PEUT LES QUALIFIER DE BIO.
Pour peu que les journalistes et leurs interlocuteurs techniques et politiques veuillent prendre le recul nécessaire et changer le terme BIOcarburant qu'ils répandent (à quelques exceptions près) dans les media et colloques, ceux qui veulent entendre entendront et ceux qui ne font pas attention n'auront plus cette occasion de colporter un contresens à leur insu.
Quant à ceux qui le colportent volontairement, pour que cet accaparement de terres arables passe mieux, ils ont fait pression aux moments et dans les lieux opportuns pour que le terme BIOcarburant soit gravé dans le marbre des textes juridiques (à vérifier).
Or OXFAM ne saurait faire autrement que d'utiliser le terme juridiquement consacré, et le piège est refermé ...
Mais FIAT LUX , vous direz désormais AGROcarburants !
Ne nous lassons pas d'enfoncer le clou : on ne peut les appeler BIO car les cultures produisant les soit-disant BIOcarburants emploient comme toute culture intensive moult engrais chimiques et pesticides, sans parler des ressources en eau et en énergie ...
Certes on peut dire qu'elles ont pris la place d'autres cultures intensives et que cela ne change donc rien de ce point de vue, mais en tout état de cause ON NE PEUT LES QUALIFIER DE BIO.
Pour peu que les journalistes et leurs interlocuteurs techniques et politiques veuillent prendre le recul nécessaire et changer le terme BIOcarburant qu'ils répandent (à quelques exceptions près) dans les media et colloques, ceux qui veulent entendre entendront et ceux qui ne font pas attention n'auront plus cette occasion de colporter un contresens à leur insu.
Quant à ceux qui le colportent volontairement, pour que cet accaparement de terres arables passe mieux, ils ont fait pression aux moments et dans les lieux opportuns pour que le terme BIOcarburant soit gravé dans le marbre des textes juridiques (à vérifier).
Or OXFAM ne saurait faire autrement que d'utiliser le terme juridiquement consacré, et le piège est refermé ...
Mais FIAT LUX , vous direz désormais AGROcarburants !
- pierre
- Messages: 161
- Enregistré le: Dim 18 Sep 2011 15:58
Re: Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisé
Ne devrait-on pas écrire à OXFAM pour attirer leur attention sur ce point ?
- agénor
- Site Admin
- Messages: 287
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:12
Re: Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisé
Suite à la parution de notre article sur Le Monde.fr, le 6 septembre 2012, sous le titre " Le risque nucléaire peut-il nous affamer, assoiffer ? ", l'ANDRA (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) nous a répondu :
" Concernant le stockage des déchets à vie longue, c’est précisément parce que l’on ne peut prédire à long terme les conditions environnementales, sociales, politiques et que l’on ne veut pas transmettre aux générations futures la responsabilité de la gestion de ces déchets que le stockage profond est la solution de gestion retenue par la France.
En effet, la roche dans laquelle devraient être stockés ces déchets permettra de protéger l’homme et l’environnement le temps nécessaire à ce que leur radioactivité décroisse, et ce, sans intervention humaine. Ces explications sont précisément détaillées sur le site http://www.dechets-radioactifs.com où chacun pourra juger si le discours est « lénifiant »… ou pas. "
Ce à quoi nous avons répondu :
" Merci de participer au débat, mais vous vous contredisez. "Protéger sans intervention humaine" dîtes-vous dans votre réaction. Pourquoi votre site parle-t-il alors de "construire", mais aussi "exploiter et surveiller ? Nous ne pouvons avoir aucune garantie que cette exploitation et cette surveillance seront opérées de façon sérieuse " sur des échelles de temps très longues ", sans parler même des risques liés aux accès de folie dont l'humanité nous a donné de multiples exemples. "
On peut bien sûr discuter le mot " lénifiant ". " Anesthésiant " peut-être ?
" Concernant le stockage des déchets à vie longue, c’est précisément parce que l’on ne peut prédire à long terme les conditions environnementales, sociales, politiques et que l’on ne veut pas transmettre aux générations futures la responsabilité de la gestion de ces déchets que le stockage profond est la solution de gestion retenue par la France.
En effet, la roche dans laquelle devraient être stockés ces déchets permettra de protéger l’homme et l’environnement le temps nécessaire à ce que leur radioactivité décroisse, et ce, sans intervention humaine. Ces explications sont précisément détaillées sur le site http://www.dechets-radioactifs.com où chacun pourra juger si le discours est « lénifiant »… ou pas. "
Ce à quoi nous avons répondu :
" Merci de participer au débat, mais vous vous contredisez. "Protéger sans intervention humaine" dîtes-vous dans votre réaction. Pourquoi votre site parle-t-il alors de "construire", mais aussi "exploiter et surveiller ? Nous ne pouvons avoir aucune garantie que cette exploitation et cette surveillance seront opérées de façon sérieuse " sur des échelles de temps très longues ", sans parler même des risques liés aux accès de folie dont l'humanité nous a donné de multiples exemples. "
On peut bien sûr discuter le mot " lénifiant ". " Anesthésiant " peut-être ?
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisé
Sur Le Monde.fr du 1er octobre 2012 :
" Les défaillances de sécurité des 19 centrales nucléaires françaises pointées par Bruxelles "
Extraits :
" Les contrôles de sécurité systématiques menés par l'Union européenne ont révélé des défaillances de sécurité dans l'ensemble des centrales nucléaires françaises, affirme lundi 1er octobre Le Figaro, citant "un bilan encore confidentiel". Les dix-neuf installations de l'Hexagone "manquent d'instruments de mesure sismique adaptés aux exigences post-Fukushima", note le quotidien sur son site Internet.
Ces carences avaient déjà été pointées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) française dans son long rapport publié en juin et imposant des milliers de prescriptions aux exploitants.
(...)
D'après le journal, le parc français doit revoir ses dispositifs pour "les scénarios extrêmes envisagés par Bruxelles : tremblement de terre, inondations, résistance par conception à des secousses ou à des impacts comme la chute d'un avion".
Selon le journal allemand Die Welt, qui dit avoir consulté ce rapport, le commissaire européen chiffre à 25 milliards d'euros les travaux de mise en conformité rendus nécessaires par les contrôles qui ont fait apparaître des "centaines d'insuffisances".
La Commission européenne peut faire des recommandations, mais elles sont non contraignantes, a insisté Mme Holzner. "Nous allons voir s'ils suivent nos recommandations ou pas". L'UE compte 147 réacteurs dans 14 pays, dont 58 en France. Et 24 nouveaux réacteurs sont en projet, dont six sont déjà en construction : deux en Bulgarie, deux en Slovaquie, un en Finlande et un en France. "
Bien sûr, c'est l'objet même d'un système de contrôle de sécurité que de relever les défaillances, petites si possible avant qu'elles deviennent grosses ...
Mais on peut tout de même retenir de ce rapport de Bruxelles que les centrales françaises sont à revoir (???) si l'on veut qu'elles résistent à des évènements tels que " tremblement de terre, inondations, (...) secousses ou (...) chute d'un avion. "
En somme, tout cela est sécurisé sauf en cas d'évènement exceptionnel. On s'en doutait un peu.
Et le terrorisme ?
Pour accéder à l'article : http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/10/01/les-defaillances-de-securite-des-19-centrales-nucleaires-francaises-pointees-par-bruxelles_1768510_3244.html
On y trouvera notamment un lien avec le rapport de l'ASN.
" Les défaillances de sécurité des 19 centrales nucléaires françaises pointées par Bruxelles "
Extraits :
" Les contrôles de sécurité systématiques menés par l'Union européenne ont révélé des défaillances de sécurité dans l'ensemble des centrales nucléaires françaises, affirme lundi 1er octobre Le Figaro, citant "un bilan encore confidentiel". Les dix-neuf installations de l'Hexagone "manquent d'instruments de mesure sismique adaptés aux exigences post-Fukushima", note le quotidien sur son site Internet.
Ces carences avaient déjà été pointées par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) française dans son long rapport publié en juin et imposant des milliers de prescriptions aux exploitants.
(...)
D'après le journal, le parc français doit revoir ses dispositifs pour "les scénarios extrêmes envisagés par Bruxelles : tremblement de terre, inondations, résistance par conception à des secousses ou à des impacts comme la chute d'un avion".
Selon le journal allemand Die Welt, qui dit avoir consulté ce rapport, le commissaire européen chiffre à 25 milliards d'euros les travaux de mise en conformité rendus nécessaires par les contrôles qui ont fait apparaître des "centaines d'insuffisances".
La Commission européenne peut faire des recommandations, mais elles sont non contraignantes, a insisté Mme Holzner. "Nous allons voir s'ils suivent nos recommandations ou pas". L'UE compte 147 réacteurs dans 14 pays, dont 58 en France. Et 24 nouveaux réacteurs sont en projet, dont six sont déjà en construction : deux en Bulgarie, deux en Slovaquie, un en Finlande et un en France. "
Bien sûr, c'est l'objet même d'un système de contrôle de sécurité que de relever les défaillances, petites si possible avant qu'elles deviennent grosses ...
Mais on peut tout de même retenir de ce rapport de Bruxelles que les centrales françaises sont à revoir (???) si l'on veut qu'elles résistent à des évènements tels que " tremblement de terre, inondations, (...) secousses ou (...) chute d'un avion. "
En somme, tout cela est sécurisé sauf en cas d'évènement exceptionnel. On s'en doutait un peu.
Et le terrorisme ?
Pour accéder à l'article : http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2012/10/01/les-defaillances-de-securite-des-19-centrales-nucleaires-francaises-pointees-par-bruxelles_1768510_3244.html
On y trouvera notamment un lien avec le rapport de l'ASN.
- voxpop
- Messages: 304
- Enregistré le: Ven 24 Fév 2012 11:41
Re: Affamés, assoiffés et peut-être irradiés, mais climatisé
Sous le titre " Terres agricoles, la grande braderie africaine continue ", le journal " Jeune Afrique " apporte un complément d'information sur cette question de l'accaparement des terres, principalement à destination des agrocarburants (abusivement dénommés ici, une fois de plus, " biocarburants ").
Extraits :
" De l’aveu même de la Banque mondiale, cela pourrait devenir le fléau du XXIe siècle. En attente d'un mode de régulation internationale, le phénomène de l’accaparement des terres nuit gravement aux agriculteurs africains. En cause : la hausse des prix des produits alimentaires et la demande croissante en bio-carburants.
Le phénomène n’est pas nouveau. Accentué par la crise économique et la flambée des prix alimentaires en 2008, l’achat de terres arables a atteint des proportions gigantesques en Afrique. En dix ans, sur la totalité du continent, les superficies concernées atteignent la taille du Kenya. Un exemple frappant : quelque 30% des terres du Liberia ont été attribués sous forme de concessions à des investisseurs étrangers !
« Les transactions foncières ont triplé lors de la crise des prix alimentaires en 2008 et 2009 », note Oxfam, dans un rapport paru au début d'octobre. En cause : le prix du blé, notamment, qui avait atteint un record absolu le 9 mars 2008, à 295 euros la tonne sur le marché européen. Et le scénario pourrait se répéter. Les cours ont une nouvelle fois flambé en août 2012 et les perspectives déficitaires en céréales pour l'année sont inquiétantes. Oxfam réclame donc des « mesures urgentes pour désamorcer la menace d'une nouvelle vague d'accaparements de terres ».
Des mesures pourraient être mises en place par la Banque mondiale, selon l’organisation humanitaire. Oxfam a ainsi demandé, en marge d’un sommet Banque mondiale/FMI à Tokyo, le 10 août, un gel de tous les investissements agricoles, afin de mettre en place les mécanismes de surveillances et de transparence.
La Banque mondiale a cependant aussitôt refusé. Et pour cause, l'institution de Washington joue un rôle de conseiller auprès des pays en développement mais surtout celui d'investisseur foncier : ses prises de participation dans l'agriculture ont augmenté de 200% ces dix dernières années. « Prendre une telle mesure [le gel des investissements, NDLR] n’aiderait pas à réduire les cas de pratiques abusives et dissuaderait vraisemblablement les investisseurs d’appliquer des normes élevées », justifie la banque, qui reconnaît que des « politiques de sauvegarde environnementales et sociales » devraient cependant être mises en place.
Mais le temps risque de manquer. Alors que la flambée des prix alimentaires s'accentue, les mesures décidées en mai par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, issu de la FAO, qui visent à encadrer davantage les investissements, ne sont pas encore en état de fonctionner. Les pouvoirs africains ont toutefois tout intérêt à ne pas laisser ces projets se transformer en vœux pieux.
Entre 2007 et 2011, selon la société Trendeo, 45 millions d’hectares ont fait l’objet d’une transaction en Afrique subsaharienne. Dont deux-tiers l’ont été suite à des achats de terres destinées au secteur du bio-carburant. Or ces acquisitions ne sont pas sans conséquence sur les populations d’Afrique.
Au Mali, l'État, faute de moyens, a cédé quelque 100 000 hectares à la Libye, dans le cadre du projet Malibya en 2008, au sud-est du pays. Bamako fournit les terres et Tripoli apporte les capitaux pour les aménager et les mettre en valeur. Un projet gagnant-gagnant donc. Mais uniquement en apparence. Depuis, les associations de défense des paysans ont dénoncé des expulsions forcées et non indemnisées (voir le reportage vidéo ci-dessous). Sans contrôles efficaces, dans les investissements étrangers, ce sont presque toujours les paysans qui paient le prix fort. "
Pour consulter l'article, sur le site de " Jeune Afrique " :
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121012161515/libye-mali-agriculture-banque-mondialeterres-agricoles-la-grande-braderie-africaine-continue.html
On y trouvera notamment des statistiques et graphiques éclairants.
Extraits :
" De l’aveu même de la Banque mondiale, cela pourrait devenir le fléau du XXIe siècle. En attente d'un mode de régulation internationale, le phénomène de l’accaparement des terres nuit gravement aux agriculteurs africains. En cause : la hausse des prix des produits alimentaires et la demande croissante en bio-carburants.
Le phénomène n’est pas nouveau. Accentué par la crise économique et la flambée des prix alimentaires en 2008, l’achat de terres arables a atteint des proportions gigantesques en Afrique. En dix ans, sur la totalité du continent, les superficies concernées atteignent la taille du Kenya. Un exemple frappant : quelque 30% des terres du Liberia ont été attribués sous forme de concessions à des investisseurs étrangers !
« Les transactions foncières ont triplé lors de la crise des prix alimentaires en 2008 et 2009 », note Oxfam, dans un rapport paru au début d'octobre. En cause : le prix du blé, notamment, qui avait atteint un record absolu le 9 mars 2008, à 295 euros la tonne sur le marché européen. Et le scénario pourrait se répéter. Les cours ont une nouvelle fois flambé en août 2012 et les perspectives déficitaires en céréales pour l'année sont inquiétantes. Oxfam réclame donc des « mesures urgentes pour désamorcer la menace d'une nouvelle vague d'accaparements de terres ».
Des mesures pourraient être mises en place par la Banque mondiale, selon l’organisation humanitaire. Oxfam a ainsi demandé, en marge d’un sommet Banque mondiale/FMI à Tokyo, le 10 août, un gel de tous les investissements agricoles, afin de mettre en place les mécanismes de surveillances et de transparence.
La Banque mondiale a cependant aussitôt refusé. Et pour cause, l'institution de Washington joue un rôle de conseiller auprès des pays en développement mais surtout celui d'investisseur foncier : ses prises de participation dans l'agriculture ont augmenté de 200% ces dix dernières années. « Prendre une telle mesure [le gel des investissements, NDLR] n’aiderait pas à réduire les cas de pratiques abusives et dissuaderait vraisemblablement les investisseurs d’appliquer des normes élevées », justifie la banque, qui reconnaît que des « politiques de sauvegarde environnementales et sociales » devraient cependant être mises en place.
Mais le temps risque de manquer. Alors que la flambée des prix alimentaires s'accentue, les mesures décidées en mai par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale, issu de la FAO, qui visent à encadrer davantage les investissements, ne sont pas encore en état de fonctionner. Les pouvoirs africains ont toutefois tout intérêt à ne pas laisser ces projets se transformer en vœux pieux.
Entre 2007 et 2011, selon la société Trendeo, 45 millions d’hectares ont fait l’objet d’une transaction en Afrique subsaharienne. Dont deux-tiers l’ont été suite à des achats de terres destinées au secteur du bio-carburant. Or ces acquisitions ne sont pas sans conséquence sur les populations d’Afrique.
Au Mali, l'État, faute de moyens, a cédé quelque 100 000 hectares à la Libye, dans le cadre du projet Malibya en 2008, au sud-est du pays. Bamako fournit les terres et Tripoli apporte les capitaux pour les aménager et les mettre en valeur. Un projet gagnant-gagnant donc. Mais uniquement en apparence. Depuis, les associations de défense des paysans ont dénoncé des expulsions forcées et non indemnisées (voir le reportage vidéo ci-dessous). Sans contrôles efficaces, dans les investissements étrangers, ce sont presque toujours les paysans qui paient le prix fort. "
Pour consulter l'article, sur le site de " Jeune Afrique " :
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20121012161515/libye-mali-agriculture-banque-mondialeterres-agricoles-la-grande-braderie-africaine-continue.html
On y trouvera notamment des statistiques et graphiques éclairants.
- pierre
- Messages: 161
- Enregistré le: Dim 18 Sep 2011 15:58
18 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Notes du portail
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité