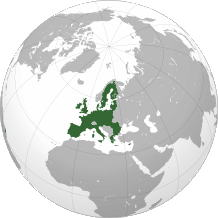Mobilisations citoyennes contre le Grand Marché Transatlantique (GMT)
Sous le titre « Ces Européens qui défient le libre-échange » Le Monde Diplomatique publie dans son numéro d’octobre 2015 un article qui fait le point sur la résistance aux négociations entre l’UE et les USA autour du projet de marché transatlantique (GMT ou TTIP ou encore TAFTA). Les auteurs sont des militants anti-GMT.
Résumé :
Les deux principales armes des militants anti-GMT sont (i) le vote par une collectivité territoriale d’une motion la mettant « hors TAFTA » et (ii) l’utilisation de l’ICE (Initiative collective européenne) – instrument de démocratie directe sous forme de pétition, introduit par le Traité de Lisbonne, permettant à de simples citoyens de l’UE (à condition de réunir un million de signatures en provenance d’au moins sept pays) d’initier auprès des instances européennes une proposition d’acte juridique.
Zones hors TAFTA :
Cette forme de protestation est née au début des années 2000 contre les négociations sur l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) dans le cadre de l’OMC. Ces négociations, comme celles autour du TAFTA ont duré plusieurs années dans une grande opacité. La campagne avait alors pris une ampleur inattendue : 816 collectivités locales et 20 des 22 régions de France se sont déclarées « zones hors AGCS ».
Le 14 février 2014, le Conseil Régional d’Ile-de-France vote une motion demandant l’arrêt des négociations sur le GMT « du fait de l’absence de contrôle démocratique et de débat public » et se déclare « zone hors TTIP ». Depuis, près de 500 collectivités territoriales françaises de toute taille représentant 54% de la population ont fait de même. C’est un acte symbolique, puisque les accords internationaux engagent juridiquement tous les échelons institutionnels des Etats membres. Cependant ces motions « zone hors TAFTA » permettent de mobiliser les élus autour de questions très sensibles pour les municipalités (emploi, services publics, environnement, irruption d’entreprises américaines sur les marchés publics locaux…) et les militants anti-TAFTA espèrent que le débat de proximité pourra percoler dans les appareils politiques nationaux.
L’Allemagne compte 228 « zones hors TAFTA » dont Cologne, Leipzig et Munich, l’Autriche 260, la Belgique 82 dont Bruxelles, le Royaume-Uni 21 dont Edimbourg et Bristol. Pour l’instant, la mobilisation reste plus limitée en Italie (néanmoins les villes de Milan et Ancône sont « zones hors TAFTA ») et en Espagne.
ICE :
230 organisations d’une vingtaine de pays ont lancé une pétition en juin 2014, pour demander au Conseil européen d’abroger le mandat de négociation du GMT et de ne pas conclure l’autre traité de libre-échange en cours avec le Canada. En septembre 2014, la Commission a fait savoir qu’elle estimait que l’ouverture des négociations n’était qu’un acte préparatoire, et non un acte juridique entrant dans le champ légal d’une ICE. Les promoteurs de la pétition contestent cette décision devant la Cour de Justice de l’UE et poursuivent leur action.
Regroupant actuellement plus de 480 organisations, ils se sont fixé comme objectif de réunir 3 millions de signatures avant le 6 octobre 2015. Un seuil par pays (nombre minimal de signatures pour qu’une ICE soit valide) est défini en fonction du nombre d’habitants (55 500 pour la France, par exemple). En juillet 2015, ce seuil avait été atteint ou dépassé dans 18 pays de l’UE et en septembre 2015, 2,6 millions de signatures avaient été rassemblées. Au même titre qu’une motion « hors TAFTA », l’utilité première de cette pétition reste sa portée mobilisatrice et éducative.
Au niveau du Parlement européen, les tractations secrètes entre l’UE et les USA ont été avalisées le 8 mai 2015. Cependant, lorsque l’assemblée a été appelée à se prononcer le 8 juillet 2015, notamment sur l’inclusion dans le traité du mécanisme arbitral de règlement des différends entre les États et les entreprises, qui est un des points les plus contestés du contenu, aucune majorité n’a pu être dégagée. Pour l’obtenir, il a fallu que le Président du Parlement présente une proposition modifiée concernant ce mécanisme, avec des juges professionnels désignés par les pouvoirs publics et une possibilité de faire appel de leurs décisions. Il semblerait que la pression sur les eurodéputés de la mobilisation anti-GMT commence à se faire sentir.
Néanmoins, cette mobilisation se heurte à plusieurs difficultés : son maintien dans la durée qui est celle des négociations et de l’entrée en vigueur graduelle du GMT ; le secret des négociations et le manque d’avancées significatives pour canaliser la protestation ; le fait que seul le Conseil européen (des chefs d’Etat et de gouvernement) a les moyens d’arrêter les négociations mais que, même dans les pays où les citoyens se sont massivement prononcés contre le projet de GMT, comme l’Allemagne ou l’Autriche, aucun gouvernement à l’heure actuelle ne veut prendre la responsabilité de le faire.
----
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Mobilisations citoyennes contre le Grand Marché Transatlantique
5 messages
• Page 1 sur 1
Re: Mobilisations citoyennes contre le Grand Marché Transatlantique
Le collectif « Stop TTIP » annonce dans son bulletin d’information http://www.stop-ttip.org qu’après une année de collecte de signatures pour son ICE, la pétition a récolté 3 263 920 signatures grâce à la mobilisation de plus de 500 organisations. Les signatures ont été présentées symboliquement à un représentant de la Commission devant la presse. Les prochaines étapes seront d’organiser des journées de mobilisation (dont deux journées le 10 et 17 octobre 2015 à Paris), pour sensibiliser encore plus le public européen, d’exercer une pression accrue sur les parlementaires européens pour qu’ils ne ratifient ni le TTIP ni le CETA , et un soutien aux demandes de référendum dans les différents pays.
- rousski
- Messages: 17
- Enregistré le: Mer 16 Sep 2015 17:24
Re: Mobilisations citoyennes contre le Grand Marché Transatlantique
Hier à Strasbourg, dans le cadre de sa position sur le budget 2016 le Parlement a voté la continuation d'un projet pilote intitulé (accrochez-vous)
Bon ou mauvais signe?...Crédits relativement modestes (200.000 euros) pour un titre aussi ambitieux...
La Commission avait indiqué en juin 2015 dans un document de travail (page 93) accompagnant le projet de budget 2016 comment elle entend mettre en œuvre les crédits déjà inscrits pour ce même projet au budget 2015.
La lecture du document éclaire un peu notre lanterne: il s'agit d'analyses, d'études, de réunions...et d'un "dialogue"...le ton est plutôt condescendant, aïe... On y lit également que la mise en œuvre commencera début 2016, compte-tenu notamment des délais d'appel d'offres.
Document de travail qui n'est malheureusement disponible qu'en anglais:
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2016/DB/DB2016_WDIV_en.pdf
Établir l’équilibre entre le droit d’un État de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, les droits des investisseurs à la protection de leurs investissements et les droits des citoyens en matière d’environnement et de santé publique dans le cadre du partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP)
Bon ou mauvais signe?...Crédits relativement modestes (200.000 euros) pour un titre aussi ambitieux...
La Commission avait indiqué en juin 2015 dans un document de travail (page 93) accompagnant le projet de budget 2016 comment elle entend mettre en œuvre les crédits déjà inscrits pour ce même projet au budget 2015.
La lecture du document éclaire un peu notre lanterne: il s'agit d'analyses, d'études, de réunions...et d'un "dialogue"...le ton est plutôt condescendant, aïe... On y lit également que la mise en œuvre commencera début 2016, compte-tenu notamment des délais d'appel d'offres.
Document de travail qui n'est malheureusement disponible qu'en anglais:
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/2016/DB/DB2016_WDIV_en.pdf
- Oufti
- Messages: 21
- Enregistré le: Ven 30 Déc 2011 00:02
Re: Mobilisations citoyennes contre le Grand Marché Transatlantique
Dans son bulletin d'information du 20 janvier 2016, le collectif Stop TTIP se félicite des résultats du dernier sondage d'opinion Eurobaromètre effectué pour la Commission dans toute l'UE concernant les négociations sur le Traité transatlantique. Alors qu'à l'automne 2014 le soutien aux négociations était en moyenne de 58%, il était en novembre 2015 de 53%. Une opposition majoritaire au traité se manifeste en novembre 2015 dans 4 pays dont l'Allemagne et l'Autriche. Selon un autre sondage comparable effectué au printemps 2015, un soutien croissant au TTIP existait alors dans 9 pays, alors qu'en novembre 2015 il n'y avait plus que 2 pays dans ce cas, ce qui semble confirmer un inversement de tendance de l'opinion européenne à ce sujet. La pétition anti-TTIP a recueilli jusqu'à aujourd'hui 3.385.000 signatures. L'objectif du collectif est de parvenir par son action militante à un pourcentage moyen d'opinions majoritaires hostiles au traité et de contrer les lobbies du commerce international pour faire échec aux négociations; on ne peut donc pas encore baisser les bras. Pour ceux qui n'ont pas encore signé la pétition: http://www.stop.ttip.org
- rousski
- Messages: 17
- Enregistré le: Mer 16 Sep 2015 17:24
Re: Mobilisations citoyennes contre le Grand Marché Transatlantique
Maude Barlow, Présidente du Conseil des Canadiens, auteure d’un rapport sur les leçons à tirer de l’expérience canadienne concernant les traités de libre-échange internationaux, et Raoul Marc Jennar, essayiste et auteur d’un livre sur la menace que fait peser le TTIP sur les peuples d’Europe, pointent les dangers de l’arbitrage international dans un article du « Monde Diplomatique » de février 2016.
Aperçu des éléments essentiels :
L’arbitrage international ou le règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE) est un mode de règlement des litiges par des personnes privées en dehors des juridictions officielles. Elle est encadrée depuis 1923 par plusieurs conventions internationales et des réglementations élaborées au sein d’organismes privés comme les Cours permanentes d’arbitrage de La Haye et de Londres et les Chambres de commerce internationales. Avec la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995 dont le but est de faire sauter tout obstacle au libre-échange, y compris dans la constitution ou la législation d’un Etat, une nouvelle génération d’accords apparaît. Un Etat signataire qui accueille un nouvel investisseur étranger est obligé de le traiter de la même manière que l’investisseur - étranger ou national – qui reçoit le traitement le plus favorable, ce qui revient à placer sur le même pied les investisseurs privés et les entreprises et services publics tels que la santé, l’éducation, la culture etc. Pour trancher d’éventuels litiges, les juridictions officielles sont dépouillées de leurs compétences au profit d’un RDIE. On compte en général trois arbitres : l’un représente le demandeur, l’autre le défendeur ; d’un commun accord, les parties choisissent le troisième. Ce dernier est souvent proposé par l’une des instances arbitrales privées qui accueillent cette procédure. L’arbitrage n’est généralement pas susceptible d’appel.
L’article 23 du mandat donné par les gouvernements de l’UE à la Commission de Bruxelles pour négocier le TTIP précise : « L’accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différends investisseur-Etat efficace et des plus modernes », y compris dans les domaines sociaux et environnementaux (article 45) ; l’article 27 du mandat stipule que « l’accord sera obligatoire pour toutes les institutions ayant un pouvoir de régulation et les autres autorités compétentes des deux parties ». Des décisions prises par des communes, des départements et des régions dont le pouvoir de régulation est garanti par l’article 72 de la Constitution française pourraient donc se trouver contestées devant des chambres d’arbitrage.
Les auteurs donnent l’exemple suivant du fonctionnement du mécanisme arbitral. La société américaine Ethyl fabrique aux E-U le MMT, un additif dérivé du manganèse utilisé par l’industrie pétrolière, qu’elle exporte vers l’un de ses sites au Canada où il est mélangé puis vendu aux raffineries. Début avril 1997, le Parlement d’Ottawa examine un projet de loi destiné à interdire l’importation et le transport de ce produit proscrit dans de nombreux pays dont les E-U, car soupçonné par plusieurs spécialistes d’être l’une des causes de maladies neurodégénératives graves. Considérant que le débat parlementaire menace sa réputation, Ethyl annonce son intention de poursuivre le Canada en utilisant le mécanisme arbitral de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena). Quand le Parlement, ignorant la menace, adopte la loi, Ethyl réclame 251 millions de dollars pour « expropriation indirecte ». En juillet 1998, le gouvernement canadien préfère transiger, lui verse 13 millions et abroge la loi en arguant que la nocivité du MMT n’est pas démontrée. La volonté d’un Parlement élu et d’un exécutif a ainsi été réduite à néant par le pouvoir conféré à une société privée. 60% des affaires arbitrées sur le fond (et non sur la compétence de la juridiction) dans le cadre d’un RDIE ont une issue favorable aux entreprises privées.
Devant la vaste mobilisation européenne contre le TTIP suscitée par des exemples de ce type et craignant que les Parlements nationaux en Europe refusent de ratifier l’accord pour échapper aux chambres arbitrales, la Commission a proposé en septembre 2015 un nouveau mécanisme, avec un tribunal de première instance et une cour d’appel ; des juges «hautement qualifiés » remplaceraient les arbitres et le droit des Etats de réglementer serait consacré et protégé. Mais le biais fondamental demeure : seuls les investisseurs peuvent porter plainte, pas les collectivités. La volte-face de la Commission montre à quel point l’exposition publique des détails du projet de traité embarrasse les institutions européennes. En outre, la mise en application de cette proposition nécessiterait l’aval des E-U, loin d’être acquis, et la convocation d’une conférence internationale réunissant tous les acteurs de l’arbitrage.
Selon les promoteurs du RDIE, la protection accordée aux investisseurs par le mécanisme arbitral actuel stimulerait puissamment l’« attractivité » de l’économie. Cependant de multiples études, dont celles de la Banque mondiale et de la Conférence des Nations-unies sur le commerce et le développement (Cnuced) démontrent qu’il n’est pas possible d’établir un lien statistique entre la mise en place d’un mécanisme d’arbitrage privé et l’augmentation du volume des investissements. Symétriquement, l’absence de ce mécanisme ne provoque pas un transfert des investissements vers des Etats qui en ont accepté un.
----
Aperçu des éléments essentiels :
L’arbitrage international ou le règlement des différends entre investisseurs et Etats (RDIE) est un mode de règlement des litiges par des personnes privées en dehors des juridictions officielles. Elle est encadrée depuis 1923 par plusieurs conventions internationales et des réglementations élaborées au sein d’organismes privés comme les Cours permanentes d’arbitrage de La Haye et de Londres et les Chambres de commerce internationales. Avec la création de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 1995 dont le but est de faire sauter tout obstacle au libre-échange, y compris dans la constitution ou la législation d’un Etat, une nouvelle génération d’accords apparaît. Un Etat signataire qui accueille un nouvel investisseur étranger est obligé de le traiter de la même manière que l’investisseur - étranger ou national – qui reçoit le traitement le plus favorable, ce qui revient à placer sur le même pied les investisseurs privés et les entreprises et services publics tels que la santé, l’éducation, la culture etc. Pour trancher d’éventuels litiges, les juridictions officielles sont dépouillées de leurs compétences au profit d’un RDIE. On compte en général trois arbitres : l’un représente le demandeur, l’autre le défendeur ; d’un commun accord, les parties choisissent le troisième. Ce dernier est souvent proposé par l’une des instances arbitrales privées qui accueillent cette procédure. L’arbitrage n’est généralement pas susceptible d’appel.
L’article 23 du mandat donné par les gouvernements de l’UE à la Commission de Bruxelles pour négocier le TTIP précise : « L’accord devrait viser à inclure un mécanisme de règlement des différends investisseur-Etat efficace et des plus modernes », y compris dans les domaines sociaux et environnementaux (article 45) ; l’article 27 du mandat stipule que « l’accord sera obligatoire pour toutes les institutions ayant un pouvoir de régulation et les autres autorités compétentes des deux parties ». Des décisions prises par des communes, des départements et des régions dont le pouvoir de régulation est garanti par l’article 72 de la Constitution française pourraient donc se trouver contestées devant des chambres d’arbitrage.
Les auteurs donnent l’exemple suivant du fonctionnement du mécanisme arbitral. La société américaine Ethyl fabrique aux E-U le MMT, un additif dérivé du manganèse utilisé par l’industrie pétrolière, qu’elle exporte vers l’un de ses sites au Canada où il est mélangé puis vendu aux raffineries. Début avril 1997, le Parlement d’Ottawa examine un projet de loi destiné à interdire l’importation et le transport de ce produit proscrit dans de nombreux pays dont les E-U, car soupçonné par plusieurs spécialistes d’être l’une des causes de maladies neurodégénératives graves. Considérant que le débat parlementaire menace sa réputation, Ethyl annonce son intention de poursuivre le Canada en utilisant le mécanisme arbitral de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena). Quand le Parlement, ignorant la menace, adopte la loi, Ethyl réclame 251 millions de dollars pour « expropriation indirecte ». En juillet 1998, le gouvernement canadien préfère transiger, lui verse 13 millions et abroge la loi en arguant que la nocivité du MMT n’est pas démontrée. La volonté d’un Parlement élu et d’un exécutif a ainsi été réduite à néant par le pouvoir conféré à une société privée. 60% des affaires arbitrées sur le fond (et non sur la compétence de la juridiction) dans le cadre d’un RDIE ont une issue favorable aux entreprises privées.
Devant la vaste mobilisation européenne contre le TTIP suscitée par des exemples de ce type et craignant que les Parlements nationaux en Europe refusent de ratifier l’accord pour échapper aux chambres arbitrales, la Commission a proposé en septembre 2015 un nouveau mécanisme, avec un tribunal de première instance et une cour d’appel ; des juges «hautement qualifiés » remplaceraient les arbitres et le droit des Etats de réglementer serait consacré et protégé. Mais le biais fondamental demeure : seuls les investisseurs peuvent porter plainte, pas les collectivités. La volte-face de la Commission montre à quel point l’exposition publique des détails du projet de traité embarrasse les institutions européennes. En outre, la mise en application de cette proposition nécessiterait l’aval des E-U, loin d’être acquis, et la convocation d’une conférence internationale réunissant tous les acteurs de l’arbitrage.
Selon les promoteurs du RDIE, la protection accordée aux investisseurs par le mécanisme arbitral actuel stimulerait puissamment l’« attractivité » de l’économie. Cependant de multiples études, dont celles de la Banque mondiale et de la Conférence des Nations-unies sur le commerce et le développement (Cnuced) démontrent qu’il n’est pas possible d’établir un lien statistique entre la mise en place d’un mécanisme d’arbitrage privé et l’augmentation du volume des investissements. Symétriquement, l’absence de ce mécanisme ne provoque pas un transfert des investissements vers des Etats qui en ont accepté un.
----
- rousski
- Messages: 17
- Enregistré le: Mer 16 Sep 2015 17:24
5 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Analyses et informations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité