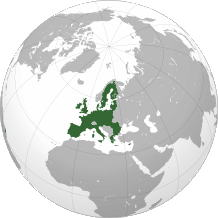A la place de cet essai, j’avais la volonté de présenter une sorte de nomenclature des produits dérivés (elle devrait suivre....) et quelques propositions afin d'en faire des instruments utiles au processus économique, ce qu'ils sont fort peu aujourd’hui et alors que leur nombre et l'importance de leurs flux ne cesse d'augmenter. En préparant ce travail, je me suis aperçu de la faculté qu'avaient eu les banques à la fois de réduire considérablement leur rôle économique et social depuis quelques décennies, d'afficher sans vergogne et sans complexe un cynisme invraisemblable après la crise des subprimes (c'était déjà l’attitude du crédit Lyonnais en 1985 avant son propre krach) et alors qu'elles ont été l'élément déclencheur de la crise latente, de ne pas se mettre en cause et enfin de mettre en place leurs hommes pour trouver des solutions à leurs problèmes avant tout. Le chômage attendra ! Je me suis donc interrogé sur ce qu'était cette sempiternelle financiarisation de l'économie.
I) Mon premier réflexe a été de penser que les activités financières avaient grossi comme ces fameuses bulles. Ce n'est pas si sûr......
La part des activités financières dans les PIB nationaux n'a pas augmenté autant qu'on pourrait le penser. Pour s'en convaincre il faut examiner les statistiques.
Quelques exemples internationaux:
Celui des États-Unis d'abord au travers des statistiques de l' US département of Commerce. La part proprement financière de ces activités rapportée au PIB en terme de valeur ajoutée est passée de 4,6% à 5,7%. de 1998 à 2010. En incluant les activités d'assurance pour favoriser les comparaisons internationales, on passe de 7,2% à 8,5%.
La France ensuite ou pour les mêmes données (banque et assurance) les chiffres sont restés relativement stables à 4,8% de 1995 à 2008 (Source INSEE).
Dans le même temps on trouve 4,2% en Allemagne et 6,6% en Grande Bretagne.
L'observation des profits dégagés par les sociétés financières et non financières commence à donner un éclairage plus significatif. De 1980 à 2008 la part des profits des sociétés financières aux États-Unis est passée de quelque 20% du total des profits à plus de 30% comme indiqué dans le graphique ci-dessous. Dans le même temps la part des salaires dans la valeur ajoutée de ces mêmes sociétés financières est passée de 54% à 63% de 1994 à 2007 (Source : INSEE, Comptabilité nationale en base 2000 ; valeur ajoutée au prix de base).
Source des données:
> Bureau of Economic Analysis, Tables 6.16B, 6.16C, 6.16D > Bureau of Economic Analysis, tableaux 6.16B, 6.16C, 6.16D
Au delà de ces chiffres bruts, il faut aussi constater que le métier des banques a changé. Les marges sur intérêts qui faisaient l'essentiel de leurs profits avant la baisse généralisée de l'inflation et donc des taux, ont fait place à la facturation des services et aux profits réalisés sur le marchés soit à compte propre, soit pour leurs clients. Le rôle d'intermédiaire dans le financement des investissements et la part des actifs et passifs relatifs à leurs clientèle a chuté. (Cf le graphique suivant: source INSEE). La part de l'activité banque d’affaires a supplanté celles des anciennes banques de dépôt. On perçoit également dans ce graphique la part croissante de l'interbancaire (gare à la théorie des dominos.....!)
Sources : Commission bancaire, Banque de France.
Sur le plan quantitatif on relève donc plutôt une mutation des acteurs financiers plutôt qu'une explosion de leur poids, encore que cette mutation leur a semble-t-il bien réussi.
II) Parallèlement à cette évolution on discerne une double tendance de fond.
Sur le plan de la rentabilité des investissements, la mondialisation a permis, via l'ouverture de marchés du travail inusités voici quinze ou vingt ans d'atteindre des taux de rentabilité à deux chiffres de façon courante. Les acteurs économiques et non pas seulement financiers s'y sont habitués et ont fini par considérer cette donnée comme une norme. D'où une tendance lourde à privilégier des investissements risqués là ou les bas salaires ne permettent pas facilement d'atteindre ces taux et la frénésie pour des opérations à court terme (Cf « la visée hégémonique de la Chine » Antoine BRUNET, Jean-Paul GUICHARD).
Le graphique précédent montre bien également l'évolution de la part des participations dans des actifs bancaires. Il faut y ajouter les hedge funds et les fonds de pension qui ont une attitude identique sur le mode de gestion et l'attente vis à vis de leurs participations.
Le capitalisme s'est organisé et unifié. La part croissante du capital risque et des fonds dans les entreprises les ont transformées en investissements à rendement immédiat et souvent à deux chiffres. Partout où on ne peut pas utiliser le levier des bas salaires par la délocalisation on atteint des rendements élevés soit par la prise de risques immodérés, soit par une pression non encore totalement révélée sur l'encadrement, soit par des taux d'endettement importants. C'est bien souvent un cocktail de ces stratégies qui conduit à l'augmentation de la valeur, là où autrefois on aurait parlé de meilleure organisation de rationalisation des processus de production ou de baisse des coûts. L'entreprise est devenue au fil du temps un produit financier et le vocabulaire qui accompagne sa gouvernance s'en rapproche de plus en plus. Il n'est qu'à voir combien les règles d 'évaluation internationale utilisent l'actualisation des flux futurs pour la valorisation des actifs. Les anciens du capitalisme industriel et commercial (Cf J-L BEFFA dans « La France doit choisir ») s'offusquent de cette dérive financière. On voit également émerger ces sociétés sans usines qui semblent être le nec plus ultra du capitalisme financier (Cf Sege TCHURUK et ALCATEL). On sous-traite tout pour ne garder qu'une prise sur les brevets et les marchés. Les cadres des grosses sociétés sont plus occupés à délocaliser les activés qu'à travailler sur les projets d'investissement en interne. On s'en moque d'ailleurs car quand il faudra réinvestir, on aura vendu !
Depuis 1980, l'endettement public est allé en augmentant partout dans le monde occidental, même si cette tendance ne se retrouve pas à l'identique dans la sphère des entreprises elle-mêmes (Cf lettre « TRESOR-ECO » de décembre 2009). Aujourd’hui toutefois, à des degrés divers, les états se trouvent endettés. Certains (Japon, Belgique....) sont redevables envers leurs citoyens, d'autres le sont à l'égard des marchés financiers. La France se range de plus en plus de ce dernier côté par une volonté politique délibérée (plus de 50% de sa dette). Le vieil adage dit « le temps c'est de l'argent » et son corollaire est que le temps des débiteurs appartient à leurs créanciers (Cf Mauricio LAZARETTO « La fabrique de l'homme endetté »). On le voit de façon ce plus en plus claire et cynique dans les événements de ces dernier mois. Les réformes engagées au niveau international ne sont pas celle des politiques mais bien des banquiers. Certes les discussions ont lieu en sous-main mais la nomination des responsables ne laisse aucun doute sur les détenteurs du pouvoir. Que ce soit au niveau de la banque centrale, de l’Italie, de la Grèce ou de l'Espagne, las banquiers ne se masquent plus et prennent ouvertement le pouvoir. La BCE elle même ne sait comment plaire à ces nouveaux maîtres. Près de 500 milliards ont été débloqués pour être prêtés aux banques au taux de 1%. Elles les ont pour l'essentiel replacés chez leur bailleur mais pourront ensuite les prêter aux états à 6 ou 7% quand les agences de notation auront soigneusement préparé le terrain.
La financiarisation de l'économie est donc à la fois le fait des banques qui ont très profondément modifié leur stratégie, même si leur contribution au PIB n'a pas considérablement augmenté et d'une évolution conséquente des attentes des détenteurs du capital que l'on trouve de plus en plus dans le secteur financier. La mondialisation a fait émerger des taux de rentabilité considérables qui ont poussé les banques à privilégier les activités qui permettaient de les atteindre. D'où le développement des activités de marché au travers des opérations sur produits dérivés et les participations dans les entreprises gérées comme des opérations financières avec pour objectif la création de valeur à court terme au détriment d'une stratégie plus longue. Les banques longtemps présentes dans les processus décisionnels, mais sous couvert des politiques, veulent désormais agir par elles mêmes et placent leurs hommes pour mettre en place des politiques qu'elles auront dictées et qui bien évidemment iront dans leur intérêt. La main invisible est bien ostensible !
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
La financiarisation de l'économie
2 messages
• Page 1 sur 1
Re: La financiarisation de l'économie
La valeur ajoutée des banques n’exprime que partiellement la financiarisation de l’économie.
D’une part parce que la structure de cette VA a évolué, au profit des activités spéculatives, comme les chiffres de l’INSEE que tu rapportes le montrent bien.
Mais aussi parce que les banques (et les assurances dans leur activité de placement) ne sont pas les seuls intermédiaires financiers. Les statistiques de l’AFG (Association française de la gestion financière) sont éclairantes sur ce point. Extrait : « L’industrie française de la gestion d’actifs se situe aux premiers rangs mondiaux et a géré en 2007 plus de 2 500 Md€ dont plus de 1 500 Md€ sous forme d’OPCVM (SICAV et FCP/ UCITS). Cette industrie a quintuplé en dix ans en volume d’affaires tandis que le nombre de sociétés de gestion a augmenté de 75% : 538 sociétés de gestion de portefeuille à fin 2007, contre 300 en 1997 ». Rappelons que le PIB de la France en 2007 était de l’ordre de 2.000 Md€.
Enfin parce que l’activité financière se mesure mieux par le volume des transactions que par la VA des intermédiaires. Les chiffres en la matière sont discordants mais lorsque j’avais travaillé sur le sujet fin 2010, on pouvait retenir que le montant des transactions purement financières, sur l’ensemble de la planète, représentait désormais, aussi effarant que cela puisse paraître, environ 200 fois celui des échanges internationaux de biens et services et 50 fois celui du PIB mondial (à comparer à 15 fois en 1990). En 2009, les transactions sur les « produits dérivés », dont ceux incorporant les fameux subprimes, ont représenté à elles seules 10 fois le PIB mondial. Cette frénésie ne s’accompagne pas d’un développement proportionnel de la VA des intermédiaires, pour au moins deux raisons : il y a de plus en plus d’opérations à très court terme avec des marges faibles mais répétitives ; les masses financières disponibles (fonds de pension, fonds souverains, grandes fortunes en pleine croissance) et leur « voracité » ont stimulé la prise de risque. Il y a donc des gains mais aussi des pertes, dans un contexte général de volatilité, générateur de « crises ».
D’une part parce que la structure de cette VA a évolué, au profit des activités spéculatives, comme les chiffres de l’INSEE que tu rapportes le montrent bien.
Mais aussi parce que les banques (et les assurances dans leur activité de placement) ne sont pas les seuls intermédiaires financiers. Les statistiques de l’AFG (Association française de la gestion financière) sont éclairantes sur ce point. Extrait : « L’industrie française de la gestion d’actifs se situe aux premiers rangs mondiaux et a géré en 2007 plus de 2 500 Md€ dont plus de 1 500 Md€ sous forme d’OPCVM (SICAV et FCP/ UCITS). Cette industrie a quintuplé en dix ans en volume d’affaires tandis que le nombre de sociétés de gestion a augmenté de 75% : 538 sociétés de gestion de portefeuille à fin 2007, contre 300 en 1997 ». Rappelons que le PIB de la France en 2007 était de l’ordre de 2.000 Md€.
Enfin parce que l’activité financière se mesure mieux par le volume des transactions que par la VA des intermédiaires. Les chiffres en la matière sont discordants mais lorsque j’avais travaillé sur le sujet fin 2010, on pouvait retenir que le montant des transactions purement financières, sur l’ensemble de la planète, représentait désormais, aussi effarant que cela puisse paraître, environ 200 fois celui des échanges internationaux de biens et services et 50 fois celui du PIB mondial (à comparer à 15 fois en 1990). En 2009, les transactions sur les « produits dérivés », dont ceux incorporant les fameux subprimes, ont représenté à elles seules 10 fois le PIB mondial. Cette frénésie ne s’accompagne pas d’un développement proportionnel de la VA des intermédiaires, pour au moins deux raisons : il y a de plus en plus d’opérations à très court terme avec des marges faibles mais répétitives ; les masses financières disponibles (fonds de pension, fonds souverains, grandes fortunes en pleine croissance) et leur « voracité » ont stimulé la prise de risque. Il y a donc des gains mais aussi des pertes, dans un contexte général de volatilité, générateur de « crises ».
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
2 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Finance et spéculation
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Il faut définanciariser l'économie
par scripta manent » Mar 06 Déc 2011 12:01 - 0 Réponses
- 1325 Vus
- Dernier message par scripta manent

Mar 06 Déc 2011 12:01
- Il faut définanciariser l'économie
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité