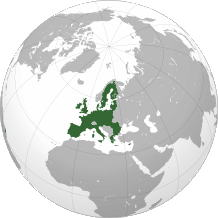Federica Mogherini sur les enjeux de la crise des réfugiés
La Haute Représentante de l’UE pour les Affaires Etrangères et la Politique de Sécurité et Vice Présidente de la Commission a accordé un entretien à Libération, paru le 16 septembre 2015.
Extraits :
« Contrairement à ce que certains pensent, il ne s’agit pas seulement d’une crise européenne : c’est en réalité une crise régionale due notamment aux conflits en Syrie et en Iraq et qui touchent au premier chef la Turquie, la Jordanie, le Liban mais aussi l’Irak et l’Egypte. C’est aussi une crise globale car il y a infiniment plus de personnes qui se déplacent…entre les pays non européens que vers les pays européens. L’Union a les moyens de faire face à cette crise. D’une part en aidant les pays voisins de la Syrie à faire face à cet afflux comme elle le fait déjà avec une aide de quatre milliards d’euros sur les quatre dernières années. D’autre part en accueillant un certain nombre de ces réfugiés, la situation des pays riverains devenant insoutenable. Cela vaut pour l’Europe, mais aussi pour la communauté internationale.
Sur les quelque cinq millions de réfugiés ayant fui la Syrie, 98% se trouvent dans les pays limitrophes. Cette année, 430 000 réfugiés syriens sont arrivés dans l’Union qui compte…500 millions d’habitants. L’Europe n’est donc pas submergée : actuellement, sa population ne compte que 0,1% de réfugiés. Des pays comme la Turquie ou le Liban ont fait infiniment plus que ce que nous sommes prêts à faire. Ayant dit cela,…la première destination que désirent rejoindre les réfugiés…c’est l’Union… L’Europe est un espace accueillant et attirant, ce que nous avons du mal à percevoir en interne après plusieurs années de crise économique et sociale. Si une partie des Européens est mécontente de l’Union actuelle, il n’en reste pas moins qu’elle fascine le reste du monde…
Lorsque certains responsables politiques ont commencé à parler de réfugiés et non plus d’immigrés, cela a contribué à faire évoluer l’opinion. Les mots sont importants…Il faut que nous, Européens, prenions nos responsabilités sur le plan intérieur, notamment en acceptant de répartir la responsabilité de l’accueil et le traitement obligatoire des demandes d’asile que propose la Commission. C’est seulement si nous sommes crédibles à l’intérieur que nous le serons à l’extérieur…
Il sera très difficile d’aller expliquer au Moyen-Orient qu’il faut respecter les droits des minorités si l’on a des discours et des pratiques discriminatoires à l’intérieur de l’Union. Nous sommes perçus comme les champions des droits de l’homme, ce qui nous impose une cohérence des messages politiques et des décisions…Si nous n’accueillons pas ces victimes du terrorisme…quel message leur enverrons-nous, ainsi qu’au reste du monde ? Il ne s’agit pas de bons sentiments, il s’agit aussi d’investir dans notre sécurité en se montrant accueillant. Si ces réfugiés sont coincés entre l’Etat islamique et le régime d’Al-Assad…et des pays qui les repoussent, croit-on que ce sera le meilleur moyen d’empêcher le développement des mouvements terroristes dans la région et en Europe ?... Si on pense qu’on peut fermer les yeux sur la crise et qu’elle peut être gérée par des pays tiers et qu’on peut se contenter de les aider financièrement, on prend le risque de déstabiliser ou de radicaliser la Turquie, le Liban et la Jordanie, des pays où les réfugiés représentent jusqu’au tiers de la population. Et il n’y a pas que la crise syrienne : ainsi, la Tunisie accueille 1,5 millions de Libyens. C’est la sécurité de ces régions qui est en jeu et, par contrecoup, notre sécurité. Les effets d’une explosion du Liban ou de la déstabilisation de la Jordanie seraient terribles : terrorisme, vague de réfugiés et immigration économique. Nous devons anticiper et investir dans la stabilité de ces pays…
Cela n’aurait guère de sens pour un aspirant terroriste de se présenter comme réfugié alors que ses empreintes sont automatiquement enregistrées dans le fichier Eurodac. Ils ont des filières bien plus sûres. De plus, tous les attentats qui ont eu lieu en Europe ont été commis par des citoyens européens ou des résidents de longue date…
Il faut…une mobilisation mondiale. La Norvège a aussi » (= comme la France) « proposé d’organiser une conférence sur le soutien aux réfugiés syriens, mais dans le cadre de l’ONU. Il est utile de s’inscrire dans ce cadre, puisque la plus grande partie de l’action repose déjà sur le travail extraordinaire du Haut Commissariat aux réfugiés, une agence de l’ONU majoritairement financée par l’Union…Surtout, cela permettra une vrai mobilisation internationale, car la solution passe par une approche globale »
Cette crise « se produit à un moment clé, au lendemain de l’accord sur le nucléaire avec l’Iran qui ouvre une fenêtre diplomatique, celle d’un dialogue possible entre les différents acteurs. Je soutiens les initiatives de l’envoyé spécial des Nations-Unies qui appelle à la mise en place d’un groupe de contact international sur la Syrie. L’Iran peut jouer un rôle constructif dans la crise syrienne et on peut espérer réunir les acteurs régionaux comme l’Iran, les monarchies du Golfe, la Turquie, avec les Etats-Unis et la Russie , dans un cadre international. Bien sûr, l’UE va jouer un rôle clé…L’idée d’un groupe de contact international peut aider : il pourrait pousser les acteurs syriens à trouver un terrain de compromis…L’Europe et la communauté internationale doivent faire comprendre à tous les acteurs régionaux que leur propre intérêt est de stabiliser la Syrie et de combattre l’Etat islamique. »
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Deux choses retiennent particulièrement mon attention à la lecture de ce très beau texte. La première, l'idée que l'universalisme serait en déclin, en voie de disparition. Etrange paradoxe que de voir notre monde se multinationaliser, tout en perdant ses valeurs universelles. Un peu comme si l'internationalisation de nos rapports économiques étouffait l'universalisme de nos principes.
La deuxième, ce n'est pas l'Europe qui a capitulé face à cette problématique. Ce sont les pays et les citoyens. A force de défendre notre culture contre une hypothétique invasion, nous perdons nos valeurs, et notre culture se perd. Deuxième paradoxe étrange que de voir à quel point défendre sa culture, serait en fait, la détruire. La culture ne se suffirait-elle pas à elle-même? Lorsque nous parlons de défendre notre culture, pouvons nous réellement définir ce que nous défendons?
Federica Mogherini: les enjeux de la crise des réfugiés
3 messages
• Page 1 sur 1
Re: Federica Mogherini: les enjeux de la crise des réfugiés
Il est intéressant de voir à quel point nous pouvons identifier les enjeux, en parler, communiquer, et finalement laisser tranquillement le sujet disparaître de l'horizon médiatique et de nos préoccupations. Il y a comme une force d'inertie incroyable, ou la passion monte à l'extrême, pour finalement laisser place au vide intersidéral.
J'émets l'hypothèse que ce serait dû à un manquement moral général de nos institutions, de notre système économique, et donc de nos sociétés, qui seraient corrompus par l'idéologie dominante du laisser-faire.
On oublie souvent lorsqu'on critique les institutions qu'elles ne sont pas neutres. Derrière elles, il y a des choix politiques et idéologiques. Lorsque l'on parle de l'Europe, par exemple, on a facilement tendance à oublier qu'il ne s'agit pas d'un organe en tant que tel. On la critique, on dit que c'est la faute de l'Europe, mais on omet de penser que l'Europe, ce sont surtout des choix, pris par des hommes et des femmes.
Peut-être serait-il temps de critiquer ces choix, et non l'institution en tant que telle. D'arrêter de se focaliser sur le fonctionnement de l'Europe, mais plutôt sur sa morale, ou son absence de morale.
Le capitalisme, dès ses débuts, s'est construit sur une idéologie élitiste, et très peu participative. Le libéralisme, ou laisser faire l'élite intellectuelle et financière, et cette élite vous apportera richesse et prospérité. Évidemment, si l'on mesure notre richesse et notre prospérité au nombre de smartphones vendus, on pourrait y voir une belle réussite. Mais avec la colonisation, et ensuite les deux guerres mondiales, une sérieuse remise en question semblait nécessaire.
Et nous avons donc eu droit à la sociale démocratie, issue principalement des partis libéraux (seuls existants dans nos démocraties naissantes). Les sociaux démocrates étaient, au commencement, des transfuges des partis libéraux, faisant donc toujours partie d'une certaine élite.
On pourrait parler d'une première évolution politique majeure dans notre société moderne. Mais nous ne pouvons pas encore parler stricto sensu de révolution, ces changements ayant eu lieu avec le consentement des élites dirigeantes.
La démocratie sociale a plutôt bien fonctionné après guerre, lorsqu'elle est devenue une véritable force politique. Il faut dire qu'elle n'avait pas trop de souci à se faire. L'Europe avait tellement à reconstruire et à construire, que l'élite pouvait se permettre de lâcher un peu de lest et de pouvoir. Elle gardait de toute manière les moyens de contrôler ces avancées, au travers de sa mainmise sur l'économie.
Les démocrates sociaux n'ayant jamais remis en question les principes du libéralisme (le laisser-faire, traduisez le pouvoir à l'élite économique), le politique restait sous contrôle, au travers par exemple de l'endettement des États, du système de financement des partis, du contrôle des médias, et du sacrosaint principe que l'économique devait être libéral, et cela sans aucune remise en question possible.
En ce sens, la démocratie sociale aurait joué un rôle de tampon, de frein, à une révolution, que je pense nécessaire, de notre système politico-économique.
Nous vivons dans le libéralisme depuis plus de 4 siècles, et aujourd'hui encore, des théories datant de plus de cent ans nous sont calmement récitées à l'école, et sagement apprises.
Si nous avions dû faire de même avec notre système scientifique, nous en serions encore probablement à utiliser plumes, parchemins et bougies.
Et c'est peut-être là que se trouve le noeud du problème! Nous faisons face à un monde qui est en évolution technique et scientifique extrêmement rapide, mais parallèlement, nos systèmes politiques et économiques sont d'un archaïsme dépassant l'entendement.
Impossible pour ceux-ci d'évoluer plus fondamentalement, de se révolutionner. Nous avons eu droit à une révolution technique et scientifique d'un niveau sans pareil, démontrant toute l'intelligence humaine. Mais nos systèmes de gestion, eux, sont restés au niveau quasi zéro de l'évolution. Honnêtement, il faut une sacré dose de lavage de cerveau pour arriver à croire à un système qui nous dit que tout va rentrer dans l'ordre par lui-même, au travers d'une main invisible et d'autres subterfuges, et que non, il n'est pas nécessaire de se poser trop de questions ou d'agir!
Cet écart gigantesque dans notre évolution nous mènerait-il vers une immoralité croissante? On se focalise sur le progrès, sans réfléchir à ses conséquences, car ce qui devrait nous servir de guide moral, nos institutions (le politique), nos entreprises (l'économique), n'intègrent pas cette valeur dans leur mode de fonctionnement. Comment pourrait-on être moral, en se fondant sur l'idée d'un laisser-faire absolu? La morale nécessite une réaction, une réflexion! Elle ne peut exister en tant que telle.
Elle ne peut se suffire d'un système idéologique qui impose sa vérité. La vraie morale, c'est de questionner, pour mieux affirmer. Une morale sans questionnement, ce serait juste un autre outil de domination.
Cette règle du laisser-faire rendrait aussi l'action politique plus difficile, la détournant de son véritable objet, en la forçant à mobiliser toute son énergie pour simplement exister. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi le discours dominant parle systématiquement de réforme, de modernisation de l'administration et de l'État. Mais jamais n'est posée la question de l'indépendance de nos institutions et de leur rôle moral.
Poser la question de l'indépendance et de la morale du politique, ce serait donc admettre qu'une action soit nécessaire. Ce qui serait bien sûr contraire à notre vérité absolue, le culte du laisser-faire, et la soumission qui en résulte.
Voilà donc une sérieuse piste de réflexion, et peut-être un début d'explication à nos déceptions face à une Europe passive, souvent incapable de mettre en oeuvre sa politique. Mais ce n'est pas tant de pouvoir que l'Europe a besoin, mais bien de sens moral, de continuer à questionner notre société. Et l'on a tôt fait de confondre les deux, d'exiger un pouvoir plus fort, qui se tourne hélas toujours contre nous.
Moralement, nous devons aider les gens en détresse. La question des réfugiés ne mérite-t-elle pas de rester à l'ordre du jour? Et si tous répondent unanimement que c'est notre devoir d'aider ceux qui en ont besoin, alors c'est à l'économique de se soumettre à notre unanimité, et d'agir. Et s'il faut laisser faire, et bien qu'ils fassent! Qu'ils apportent leur contribution, leur force, leurs moyens. Pourquoi le politique et le monde associatif devraient-ils être seuls dans cette bataille?
J'émets l'hypothèse que ce serait dû à un manquement moral général de nos institutions, de notre système économique, et donc de nos sociétés, qui seraient corrompus par l'idéologie dominante du laisser-faire.
On oublie souvent lorsqu'on critique les institutions qu'elles ne sont pas neutres. Derrière elles, il y a des choix politiques et idéologiques. Lorsque l'on parle de l'Europe, par exemple, on a facilement tendance à oublier qu'il ne s'agit pas d'un organe en tant que tel. On la critique, on dit que c'est la faute de l'Europe, mais on omet de penser que l'Europe, ce sont surtout des choix, pris par des hommes et des femmes.
Peut-être serait-il temps de critiquer ces choix, et non l'institution en tant que telle. D'arrêter de se focaliser sur le fonctionnement de l'Europe, mais plutôt sur sa morale, ou son absence de morale.
Le capitalisme, dès ses débuts, s'est construit sur une idéologie élitiste, et très peu participative. Le libéralisme, ou laisser faire l'élite intellectuelle et financière, et cette élite vous apportera richesse et prospérité. Évidemment, si l'on mesure notre richesse et notre prospérité au nombre de smartphones vendus, on pourrait y voir une belle réussite. Mais avec la colonisation, et ensuite les deux guerres mondiales, une sérieuse remise en question semblait nécessaire.
Et nous avons donc eu droit à la sociale démocratie, issue principalement des partis libéraux (seuls existants dans nos démocraties naissantes). Les sociaux démocrates étaient, au commencement, des transfuges des partis libéraux, faisant donc toujours partie d'une certaine élite.
On pourrait parler d'une première évolution politique majeure dans notre société moderne. Mais nous ne pouvons pas encore parler stricto sensu de révolution, ces changements ayant eu lieu avec le consentement des élites dirigeantes.
La démocratie sociale a plutôt bien fonctionné après guerre, lorsqu'elle est devenue une véritable force politique. Il faut dire qu'elle n'avait pas trop de souci à se faire. L'Europe avait tellement à reconstruire et à construire, que l'élite pouvait se permettre de lâcher un peu de lest et de pouvoir. Elle gardait de toute manière les moyens de contrôler ces avancées, au travers de sa mainmise sur l'économie.
Les démocrates sociaux n'ayant jamais remis en question les principes du libéralisme (le laisser-faire, traduisez le pouvoir à l'élite économique), le politique restait sous contrôle, au travers par exemple de l'endettement des États, du système de financement des partis, du contrôle des médias, et du sacrosaint principe que l'économique devait être libéral, et cela sans aucune remise en question possible.
En ce sens, la démocratie sociale aurait joué un rôle de tampon, de frein, à une révolution, que je pense nécessaire, de notre système politico-économique.
Nous vivons dans le libéralisme depuis plus de 4 siècles, et aujourd'hui encore, des théories datant de plus de cent ans nous sont calmement récitées à l'école, et sagement apprises.
Si nous avions dû faire de même avec notre système scientifique, nous en serions encore probablement à utiliser plumes, parchemins et bougies.
Et c'est peut-être là que se trouve le noeud du problème! Nous faisons face à un monde qui est en évolution technique et scientifique extrêmement rapide, mais parallèlement, nos systèmes politiques et économiques sont d'un archaïsme dépassant l'entendement.
Impossible pour ceux-ci d'évoluer plus fondamentalement, de se révolutionner. Nous avons eu droit à une révolution technique et scientifique d'un niveau sans pareil, démontrant toute l'intelligence humaine. Mais nos systèmes de gestion, eux, sont restés au niveau quasi zéro de l'évolution. Honnêtement, il faut une sacré dose de lavage de cerveau pour arriver à croire à un système qui nous dit que tout va rentrer dans l'ordre par lui-même, au travers d'une main invisible et d'autres subterfuges, et que non, il n'est pas nécessaire de se poser trop de questions ou d'agir!
Cet écart gigantesque dans notre évolution nous mènerait-il vers une immoralité croissante? On se focalise sur le progrès, sans réfléchir à ses conséquences, car ce qui devrait nous servir de guide moral, nos institutions (le politique), nos entreprises (l'économique), n'intègrent pas cette valeur dans leur mode de fonctionnement. Comment pourrait-on être moral, en se fondant sur l'idée d'un laisser-faire absolu? La morale nécessite une réaction, une réflexion! Elle ne peut exister en tant que telle.
Elle ne peut se suffire d'un système idéologique qui impose sa vérité. La vraie morale, c'est de questionner, pour mieux affirmer. Une morale sans questionnement, ce serait juste un autre outil de domination.
Cette règle du laisser-faire rendrait aussi l'action politique plus difficile, la détournant de son véritable objet, en la forçant à mobiliser toute son énergie pour simplement exister. Ce qui expliquerait peut-être pourquoi le discours dominant parle systématiquement de réforme, de modernisation de l'administration et de l'État. Mais jamais n'est posée la question de l'indépendance de nos institutions et de leur rôle moral.
Poser la question de l'indépendance et de la morale du politique, ce serait donc admettre qu'une action soit nécessaire. Ce qui serait bien sûr contraire à notre vérité absolue, le culte du laisser-faire, et la soumission qui en résulte.
Voilà donc une sérieuse piste de réflexion, et peut-être un début d'explication à nos déceptions face à une Europe passive, souvent incapable de mettre en oeuvre sa politique. Mais ce n'est pas tant de pouvoir que l'Europe a besoin, mais bien de sens moral, de continuer à questionner notre société. Et l'on a tôt fait de confondre les deux, d'exiger un pouvoir plus fort, qui se tourne hélas toujours contre nous.
Moralement, nous devons aider les gens en détresse. La question des réfugiés ne mérite-t-elle pas de rester à l'ordre du jour? Et si tous répondent unanimement que c'est notre devoir d'aider ceux qui en ont besoin, alors c'est à l'économique de se soumettre à notre unanimité, et d'agir. Et s'il faut laisser faire, et bien qu'ils fassent! Qu'ils apportent leur contribution, leur force, leurs moyens. Pourquoi le politique et le monde associatif devraient-ils être seuls dans cette bataille?
- Demos
- Messages: 47
- Enregistré le: Jeu 02 Juil 2015 16:49
Re: Federica Mogherini: les enjeux de la crise des réfugiés
«Je te promets un miracle»: la chronique de Vincent Engel
La fresque murale réalisée par Johan Muyle à la gare du Nord à Bruxelles est un chef-d’œuvre qu’il convient de redécouvrir alors que des centaines de réfugiés errent dans le quartier, privés de l’assistance et de la considération humanitaire la plus élémentaire.
En 2003, il y a presque 15 ans, l’artiste Johan Muyle achevait une stupéfiante fresque murale, dans le quartier de la gare du Nord à Bruxelles. Une fresque de 1.600 mètres carrés représentant 44 portraits (dont certains sont animés) d’artistes belges, amis du peintre (de Benoît Poelvoorde à Yolande Moreau, en passant par Jean-Pierre Verheggen et Michelle Anne De Mey. Aujourd’hui, des dizaines de migrants croupissent au pied de cette fresque et redoutent, jour après jour, les descentes policières. Ironie amère de la situation : le titre de la fresque. « Je vous promets un miracle »… Il est temps.
Oui, certains vont encore rugir et foncer sur les commentaires pour m’agonir d’injures ou m’envoyer cet argument imparable : « Si tu veux soutenir les réfugiés, t’as qu’à en prendre chez toi ! » Et pourtant, je persiste et signe, car la situation qu’endurent ces hommes, ces femmes et ces enfants est intolérable et représente une atteinte inacceptable à la dignité humaine, qui est ce que, au minimum, nous partageons avec eux. Il faut le dire et le redire : ces personnes fuient la guerre et des menaces de mort. Selon les conventions internationales que notre pays a signées, que notre Culture Occidentale est si fière d’avoir imposées à un monde « barbare », nous DEVONS les accueillir et leur porter assistance ; au lieu de quoi, ces réfugiés (qui ne sont pas migrants) vivent dans une précarité dont nous ne voudrions pas pour nos animaux de compagnie. Ils dorment dans la rue, sous des cartons – et encore, quand ils osent installer ces cartons, les opérations de police impromptues leur imposant de dormir leur sac sur le dos pour pouvoir fuir le plus rapidement possible.
Cet accueil et cette prise en charge ne peuvent pas être supportés uniquement par des individus ou des associations non gouvernementales (pour répondre à l’argument imparable ci-dessus). D’abord, parce que les personnes qui viendraient en aide aux réfugiés risquent elles aussi, dans certains cas, des poursuites judiciaires. Ensuite, parce qu’il s’agit d’une responsabilité collective. L’État doit assumer les obligations issues des engagements légaux qu’il a pris au nom des citoyens qu’il représente. S’il y a quelque grandeur héroïque à compter les rares citoyens dignes et responsables dans une société qui se délite, comme Abraham argumentait auprès de Dieu désireux de détruire les villes pécheresses, il y a, avant d’en arriver à une telle extrémité, une première exigence : que des citoyens, les plus nombreux possible, alertent les pouvoirs publics et demandent qu’ils prennent en main, dans la dignité et le respect des traités internationaux, l’accueil de ces réfugiés.
Des valeurs universelles
Dans le climat du multiculturalisme et du relativisme qui sévit actuellement, il devient difficile de défendre l’existence de valeurs universelles. Tout serait « culturel », n’est-ce pas ? Et rien n’est plus important que de respecter les « spécificités culturelles » des autres cultures. Si telle pratique l’excision, la peine de mort, la torture, l’interdiction de la liberté d’expression, à quel titre nous opposerions-nous à elle, puisque c’est « culturel » ?
Je m’inscris résolument en faux contre cette position. Il y a peu de valeurs universelles, mais il y en a, dont bénéficient aussi ceux qui les nient (par principe). La dignité humaine – qu’il faudrait d’ailleurs, comme me le faisait remarquer un de mes étudiants de l’Ihecs, élargir à la dignité du vivant – est à mes yeux la première de ces valeurs. C’est au nom de la dignité, comme l’écrit Camus dans L’homme révolté, que l’on s’insurge contre une situation qui bafoue cette dignité. « Je me révolte, donc nous sommes », dit encore Camus : cela signifie que la révolte est un acte individuel, que l’on ne peut déléguer à personne (il ne suffit pas de verser 10 € à Amnesty pour se révolter), mais qui implique l’ensemble des personnes touchées par l’injustice qui suscite ma révolte.
La dignité vise d’abord les conditions de vie : un toit, de la nourriture, de la chaleur, des vêtements, l’accès à l’hygiène et aux soins… Ensuite, elle implique la sécurité et la justice, l’éducation et les libertés fondamentales. Toutes choses dont sont privés les réfugiés, qui doivent de surcroît supporter tous les fantasmes propagés par les populistes et les extrémistes sur « les vagues », le « flux », la « déferlante » (je renvoie à mes chroniques précédentes qui démontent ces chiffres absurdes et rappellent que nous ne devrions accueillir qu’une marge infime des réfugiés des guerres – dont nous sommes souvent responsables –, puisque la majorité cherche refuge au plus près de chez eux, et que ce « flux » ne représente pas 0,2 % de la population européenne).
Au lieu de quoi, des tribuns fascisants comme Orban continuent à se prétendre les chevaliers sauveurs de l’Europe en bâtissant des murs ignobles, et chez nous, les politiques ont trop peur de perdre le peu d’électorat qu’il leur reste en adoptant les mesures élémentaires pour éviter les scènes de détresse et d’inhumanité que nos concitoyens, qui passent devant la gare du Nord, finissent par ne même plus remarquer. Jusqu’à notre Theo Francken qui multiplie les actes et les paroles infamantes sans susciter la réprobation de ses partenaires gouvernementaux, alors même qu’il bafoue ouvertement les valeurs du véritable libéralisme. Et c’est lui qui s’insurge lorsqu’on le représente vêtu d’un uniforme nazi…
Miracle : cour ou promesse ?
Ce hiatus a sauté aux yeux d’un autre de nos artistes, et non des moindres : Lorent Wanson, acteur et metteur en scène, qui compte à son palmarès certains chefs-d’œuvre du théâtre engagé belge (comme les récents et magnifiques Lehman’s trilogy, Le porteur d’eau, L’aube boraine, Les Bas-fonds…) Devant cette fresque superbe de Johan Muyle, qui met en valeur certains de nos plus grands artistes, se décline l’inhumanité quotidienne de nos temps égoïstes. « L’art, écrivait encore Camus, est la distance que le temps donne à la souffrance. » L’indifférence aussi. Un art qui se fige nourrit l’indifférence ; un art qui s’anime la combat. Mais la fresque de Muyle a perdu de son animation, semble-t-il ; ces beaux visages ne voient pas ce qui se déroule devant eux, pas plus que les passants qui défilent et détournent le regard. Ce n’est évidemment pas la faute de Johan Muyle ou des artistes qu’il a élus ; mais ne peuvent-ils pas se ranimer pour agir ? C’est en tout cas ce que tente de faire Lorent Wanson, cet homme à la sensibilité d’écorché que l’injustice tourmente sans relâche. Ce dimanche 24 septembre, de 11 à 13 heures, il convie un maximum d’artistes belges à rejoindre, Gare du Nord, ces réfugiés, pour ranimer la fresque et son titre : « Je te promets un miracle ». Parce que, sans doute, il faudra un miracle pour changer non seulement les pratiques de nos politiques, mais aussi (et surtout) les mentalités des gens face aux réfugiés. Mais dans ce titre et ce projet, tous les mots comptent : les miracles n’existent pas, peut-être, mais les promesses bien. Promettre un regard, de la considération, la prise en compte de besoins fondamentaux, la défense de droits inaliénables. Promettre que nous ne laisserons pas notre société glisser vers une dictature qui ne dit pas son nom et devenir plus injuste encore, plus égoïste. Promettre à ces êtres humains qui cherchent à vivre que l’on ne laissera pas leur dignité être ainsi piétinée.
Deux choses retiennent particulièrement mon attention à la lecture de ce très beau texte. La première, l'idée que l'universalisme serait en déclin, en voie de disparition. Etrange paradoxe que de voir notre monde se multinationaliser, tout en perdant ses valeurs universelles. Un peu comme si l'internationalisation de nos rapports économiques étouffait l'universalisme de nos principes.
La deuxième, ce n'est pas l'Europe qui a capitulé face à cette problématique. Ce sont les pays et les citoyens. A force de défendre notre culture contre une hypothétique invasion, nous perdons nos valeurs, et notre culture se perd. Deuxième paradoxe étrange que de voir à quel point défendre sa culture, serait en fait, la détruire. La culture ne se suffirait-elle pas à elle-même? Lorsque nous parlons de défendre notre culture, pouvons nous réellement définir ce que nous défendons?
- Demos
- Messages: 47
- Enregistré le: Jeu 02 Juil 2015 16:49
3 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Analyses et informations
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Crise des migrants: accord Turquie-UE
par gerald » Sam 26 Déc 2015 16:55 - 5 Réponses
- 2736 Vus
- Dernier message par gerald

Sam 26 Nov 2016 16:59
- Crise des migrants: accord Turquie-UE
-
- L'économie souterraine, palliatif mais aussi renfort de la crise en Europe
par voxpop » Ven 26 Avr 2013 17:19 - 2 Réponses
- 2911 Vus
- Dernier message par causonsen

Mar 29 Juil 2014 12:39
- L'économie souterraine, palliatif mais aussi renfort de la crise en Europe
-
- Conférence "Regards chrétiens sur la crise" par Gaël Giraud
 par scripta manent » Sam 11 Fév 2012 20:58
par scripta manent » Sam 11 Fév 2012 20:58
- 0 Réponses
- 1827 Vus
- Dernier message par scripta manent

Sam 11 Fév 2012 20:58
- Conférence "Regards chrétiens sur la crise" par Gaël Giraud
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité