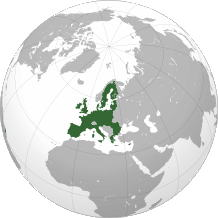» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
QDQ - L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
12 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
QDQ - L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Depuis le 1er avril 2012, les citoyens de l’Union européenne peuvent, sous un certain nombre de conditions, demander à la Commission européenne de légiférer sur un sujet relevant de la compétence de l’Union. Cette possibilité avait déjà été imaginée, en 2003, dans le contexte de la préparation du projet de Traité constitutionnel. Elle a été codifiée, en 2007, par l’article 11.4 du Traité de Lisbonne : « Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités. »
L’article 24 du même Traité prévoyait que « Le Parlement européen et le Conseil (…) arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne. » Ces dispositions on été arrêtées le 15 décembre 2011, après les habituelles négociations entre les institutions européennes concernées.
Le considérant n°1 du texte adopté le 15 décembre 2011 par le Parlement européen positionne l’enjeu de la procédure : « Le traité sur l'Union européenne renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par l'intermédiaire d'une initiative citoyenne européenne. Cette procédure donne aux citoyens la possibilité de s'adresser directement à la Commission, pour lui présenter une demande l'invitant à soumettre une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités à l'instar du droit conféré au Parlement européen en vertu de l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au Conseil en vertu de l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
L’initiative doit émaner d’un comité de citoyens (« organisateurs », au nombre minimum de sept) issus d’au moins sept pays membres de l’Union européenne. Ce comité désigne un représentant et un suppléant chargés d’établir le lien avec la Commission et fait enregistrer l’initiative par les services de la Commission. Les députés européens peuvent être organisateurs au sein d’un comité, mais ils ne sont pas pris en compte dans le seuil minimum de sept.
Assez curieusement, le considérant n° 9 du texte du 15 décembre 2011 précise que « Les entités, notamment les organisations qui contribuent, conformément aux traités, à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union, devraient être en mesure de promouvoir une initiative citoyenne, à condition qu'elles le fassent en totale transparence. »
La procédure d’inscription peut être effectuée dans une ou plusieurs des 23 langues de l’Union. Les formulaires de recueil des signatures ne pourront ensuite être établis que dans la (ou les) langue(s) utilisée(s) dans le cadre de la procédure d’inscription. Aucun support en matière de traduction n’est apporté par les institutions européennes, pourtant bien équipées en la matière. On peut comprendre qu’elles ne souhaitent pas intervenir dans la formulation d’un texte qui doit rester d’origine citoyenne, se contentant d’en vérifier la conformité dans toutes les langues utilisées.
La Commission peut, dans un délai de deux mois, accepter ou refuser d’enregistrer l’initiative, en fonction de critères prédéfinis : l’initiative doit concerner des sujets faisant partie des domaines de compétence de l’Union ; elle ne doit pas être « manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire », ni contraire aux valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (« L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. »)
Si l’initiative est enregistrée, la collecte des signatures peut commencer, selon des règles garantissant l’authenticité du résultat obtenu. Il est prévu que la Commission mette gratuitement à disposition des comités un logiciel comportant les dispositifs techniques et de sécurité permettant de se conformer à la procédure requise.
Pour être ensuite déclarée admissible, l’initiative doit recueillir, dans le délai maximum d’un an, au moins un million de signatures, en provenance d’au moins ¼ des pays de l’Union (soit actuellement 7, et non 9 comme l’aurait souhaité la Commission), avec un seuil plancher par pays correspondant au nombre de ses députés au Parlement européen multiplié par 750, ce qui donne aujourd’hui un éventail de 4.500 signatures pour Malte jusqu’à 74.250 pour l’Allemagne.
Les autorités nationales de chaque pays dans lequel des signatures ont été ainsi recueillies doivent se prononcer, dans un délai de trois mois, sur la régularité des opérations.
Sous réserve que les signatures requises aient été recueillies et que les certificats de conformité aient été délivrés par les autorités nationales, l’Initiative est ensuite présentée par ses organisateurs à la Commission, qui dispose d’un délai de trois mois pour annoncer et motiver les suites éventuelles qu’elle propose d’y donner.
Dans le cas où une suite est donnée, une nouvelle audition, publique, est organisée avec la Commission et le Parlement et on entre dans la procédure de proposition législative européenne par la Commission, avec soumission au Parlement et au Conseil, ou seulement au Conseil dans certains cas.
Il n’est pas indifférent de voir dans quels termes l’Initiative citoyenne européenne est présentée respectivement sur les sites que le Parlement et la Commission lui consacrent.
Pour le Parlement, le but est de « permettre aux citoyens de saisir la Commission européenne de problèmes et de demandes qui les concernent (…) si les citoyens pensent qu'une différente direction doit être prise sur certains sujets, ils peuvent maintenant nous le dire d'une seule voix. Et les institutions n'auront d'autre choix que de les entendre, de réagir et d'expliquer leurs choix (…) Les organisateurs d'initiative citoyenne disposeront d'un pouvoir d'initiative équivalent à celui du Parlement européen et du Conseil. »
Pour la Commission, « Une initiative citoyenne européenne est une invitation faite à la Commission européenne de présenter une proposition législative (…) La Commission n'est pas tenue de présenter une proposition législative à la suite d'une initiative. »
Enthousiasme et optimisme d’un côté, rappel à la modération de l’autre : pour la Commission, le citoyen ne « saisit » plus, il « invite » une Commission qui s’empresse de préciser qu’elle n’est « tenue » … à rien ou presque.
Résumons :
- à la toute première étape de la procédure, les critères de validité d’une ICE sont suffisamment vagues pour que la Commission puisse en refuser l’enregistrement ;
- la demande d’enregistrement doit par ailleurs faire référence aux « dispositions des traités que les organisateurs jugent pertinentes pour l’action proposée » ; difficile dans ces conditions de proposer une ICE qui viserait, par exemple, à réfréner le délire permissif de l’ultralibéralisme, puisque l’Union européenne y a fait allégeance pleine et entière, allant jusqu'à graver le dogme dérégulateur dans le marbre de ses textes fondateurs ! (exemple : « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites » - Traité de Lisbonne, art. 63) ;
- dans l’hypothèse où les signatures sont obtenues, la Commission n’est cependant pas tenue de présenter une proposition législative ; dans ce cas, le seul gain, et il n’est pas négligeable, est une certaine publicité autour des initiatives présentées et des motivations du rejet.
L’ICE n’est pas sans intérêt dans son principe, de même que le droit de pétition avec lequel elle ne doit pas être confondue, mais elle est décevante dans ses modalités et ne constitue pas une étape décisive vers la démocratie européenne.
En quoi d’ailleurs une procédure initiée par des citoyens mais arbitrée par une instance « administrative » - en tout cas sans légitimité démocratique - pourrait-elle nous rapprocher vraiment de la démocratie ?
Dans la mesure où les institutions européennes ont par ailleurs évolué dans un sens qui rend de plus en plus problématique l’exercice de la démocratie, on serait plutôt en droit de considérer qu’il s’agit d’un os à ronger lancé au toutou-citoyen pour le détourner de méditer trop longuement sur les lacunes fondamentales de ces institutions. Considérer, comme le prétend le règlement du 15 décembre 2011, que l’ICE « améliore encore le fonctionnement démocratique de l’Union » relève de la méthode Coué : pour « améliorer » quelque chose, il faut que cette chose existe ; quant à « l’améliorer encore », c’est beaucoup demander …
L’affaiblissement des institutions collégiales de l’Europe, le Parlement et la Commission, au profit d’instances de décision intergouvernementales, a produit ses fruits amers. Comment décider vite et bien dans un cadre où coexistent un Parlement, une Commission, un Conseil européen, des Conseils des ministres, des Présidents, un Eurogroupe, la BCE … avec des pouvoirs de consultation, proposition, recommandation, discussion, … mais rarement de décision ?
Ajoutez à cela une course folle à l’admission de nouveaux membres, la dichotomie « Zone Euro - Union européenne » et la nécessité de faire ratifier certaines décisions par les parlements nationaux, et vous obtiendrez une usine à gaz dont le profane, en l’occurrence le citoyen, n’a plus aucune chance de pénétrer les mystères.
Aujourd’hui les élections européennes ne sont qu’une occasion supplémentaire, pour chacun des pays membres, de se livrer à leurs affrontements politiques habituels : lors des élections européennes de juin 2009, les personnalités politiques qui conduisaient les listes françaises ont ainsi escamoté l’Europe au profit d’une campagne franco-française, axée sur leurs ambitions présidentielles.
On pourra parler de démocratie européenne lorsque les institutions de l’Union auront été remises en ordre autour d’un pouvoir législatif et d’un pouvoir exécutif dignes de ce nom et lorsque les élections au Parlement porteront sur des candidats inscrits à des partis européens, faisant campagne pour des programmes européens. Un tel projet ne pourra être porté que par un groupe de pays décidés à ne plus se laisser détourner de leur objectif par les adeptes d’une simple zone de libre-échange.
En attendant, apprenons tout de même à nous servir de la procédure d’initiative citoyenne, ne serait-ce que pour porter le débat sur la place publique …
L’article 24 du même Traité prévoyait que « Le Parlement européen et le Conseil (…) arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne. » Ces dispositions on été arrêtées le 15 décembre 2011, après les habituelles négociations entre les institutions européennes concernées.
Le considérant n°1 du texte adopté le 15 décembre 2011 par le Parlement européen positionne l’enjeu de la procédure : « Le traité sur l'Union européenne renforce la citoyenneté de l'Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l'Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union par l'intermédiaire d'une initiative citoyenne européenne. Cette procédure donne aux citoyens la possibilité de s'adresser directement à la Commission, pour lui présenter une demande l'invitant à soumettre une proposition d'acte juridique de l'Union aux fins de l'application des traités à l'instar du droit conféré au Parlement européen en vertu de l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au Conseil en vertu de l'article 241 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. »
L’initiative doit émaner d’un comité de citoyens (« organisateurs », au nombre minimum de sept) issus d’au moins sept pays membres de l’Union européenne. Ce comité désigne un représentant et un suppléant chargés d’établir le lien avec la Commission et fait enregistrer l’initiative par les services de la Commission. Les députés européens peuvent être organisateurs au sein d’un comité, mais ils ne sont pas pris en compte dans le seuil minimum de sept.
Assez curieusement, le considérant n° 9 du texte du 15 décembre 2011 précise que « Les entités, notamment les organisations qui contribuent, conformément aux traités, à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union, devraient être en mesure de promouvoir une initiative citoyenne, à condition qu'elles le fassent en totale transparence. »
La procédure d’inscription peut être effectuée dans une ou plusieurs des 23 langues de l’Union. Les formulaires de recueil des signatures ne pourront ensuite être établis que dans la (ou les) langue(s) utilisée(s) dans le cadre de la procédure d’inscription. Aucun support en matière de traduction n’est apporté par les institutions européennes, pourtant bien équipées en la matière. On peut comprendre qu’elles ne souhaitent pas intervenir dans la formulation d’un texte qui doit rester d’origine citoyenne, se contentant d’en vérifier la conformité dans toutes les langues utilisées.
La Commission peut, dans un délai de deux mois, accepter ou refuser d’enregistrer l’initiative, en fonction de critères prédéfinis : l’initiative doit concerner des sujets faisant partie des domaines de compétence de l’Union ; elle ne doit pas être « manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire », ni contraire aux valeurs énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (« L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. »)
Si l’initiative est enregistrée, la collecte des signatures peut commencer, selon des règles garantissant l’authenticité du résultat obtenu. Il est prévu que la Commission mette gratuitement à disposition des comités un logiciel comportant les dispositifs techniques et de sécurité permettant de se conformer à la procédure requise.
Pour être ensuite déclarée admissible, l’initiative doit recueillir, dans le délai maximum d’un an, au moins un million de signatures, en provenance d’au moins ¼ des pays de l’Union (soit actuellement 7, et non 9 comme l’aurait souhaité la Commission), avec un seuil plancher par pays correspondant au nombre de ses députés au Parlement européen multiplié par 750, ce qui donne aujourd’hui un éventail de 4.500 signatures pour Malte jusqu’à 74.250 pour l’Allemagne.
Les autorités nationales de chaque pays dans lequel des signatures ont été ainsi recueillies doivent se prononcer, dans un délai de trois mois, sur la régularité des opérations.
Sous réserve que les signatures requises aient été recueillies et que les certificats de conformité aient été délivrés par les autorités nationales, l’Initiative est ensuite présentée par ses organisateurs à la Commission, qui dispose d’un délai de trois mois pour annoncer et motiver les suites éventuelles qu’elle propose d’y donner.
Dans le cas où une suite est donnée, une nouvelle audition, publique, est organisée avec la Commission et le Parlement et on entre dans la procédure de proposition législative européenne par la Commission, avec soumission au Parlement et au Conseil, ou seulement au Conseil dans certains cas.
Il n’est pas indifférent de voir dans quels termes l’Initiative citoyenne européenne est présentée respectivement sur les sites que le Parlement et la Commission lui consacrent.
Pour le Parlement, le but est de « permettre aux citoyens de saisir la Commission européenne de problèmes et de demandes qui les concernent (…) si les citoyens pensent qu'une différente direction doit être prise sur certains sujets, ils peuvent maintenant nous le dire d'une seule voix. Et les institutions n'auront d'autre choix que de les entendre, de réagir et d'expliquer leurs choix (…) Les organisateurs d'initiative citoyenne disposeront d'un pouvoir d'initiative équivalent à celui du Parlement européen et du Conseil. »
Pour la Commission, « Une initiative citoyenne européenne est une invitation faite à la Commission européenne de présenter une proposition législative (…) La Commission n'est pas tenue de présenter une proposition législative à la suite d'une initiative. »
Enthousiasme et optimisme d’un côté, rappel à la modération de l’autre : pour la Commission, le citoyen ne « saisit » plus, il « invite » une Commission qui s’empresse de préciser qu’elle n’est « tenue » … à rien ou presque.
Résumons :
- à la toute première étape de la procédure, les critères de validité d’une ICE sont suffisamment vagues pour que la Commission puisse en refuser l’enregistrement ;
- la demande d’enregistrement doit par ailleurs faire référence aux « dispositions des traités que les organisateurs jugent pertinentes pour l’action proposée » ; difficile dans ces conditions de proposer une ICE qui viserait, par exemple, à réfréner le délire permissif de l’ultralibéralisme, puisque l’Union européenne y a fait allégeance pleine et entière, allant jusqu'à graver le dogme dérégulateur dans le marbre de ses textes fondateurs ! (exemple : « toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites » - Traité de Lisbonne, art. 63) ;
- dans l’hypothèse où les signatures sont obtenues, la Commission n’est cependant pas tenue de présenter une proposition législative ; dans ce cas, le seul gain, et il n’est pas négligeable, est une certaine publicité autour des initiatives présentées et des motivations du rejet.
L’ICE n’est pas sans intérêt dans son principe, de même que le droit de pétition avec lequel elle ne doit pas être confondue, mais elle est décevante dans ses modalités et ne constitue pas une étape décisive vers la démocratie européenne.
En quoi d’ailleurs une procédure initiée par des citoyens mais arbitrée par une instance « administrative » - en tout cas sans légitimité démocratique - pourrait-elle nous rapprocher vraiment de la démocratie ?
Dans la mesure où les institutions européennes ont par ailleurs évolué dans un sens qui rend de plus en plus problématique l’exercice de la démocratie, on serait plutôt en droit de considérer qu’il s’agit d’un os à ronger lancé au toutou-citoyen pour le détourner de méditer trop longuement sur les lacunes fondamentales de ces institutions. Considérer, comme le prétend le règlement du 15 décembre 2011, que l’ICE « améliore encore le fonctionnement démocratique de l’Union » relève de la méthode Coué : pour « améliorer » quelque chose, il faut que cette chose existe ; quant à « l’améliorer encore », c’est beaucoup demander …
L’affaiblissement des institutions collégiales de l’Europe, le Parlement et la Commission, au profit d’instances de décision intergouvernementales, a produit ses fruits amers. Comment décider vite et bien dans un cadre où coexistent un Parlement, une Commission, un Conseil européen, des Conseils des ministres, des Présidents, un Eurogroupe, la BCE … avec des pouvoirs de consultation, proposition, recommandation, discussion, … mais rarement de décision ?
Ajoutez à cela une course folle à l’admission de nouveaux membres, la dichotomie « Zone Euro - Union européenne » et la nécessité de faire ratifier certaines décisions par les parlements nationaux, et vous obtiendrez une usine à gaz dont le profane, en l’occurrence le citoyen, n’a plus aucune chance de pénétrer les mystères.
Aujourd’hui les élections européennes ne sont qu’une occasion supplémentaire, pour chacun des pays membres, de se livrer à leurs affrontements politiques habituels : lors des élections européennes de juin 2009, les personnalités politiques qui conduisaient les listes françaises ont ainsi escamoté l’Europe au profit d’une campagne franco-française, axée sur leurs ambitions présidentielles.
On pourra parler de démocratie européenne lorsque les institutions de l’Union auront été remises en ordre autour d’un pouvoir législatif et d’un pouvoir exécutif dignes de ce nom et lorsque les élections au Parlement porteront sur des candidats inscrits à des partis européens, faisant campagne pour des programmes européens. Un tel projet ne pourra être porté que par un groupe de pays décidés à ne plus se laisser détourner de leur objectif par les adeptes d’une simple zone de libre-échange.
En attendant, apprenons tout de même à nous servir de la procédure d’initiative citoyenne, ne serait-ce que pour porter le débat sur la place publique …
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Le GIE « Toute l’Europe » a organisé le 29 juin à Paris, en partenariat avec l’ECAS, une journée de débats sur le thème "Comment communiquer sur l’Initiative citoyenne européenne". (voir en fin de message une brève présentation de « Toute l’Europe » et de l’ECAS).
Le compte rendu de cette journée est accessible sur le site de Toute l'Europe
Il en ressort que l’accès à la procédure d’Initiative citoyenne européenne n’est décidément pas une mince affaire. Il en ressort aussi que cette conférence « parisienne » n’a pas échappé à une avalanche d’anglicismes superflus et de concepts relevant plus du « business » que de la citoyenneté : les ateliers de travail étaient des « workshop » et on y a beaucoup parlé de « fundraising, marketing, monitoring, sponsoring, networking, lobbying, crowdsourcing, mailing list … »
Extrait du site « Toute l’Europe » :
« Toute l'Europe » est un groupement d'intérêt économique (GIE) financé par le Gouvernement français et différents partenaires publics et privés impliqués dans les questions européennes. En 1992, le Gouvernement français et la Commission européenne fondaient à Paris le Centre d'information sur l'Europe (CIE) comme centre d’information, de documentation et de ressources ouvert au public. Le CIE s’est ensuite recentré sur l’Internet et la production de contenus multimédias en créant en mai 2006 le portail http://www.touteleurope.eu. Depuis le retrait de la Commission européenne fin 2007, le GIE a ouvert sa structure à des partenaires publics et privés intéressés par les questions européennes. Depuis le 25 juin 2010, il ne s'appelle plus "Centre d'Information sur l'Europe" mais "Toute l'Europe". Le GIE compte deux "Membres" (ministère français des Affaires étrangères et européennes et SNCF) auxquels s’ajoutent trois partenaires financiers non membres de la structure dits "Contributeurs" »
ECAS se présente comme suit sur son site :
« ECAS was created in 1991 as an international non-profit organization, independent of political parties, commercial interests and the EU Institutions. Our mission is to enable NGOs and individuals to make their voice heard with the EU by providing advice on how to lobby, fundraise, and defend European citizenship rights. We are a large cross-sectoral European association bringing together members from different areas of activity: civil liberties, culture, development, health and social welfare, as well as general civil society development agencies. “
L’indépendance à l’égard des institutions européennes ne semble pas totale, puisqu’il est precisé, sur le même site que « ECAS is supported by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission. »
Le compte rendu de cette journée est accessible sur le site de Toute l'Europe
Il en ressort que l’accès à la procédure d’Initiative citoyenne européenne n’est décidément pas une mince affaire. Il en ressort aussi que cette conférence « parisienne » n’a pas échappé à une avalanche d’anglicismes superflus et de concepts relevant plus du « business » que de la citoyenneté : les ateliers de travail étaient des « workshop » et on y a beaucoup parlé de « fundraising, marketing, monitoring, sponsoring, networking, lobbying, crowdsourcing, mailing list … »
Extrait du site « Toute l’Europe » :
« Toute l'Europe » est un groupement d'intérêt économique (GIE) financé par le Gouvernement français et différents partenaires publics et privés impliqués dans les questions européennes. En 1992, le Gouvernement français et la Commission européenne fondaient à Paris le Centre d'information sur l'Europe (CIE) comme centre d’information, de documentation et de ressources ouvert au public. Le CIE s’est ensuite recentré sur l’Internet et la production de contenus multimédias en créant en mai 2006 le portail http://www.touteleurope.eu. Depuis le retrait de la Commission européenne fin 2007, le GIE a ouvert sa structure à des partenaires publics et privés intéressés par les questions européennes. Depuis le 25 juin 2010, il ne s'appelle plus "Centre d'Information sur l'Europe" mais "Toute l'Europe". Le GIE compte deux "Membres" (ministère français des Affaires étrangères et européennes et SNCF) auxquels s’ajoutent trois partenaires financiers non membres de la structure dits "Contributeurs" »
ECAS se présente comme suit sur son site :
« ECAS was created in 1991 as an international non-profit organization, independent of political parties, commercial interests and the EU Institutions. Our mission is to enable NGOs and individuals to make their voice heard with the EU by providing advice on how to lobby, fundraise, and defend European citizenship rights. We are a large cross-sectoral European association bringing together members from different areas of activity: civil liberties, culture, development, health and social welfare, as well as general civil society development agencies. “
L’indépendance à l’égard des institutions européennes ne semble pas totale, puisqu’il est precisé, sur le même site que « ECAS is supported by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) of the European Commission. »
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
" Arrêtons l'écocide en Europe " : une Initiative Citoyenne
Deux nouvelles Initiatives citoyennes européennes (ICE) ont été lancées en janvier 2013 : l'une sur le Revenu de base inconditionnel (UBI), l'autre sur le concept d'Ecocide.
Elles sont présentées comme suit sur le site " Europe - Liberté - Sécurité - Justice "
(le statut de ce site est à préciser : émanation des institutions européennes ?) :
" Dans le premier mois de 2013 deux nouvelles initiatives ont été lancées, avec le but de réussir a recueillir un million de signatures d’ici janvier 2014. Même si l’ objectif peut être considéré comme un peu ambitieux, les organisateurs sont en train de mobiliser les citoyens européens en faveur de leur propositions.
1-. La première initiative est «Unconditional Basic Income (UBI) – Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU». Elle a été présentée le 14 janvier pour la deuxième fois, parce qu’ en septembre 2012 la Commission avait rejeté la proposition considérée comme en dehors des compétences de l’institution. Les organisateurs ont remédié à cette erreur, en ne proposant pas un acte légal, mais des études de faisabilité concernant le revenu de base inconditionnel européen.
Les organisateurs, qui viennent de 15 états membres, ont défini le « UBI » comme devant être: universel, individuel, inconditionnel et assez élevé pour garantir une existence digne et la participation à la vie sociale.
Les justifications sont décrites dans l’UBI , sont les suivantes :
- aider à prévenir la pauvreté et assurer la liberté à chaque individu de déterminer sa propre vie et renforcer sa propre participation sociale ;
- éviter les divisions sociales ;
- aider les citoyens à s’identifier avec l’Union européenne et assurer leurs droits politiques.
L’initiative n’est pas très précise : les promoteurs, pour ce qui concerne les différents moyens de financer le revenue de base inconditionnel, n’ont fait aucune proposition.
Les dispositions du Traité qui sont considérées comme pertinentes sont les articles 2+3 (TUE) et les articles 5+156 (TFUE). Il y a aussi les articles 1+2, 5+6, 15, 21 et 31 du Traité de Nice.
Le délai pour la collecte des signatures est le 14 janvier 2014 mais le système informatique qui permet de signer l’initiative en ligne n’est pas encore en fonction, parce que leur fiabilité doit encore être contrôlée par les institutions européennes. En plus, les organisateurs ont décide d’utiliser les serveurs de la Commission européenne à Luxembourg, mais ce programme demande des temps plus longs pour commencer à bien fonctionner.
L’initiative est pour l’instant disponible seulement en anglais.
2-.La deuxième initiative « Arrêtons l’Ecocide en Europe:est une Initiative des Citoyens pour donner des Droits à la Terre». Elle a été officiellement lancé le 22 janvier près du Parlement Européen. Le but primaire de cette initiative est de donner à l’Union l’opportunité d’adopter une directive contre l’ecocide, ça veut dire interdire, empêcher et anticiper les dommages, la destruction ou la perte des écosystèmes.
Dans la partie du site de la Commission dédiée à leur initiative, les organisateurs ont indiqué trois objectifs spécifiques :
- criminaliser l’ecocide et garantir que le personnes physiques et juridiques peuvent être réputées responsables d’avoir commis ecocide, selon le principe de responsabilité supérieure ;
- empêcher et anticiper les ecocides sur les territoires européens qui sont dans le domaine juridique européen et toutes les actions commises hors de l’Union par des personnes enregistrées juridiquement par l’UE ou des citoyens européens ;
- établir une période de transition pour faciliter une économie durable.
Ont participé à la présentation de l’initiative : Polly Higgins, écrivaine et avocat, promotrice de la campagne Wish20 contre l’ecocide, Prisca Merz, chef de « End ecocide », et les députés Keith Taylor (Verts/RU), Eva Joly (Verts/Fr), Jo Leiner (S&D/All), qui ont donné leur soutien publiquement.
Polly Higgins avait déjà proposé la loi d’ecocide aux Nations Unies en avril 2010, avec comme but de présenter l’ecocide comme le cinquième crime international contre la paix, en amendant le Statut de Rome qui relève de la Cour pénale internationale (CPI). Pour les promoteurs de l’ICE l’UE devrait prendre le leadership pour conduire la lutte au niveau international et faire adopter cette nouvelle disposition.
Les dispositions du Traité qui sont envisagées sont les articles 83, 191 et 194, puis les directives 2004/35/EC et 2008/99/EC, la Convention Aarhus et l’Accord de Copenhague.
Les organisateurs ont aussi présenté un projet d’acte législatif, afin d’ introduire des standards dans le contexte européen vers une société et une économie durables.
L’initiative est disponible en plusieurs langues et le délai pour la collecte des signatures est le 21 janvier 2014. "
Pour prendre connaissance de ces initiatives de façon plus détaillée, et éventuellement y souscrire :
http://www.basicincomeinitiative.eu
http://www.endecocide.eu
Pour une opinion sur la procédure d'Initiative citoyenne européenne :
http://www.citoyensunisdeurope.eu/des-procedures-pour-faire-bouger-l-europe/l-initiative-citoyenne-europeenne-ice-un-os-a-ronger-t282.html
Elles sont présentées comme suit sur le site " Europe - Liberté - Sécurité - Justice "
(le statut de ce site est à préciser : émanation des institutions européennes ?) :
" Dans le premier mois de 2013 deux nouvelles initiatives ont été lancées, avec le but de réussir a recueillir un million de signatures d’ici janvier 2014. Même si l’ objectif peut être considéré comme un peu ambitieux, les organisateurs sont en train de mobiliser les citoyens européens en faveur de leur propositions.
1-. La première initiative est «Unconditional Basic Income (UBI) – Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU». Elle a été présentée le 14 janvier pour la deuxième fois, parce qu’ en septembre 2012 la Commission avait rejeté la proposition considérée comme en dehors des compétences de l’institution. Les organisateurs ont remédié à cette erreur, en ne proposant pas un acte légal, mais des études de faisabilité concernant le revenu de base inconditionnel européen.
Les organisateurs, qui viennent de 15 états membres, ont défini le « UBI » comme devant être: universel, individuel, inconditionnel et assez élevé pour garantir une existence digne et la participation à la vie sociale.
Les justifications sont décrites dans l’UBI , sont les suivantes :
- aider à prévenir la pauvreté et assurer la liberté à chaque individu de déterminer sa propre vie et renforcer sa propre participation sociale ;
- éviter les divisions sociales ;
- aider les citoyens à s’identifier avec l’Union européenne et assurer leurs droits politiques.
L’initiative n’est pas très précise : les promoteurs, pour ce qui concerne les différents moyens de financer le revenue de base inconditionnel, n’ont fait aucune proposition.
Les dispositions du Traité qui sont considérées comme pertinentes sont les articles 2+3 (TUE) et les articles 5+156 (TFUE). Il y a aussi les articles 1+2, 5+6, 15, 21 et 31 du Traité de Nice.
Le délai pour la collecte des signatures est le 14 janvier 2014 mais le système informatique qui permet de signer l’initiative en ligne n’est pas encore en fonction, parce que leur fiabilité doit encore être contrôlée par les institutions européennes. En plus, les organisateurs ont décide d’utiliser les serveurs de la Commission européenne à Luxembourg, mais ce programme demande des temps plus longs pour commencer à bien fonctionner.
L’initiative est pour l’instant disponible seulement en anglais.
2-.La deuxième initiative « Arrêtons l’Ecocide en Europe:est une Initiative des Citoyens pour donner des Droits à la Terre». Elle a été officiellement lancé le 22 janvier près du Parlement Européen. Le but primaire de cette initiative est de donner à l’Union l’opportunité d’adopter une directive contre l’ecocide, ça veut dire interdire, empêcher et anticiper les dommages, la destruction ou la perte des écosystèmes.
Dans la partie du site de la Commission dédiée à leur initiative, les organisateurs ont indiqué trois objectifs spécifiques :
- criminaliser l’ecocide et garantir que le personnes physiques et juridiques peuvent être réputées responsables d’avoir commis ecocide, selon le principe de responsabilité supérieure ;
- empêcher et anticiper les ecocides sur les territoires européens qui sont dans le domaine juridique européen et toutes les actions commises hors de l’Union par des personnes enregistrées juridiquement par l’UE ou des citoyens européens ;
- établir une période de transition pour faciliter une économie durable.
Ont participé à la présentation de l’initiative : Polly Higgins, écrivaine et avocat, promotrice de la campagne Wish20 contre l’ecocide, Prisca Merz, chef de « End ecocide », et les députés Keith Taylor (Verts/RU), Eva Joly (Verts/Fr), Jo Leiner (S&D/All), qui ont donné leur soutien publiquement.
Polly Higgins avait déjà proposé la loi d’ecocide aux Nations Unies en avril 2010, avec comme but de présenter l’ecocide comme le cinquième crime international contre la paix, en amendant le Statut de Rome qui relève de la Cour pénale internationale (CPI). Pour les promoteurs de l’ICE l’UE devrait prendre le leadership pour conduire la lutte au niveau international et faire adopter cette nouvelle disposition.
Les dispositions du Traité qui sont envisagées sont les articles 83, 191 et 194, puis les directives 2004/35/EC et 2008/99/EC, la Convention Aarhus et l’Accord de Copenhague.
Les organisateurs ont aussi présenté un projet d’acte législatif, afin d’ introduire des standards dans le contexte européen vers une société et une économie durables.
L’initiative est disponible en plusieurs langues et le délai pour la collecte des signatures est le 21 janvier 2014. "
Pour prendre connaissance de ces initiatives de façon plus détaillée, et éventuellement y souscrire :
http://www.basicincomeinitiative.eu
http://www.endecocide.eu
Pour une opinion sur la procédure d'Initiative citoyenne européenne :
http://www.citoyensunisdeurope.eu/des-procedures-pour-faire-bouger-l-europe/l-initiative-citoyenne-europeenne-ice-un-os-a-ronger-t282.html
- causonsen
- Messages: 309
- Enregistré le: Mar 13 Mar 2012 19:15
Re: L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Prévue dès 2007 par le Traité de Lisbonne, votée en décembre 2011 par le Parlement européen, rendue effective en avril/mai 2012, la procédure d'Initiative citoyenne européenne (ICE) chemine doucement.
Où en est-on, bientôt 1 an après sa mise en oeuvre effective ?
Un article paru sur EU-LOGOS, le 26 février 2013, permet de faire le point (orthographe revue) :
" Le 11 février la Commission européenne a déclaré Right2Water première Initiative Citoyenne Européenne à avoir atteint la limite de un million de signatures ! À partir de 9 mai 2012, grâce au Traité de Lisbonne, les citoyens européens peuvent présenter une initiative aux institutions européennes en recueillant un million de signatures provenant d’au moins sept pays. Ils disposent d’un an pour recueillir les signatures .
Le vice-président de la Commission européenne et responsable pour les Affaires institutionnelles, Maroš Šefčovič, s’est exprimé dans les termes suivants : «Tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs. Bien que les signatures doivent encore faire l'objet d’une vérification, la collecte d’un million de signatures en moins de six mois est une véritable prouesse. Les initiatives citoyennes européennes ont pour but de susciter des débats paneuropéens sur des questions qui concernent les citoyens de toute l’Europe et de faire en sorte qu’elles figurent en bonne place parmi les préoccupations de l'Union européenne. Cet objectif a indubitablement été atteint par Right2Water.»
Aussi Anne-Marie Perret, Présidente du Comité du Citoyen, a souligné cette victoire en disant : « Franchir cette étape importante, à savoir qu’un million de citoyens de l’UE s’accordent sur le fait que l’eau et l’assainissement sont un droit humain, est une grande victoire ».
Les organisateurs croient que l’eau est un bien public et ils demandent aux institutions européennes d’assurer que tous les habitants de l’Europe puissent avoir ce droit. L’eau, selon leur avis, ne doit pas être soumis aux règles du marché et les services qui concernent cette thématique doivent être exclus de la libéralisation.
La Commission a annoncé que les organisateurs n’ont pas soumis leur initiative parce qu’ils veulent continuer à collecter les signatures et atteindre leur objectif de 2 millions d’ici septembre 2013. Ils veulent aussi éviter le risque d’une élimination de l’initiative à cause des possibles fausses signatures. De toute façon, la procédure n’est pas encore finie parce que les signatures proviennent seulement de trois pays européens, Allemagne, Belgique et Autriche : il reste encore à atteindre l’autre obligation, à savoir recueillir des signatures dans quatre autres pays.
Après, la Commission devra vérifier l’authenticité des signatures et, si elles sont acceptées, les organisateurs auront la possibilité de présenter leur initiative dans un hearing public organisé au Parlement européen. À ce moment là, l’institution concernée aura trois mois de temps pour examiner l’initiative et décider si elle accepte de l’examiner pour lui donner le suivi approprié.
L’autre Initiative Citoyenne Européenne, Fraternité 2020, n’a atteint pour le moment que 60.000 signatures le 15 février 2013.
En ce qui concerne l’autre ICE, Swissout, le 4 février 2013 a été retirée. Sur le site on peut lire : « Après beaucoup de réunions et de discussions avec les membres du gouvernement suisse, ils nous ont assuré que leur pays sera assujetti à la juridiction de la Cour de Luxembourg à partir du 1er juin 2014 ».
Dans cette traduction française, "audition" n'aurait pas été mal pour "hearing".
Le bilan est donc encore maigre.
Curieusement, les deux ICE lancées en janvier 2013, l'une sur le Revenu de base inconditionnel (UBI), l'autre sur le concept d'Ecocide, ne sont pas mentionnées. Peut-être parce qu'elles n'ont pas franchi la première étape de ce parcours du combattant : la validation préalable par la Commission.
Affaire à suivre.
Pour accéder au site EU-LOGOS : http://www.eu-logos.org/eu-logos_nea-say.php?idnl=2732
Où en est-on, bientôt 1 an après sa mise en oeuvre effective ?
Un article paru sur EU-LOGOS, le 26 février 2013, permet de faire le point (orthographe revue) :
" Le 11 février la Commission européenne a déclaré Right2Water première Initiative Citoyenne Européenne à avoir atteint la limite de un million de signatures ! À partir de 9 mai 2012, grâce au Traité de Lisbonne, les citoyens européens peuvent présenter une initiative aux institutions européennes en recueillant un million de signatures provenant d’au moins sept pays. Ils disposent d’un an pour recueillir les signatures .
Le vice-président de la Commission européenne et responsable pour les Affaires institutionnelles, Maroš Šefčovič, s’est exprimé dans les termes suivants : «Tout d'abord, je tiens à féliciter les organisateurs. Bien que les signatures doivent encore faire l'objet d’une vérification, la collecte d’un million de signatures en moins de six mois est une véritable prouesse. Les initiatives citoyennes européennes ont pour but de susciter des débats paneuropéens sur des questions qui concernent les citoyens de toute l’Europe et de faire en sorte qu’elles figurent en bonne place parmi les préoccupations de l'Union européenne. Cet objectif a indubitablement été atteint par Right2Water.»
Aussi Anne-Marie Perret, Présidente du Comité du Citoyen, a souligné cette victoire en disant : « Franchir cette étape importante, à savoir qu’un million de citoyens de l’UE s’accordent sur le fait que l’eau et l’assainissement sont un droit humain, est une grande victoire ».
Les organisateurs croient que l’eau est un bien public et ils demandent aux institutions européennes d’assurer que tous les habitants de l’Europe puissent avoir ce droit. L’eau, selon leur avis, ne doit pas être soumis aux règles du marché et les services qui concernent cette thématique doivent être exclus de la libéralisation.
La Commission a annoncé que les organisateurs n’ont pas soumis leur initiative parce qu’ils veulent continuer à collecter les signatures et atteindre leur objectif de 2 millions d’ici septembre 2013. Ils veulent aussi éviter le risque d’une élimination de l’initiative à cause des possibles fausses signatures. De toute façon, la procédure n’est pas encore finie parce que les signatures proviennent seulement de trois pays européens, Allemagne, Belgique et Autriche : il reste encore à atteindre l’autre obligation, à savoir recueillir des signatures dans quatre autres pays.
Après, la Commission devra vérifier l’authenticité des signatures et, si elles sont acceptées, les organisateurs auront la possibilité de présenter leur initiative dans un hearing public organisé au Parlement européen. À ce moment là, l’institution concernée aura trois mois de temps pour examiner l’initiative et décider si elle accepte de l’examiner pour lui donner le suivi approprié.
L’autre Initiative Citoyenne Européenne, Fraternité 2020, n’a atteint pour le moment que 60.000 signatures le 15 février 2013.
En ce qui concerne l’autre ICE, Swissout, le 4 février 2013 a été retirée. Sur le site on peut lire : « Après beaucoup de réunions et de discussions avec les membres du gouvernement suisse, ils nous ont assuré que leur pays sera assujetti à la juridiction de la Cour de Luxembourg à partir du 1er juin 2014 ».
Dans cette traduction française, "audition" n'aurait pas été mal pour "hearing".
Le bilan est donc encore maigre.
Curieusement, les deux ICE lancées en janvier 2013, l'une sur le Revenu de base inconditionnel (UBI), l'autre sur le concept d'Ecocide, ne sont pas mentionnées. Peut-être parce qu'elles n'ont pas franchi la première étape de ce parcours du combattant : la validation préalable par la Commission.
Affaire à suivre.
Pour accéder au site EU-LOGOS : http://www.eu-logos.org/eu-logos_nea-say.php?idnl=2732
- voxpop
- Messages: 304
- Enregistré le: Ven 24 Fév 2012 11:41
Re: L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Un nouveau point, au 1er septembre 2013, sur les initiatives citoyennes européennes (ICE), grâce à un article bien documenté paru hier sur Agoravox.
On y apprend que :
" A ce jour 11 initiatives ont été refusées par la commission car le sujet n’entrait pas dans le cadre de responsabilité de l’union européenne et/ou n’avait pas de fondement juridique suffisamment solide. (...) 6 initiatives ont été retirées par leur organisateurs, il est à noter que 4 ont été immédiatement reproposées et sont en cours de recueil de signatures.
Au final 17 initiatives sont en cours de recueil de signatures dont 8 arrivent à terme le 1 novembre 2013. (...)
Seules deux initiatives seront en position de présenter leur texte :
- " Un de nous " (contre la recherche sur l’embryon humain) 957 677 signatures soit 96% de l’objectif et le quota atteint dans 10 pays ;
- " L'eau et l'assainissement sont un droit humain ! L'eau est un bien public, pas une marchandise ! " 1 529 531 signatures (d’autres pages annoncent 1 386 375) et le quota par pays atteint dans 10 pays. "
L'auteur conclut comme suit :
" Le bilan est finalement assez pathétique, c’est donc de février à mai (2014) que nous verrons le comportement réel de la commission vis-à-vis des ICE. Est-ce que ses décisions et la communication qui en sera faite permettront de relancer ce dispositif ou de l’enterrer définitivement.
Personnellement, l’ICE était un des points qui m’avait fait voter oui en 2005…le retour au réel est rude ! Que cela ne nous empêche pas d’utiliser, tout en restant lucide, ce dispositif à notre disposition. "
Pour accéder à l'article : Agoravox
.
On y apprend que :
" A ce jour 11 initiatives ont été refusées par la commission car le sujet n’entrait pas dans le cadre de responsabilité de l’union européenne et/ou n’avait pas de fondement juridique suffisamment solide. (...) 6 initiatives ont été retirées par leur organisateurs, il est à noter que 4 ont été immédiatement reproposées et sont en cours de recueil de signatures.
Au final 17 initiatives sont en cours de recueil de signatures dont 8 arrivent à terme le 1 novembre 2013. (...)
Seules deux initiatives seront en position de présenter leur texte :
- " Un de nous " (contre la recherche sur l’embryon humain) 957 677 signatures soit 96% de l’objectif et le quota atteint dans 10 pays ;
- " L'eau et l'assainissement sont un droit humain ! L'eau est un bien public, pas une marchandise ! " 1 529 531 signatures (d’autres pages annoncent 1 386 375) et le quota par pays atteint dans 10 pays. "
L'auteur conclut comme suit :
" Le bilan est finalement assez pathétique, c’est donc de février à mai (2014) que nous verrons le comportement réel de la commission vis-à-vis des ICE. Est-ce que ses décisions et la communication qui en sera faite permettront de relancer ce dispositif ou de l’enterrer définitivement.
Personnellement, l’ICE était un des points qui m’avait fait voter oui en 2005…le retour au réel est rude ! Que cela ne nous empêche pas d’utiliser, tout en restant lucide, ce dispositif à notre disposition. "
Pour accéder à l'article : Agoravox
.
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: QDQ - L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Sur cette question du référendum d'initiative populaire, le service des Affaires européennes du Sénat français a publié, en septembre 2002, un rapport remarquable, certes largement antérieur aux débats sur l'Initiative citoyenne européenne mais toujours apte à nourrir nos réflexions sur la démocratie "directe".
Nous en reproduisons ci-après la synthèse :
" En France, le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire le référendum organisé à l'initiative d'une fraction du corps électoral, n'est pas prévu par la Constitution. En effet, celle-ci attribue l'initiative du référendum au président de la République, que le référendum ait lieu dans le cadre de l'article 11 ou dans celui de l'article 89.
Dans le premier cas, c'est le président de la République, sur proposition conjointe des deux assemblées ou, pendant la durée des sessions, sur proposition du gouvernement, qui peut décider de soumettre à référendum « tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou qui tendent à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
Dans le second, le référendum constitue en principe l'aboutissement de la révision constitutionnelle, après qu'elle a été approuvée par les deux assemblées en termes identiques. Toutefois, lorsque la révision a pour origine une initiative de l'exécutif, le président de la République peut décider de ne pas la soumettre à référendum, mais au Parlement réuni en Congrès.
Le référendum prévu par la Constitution française est donc un référendum normatif, puisqu'il permet l'adoption d'un texte, législatif ou constitutionnel.
Cependant, dans d'autres pays, le référendum, notamment lorsqu'il est organisé à la demande d'une fraction du corps électoral, peut également être abrogatif ou consultatif. Le premier vise à abroger des textes déjà en vigueur, tandis que le second est organisé pour connaître l'opinion des électeurs, mais n'a aucune valeur contraignante.
La présente étude analyse les dispositions nationales relatives au référendum d'initiative populaire en Italie et en Suisse, seuls pays européens où il existe. En effet, en Autriche et au Portugal, si le mécanisme de l'initiative populaire permet à une fraction du corps électoral de saisir le Parlement fédéral d'une proposition, il n'entraîne pas nécessairement l'organisation d'un référendum.
L'étude examine également l'exemple californien, la Californie étant l'État américain qui recourt le plus souvent au référendum.
L'analyse des dispositions italiennes, suisses et californiennes montre que :
- dans les trois cas, le référendum d'initiative populaire donne aux électeurs un droit de veto sur certains textes que le Parlement vient d'adopter ;
- en Italie, les lois en vigueur peuvent être abrogées par un référendum d'initiative populaire ;
- en Suisse et en Californie, une fraction du corps électoral peut, par référendum, demander l'adoption de textes législatifs.
1) En Italie, en Suisse et en Californie, le référendum d'initiative populaire donne aux électeurs un droit de veto sur certains textes que le Parlement vient d'adopter
Après leur adoption et avant leur entrée en vigueur, certains textes peuvent être soumis à référendum à la demande d'une partie du corps électoral. La demande de référendum a un effet suspensif : l'entrée en vigueur de la norme attaquée est subordonnée au résultat du vote.
Le délai référendaire est exprimé de façon légèrement différente, à la fois en terme de longueur et de point de départ, mais il est dans les trois cas de l'ordre de trois mois.
Cette procédure, qui subordonne l'entrée en vigueur de la norme contestée à l'approbation de la majorité des électeurs, s'applique :
- à presque toutes les lois en Californie ;
- à toutes les lois fédérales et aux arrêtés fédéraux les plus importants en Suisse ;
- aux lois constitutionnelles en Italie, dans la mesure où elles n'ont pas recueilli la majorité des deux tiers des membres de chaque assemblée lors de la seconde délibération.
La procédure est mise en œuvre à la demande de 500 000 électeurs en Italie, de 50 000 électeurs en Suisse, et d'un nombre d'électeurs égal à 5 % des personnes ayant participé à la dernière élection du gouverneur en Californie, ce qui représente environ 400 000 électeurs.
Pour empêcher ce dispositif de paralyser le législateur, ce dernier peut, en Suisse et en Californie, qualifier une loi d'urgente. En Suisse, l'urgence annule l'effet suspensif de la demande de référendum et permet à la norme attaquée d'entrer immédiatement en vigueur, tandis que, en Californie, elle la soustrait définitivement au champ du référendum. De plus, la Constitution californienne exclut qu'une demande de référendum puisse être présentée contre certaines lois, en particulier contre les lois fiscales ou budgétaires.
2) En Italie, les lois en vigueur peuvent être abrogées par un référendum d'initiative populaire
Presque toutes les normes de rang législatif peuvent, à la demande de 500 000 électeurs, être soumises à référendum en vue de leur abrogation, la demande d'abrogation portant sur tout ou partie de la norme contestée.
Cependant, certains textes ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum abrogatif. La Constitution l'exclut pour les lois fiscales et budgétaires, pour les lois d'amnistie et de remise de peine, ainsi que pour les lois autorisant la ratification de traités internationaux. En outre, la Cour constitutionnelle, qui contrôle la recevabilité des demandes de référendum abrogatif, a peu à peu élaboré un ensemble de règles encadrant l'utilisation de ce dispositif. Elle a ainsi soustrait à son champ d'application les normes de rang supérieur à la loi ordinaire. Elle rejette également les demandes de référendum lorsque l'abrogation demandée risque d'altérer l'équilibre institutionnel.
Pour que la norme contestée soit abrogée, il faut, d'une part, que la majorité des votants approuve la proposition et, d'autre part, que la participation électorale atteigne 50 %.
3) En Suisse et en Californie, une fraction du corps électoral peut, par référendum, demander l'adoption de certains textes législatifs
En Californie, les initiatives populaires, qui peuvent avoir pour objet une révision de la Constitution ou l'adoption d'une loi ordinaire, sont soumises à référendum en dehors de toute intervention du Parlement.
Selon qu'elle porte sur une matière constitutionnelle ou législative, une telle initiative doit être présentée par un nombre minimal d'électeurs égal à 8 % ou à 5 % des personnes ayant participé à la dernière élection du gouverneur.
Le dépôt de l'initiative populaire entraîne automatiquement l'organisation d'un référendum, à l'issue duquel la norme proposée peut être définitivement adoptée. Si le Parlement conserve la possibilité de la modifier ou de l'abroger, la loi alors adoptée par le Parlement doit, à son tour, être validée par référendum.
En Suisse, au niveau fédéral, l'initiative populaire doit être présentée par 100 000 électeurs. Elle ne peut être mise en œuvre qu'en matière constitutionnelle.
Sauf dans le cas exceptionnel où elle porte sur une révision totale de la Constitution, l'initiative n'est pas directement soumise aux électeurs, mais elle est d'abord examinée par le Parlement fédéral.
Lorsque l'initiative est rédigée, c'est-à-dire susceptible d'être insérée telle quelle dans la Constitution, le Parlement fédéral peut présenter une contre-proposition. Le référendum porte donc soit sur le texte de l'initiative, soit à la fois sur ce texte et sur la contre-proposition.
En revanche, lorsque l'initiative est présentée sous forme de principes généraux et que le Parlement fédéral ne l'approuve pas, un premier référendum, portant sur l'opportunité de la révision, doit être organisé. Ensuite, si la majorité des votants approuve le principe de la révision, le Parlement fédéral doit élaborer une proposition de révision constitutionnelle, elle-même soumise à référendum. Lorsque le Parlement fédéral approuve une demande présentée en termes généraux, il élabore directement une proposition de révision constitutionnelle, également soumise à référendum.
Les propositions de révision constitutionnelle, qu'elles résultent d'une demande rédigée ou qu'elles aient été élaborées par le Parlement fédéral, doivent être approuvées à la double majorité des votants et des cantons.
Aux trois exemples étudiés, il convient d'ajouter celui de la Belgique, qui ignore actuellement le référendum au niveau fédéral, mais qui étudie la possibilité d'instaurer le référendum consultatif d'initiative populaire. "
Pour accéder au site du Sénat
Nous en reproduisons ci-après la synthèse :
" En France, le référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire le référendum organisé à l'initiative d'une fraction du corps électoral, n'est pas prévu par la Constitution. En effet, celle-ci attribue l'initiative du référendum au président de la République, que le référendum ait lieu dans le cadre de l'article 11 ou dans celui de l'article 89.
Dans le premier cas, c'est le président de la République, sur proposition conjointe des deux assemblées ou, pendant la durée des sessions, sur proposition du gouvernement, qui peut décider de soumettre à référendum « tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou qui tendent à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ».
Dans le second, le référendum constitue en principe l'aboutissement de la révision constitutionnelle, après qu'elle a été approuvée par les deux assemblées en termes identiques. Toutefois, lorsque la révision a pour origine une initiative de l'exécutif, le président de la République peut décider de ne pas la soumettre à référendum, mais au Parlement réuni en Congrès.
Le référendum prévu par la Constitution française est donc un référendum normatif, puisqu'il permet l'adoption d'un texte, législatif ou constitutionnel.
Cependant, dans d'autres pays, le référendum, notamment lorsqu'il est organisé à la demande d'une fraction du corps électoral, peut également être abrogatif ou consultatif. Le premier vise à abroger des textes déjà en vigueur, tandis que le second est organisé pour connaître l'opinion des électeurs, mais n'a aucune valeur contraignante.
La présente étude analyse les dispositions nationales relatives au référendum d'initiative populaire en Italie et en Suisse, seuls pays européens où il existe. En effet, en Autriche et au Portugal, si le mécanisme de l'initiative populaire permet à une fraction du corps électoral de saisir le Parlement fédéral d'une proposition, il n'entraîne pas nécessairement l'organisation d'un référendum.
L'étude examine également l'exemple californien, la Californie étant l'État américain qui recourt le plus souvent au référendum.
L'analyse des dispositions italiennes, suisses et californiennes montre que :
- dans les trois cas, le référendum d'initiative populaire donne aux électeurs un droit de veto sur certains textes que le Parlement vient d'adopter ;
- en Italie, les lois en vigueur peuvent être abrogées par un référendum d'initiative populaire ;
- en Suisse et en Californie, une fraction du corps électoral peut, par référendum, demander l'adoption de textes législatifs.
1) En Italie, en Suisse et en Californie, le référendum d'initiative populaire donne aux électeurs un droit de veto sur certains textes que le Parlement vient d'adopter
Après leur adoption et avant leur entrée en vigueur, certains textes peuvent être soumis à référendum à la demande d'une partie du corps électoral. La demande de référendum a un effet suspensif : l'entrée en vigueur de la norme attaquée est subordonnée au résultat du vote.
Le délai référendaire est exprimé de façon légèrement différente, à la fois en terme de longueur et de point de départ, mais il est dans les trois cas de l'ordre de trois mois.
Cette procédure, qui subordonne l'entrée en vigueur de la norme contestée à l'approbation de la majorité des électeurs, s'applique :
- à presque toutes les lois en Californie ;
- à toutes les lois fédérales et aux arrêtés fédéraux les plus importants en Suisse ;
- aux lois constitutionnelles en Italie, dans la mesure où elles n'ont pas recueilli la majorité des deux tiers des membres de chaque assemblée lors de la seconde délibération.
La procédure est mise en œuvre à la demande de 500 000 électeurs en Italie, de 50 000 électeurs en Suisse, et d'un nombre d'électeurs égal à 5 % des personnes ayant participé à la dernière élection du gouverneur en Californie, ce qui représente environ 400 000 électeurs.
Pour empêcher ce dispositif de paralyser le législateur, ce dernier peut, en Suisse et en Californie, qualifier une loi d'urgente. En Suisse, l'urgence annule l'effet suspensif de la demande de référendum et permet à la norme attaquée d'entrer immédiatement en vigueur, tandis que, en Californie, elle la soustrait définitivement au champ du référendum. De plus, la Constitution californienne exclut qu'une demande de référendum puisse être présentée contre certaines lois, en particulier contre les lois fiscales ou budgétaires.
2) En Italie, les lois en vigueur peuvent être abrogées par un référendum d'initiative populaire
Presque toutes les normes de rang législatif peuvent, à la demande de 500 000 électeurs, être soumises à référendum en vue de leur abrogation, la demande d'abrogation portant sur tout ou partie de la norme contestée.
Cependant, certains textes ne peuvent pas faire l'objet d'un référendum abrogatif. La Constitution l'exclut pour les lois fiscales et budgétaires, pour les lois d'amnistie et de remise de peine, ainsi que pour les lois autorisant la ratification de traités internationaux. En outre, la Cour constitutionnelle, qui contrôle la recevabilité des demandes de référendum abrogatif, a peu à peu élaboré un ensemble de règles encadrant l'utilisation de ce dispositif. Elle a ainsi soustrait à son champ d'application les normes de rang supérieur à la loi ordinaire. Elle rejette également les demandes de référendum lorsque l'abrogation demandée risque d'altérer l'équilibre institutionnel.
Pour que la norme contestée soit abrogée, il faut, d'une part, que la majorité des votants approuve la proposition et, d'autre part, que la participation électorale atteigne 50 %.
3) En Suisse et en Californie, une fraction du corps électoral peut, par référendum, demander l'adoption de certains textes législatifs
En Californie, les initiatives populaires, qui peuvent avoir pour objet une révision de la Constitution ou l'adoption d'une loi ordinaire, sont soumises à référendum en dehors de toute intervention du Parlement.
Selon qu'elle porte sur une matière constitutionnelle ou législative, une telle initiative doit être présentée par un nombre minimal d'électeurs égal à 8 % ou à 5 % des personnes ayant participé à la dernière élection du gouverneur.
Le dépôt de l'initiative populaire entraîne automatiquement l'organisation d'un référendum, à l'issue duquel la norme proposée peut être définitivement adoptée. Si le Parlement conserve la possibilité de la modifier ou de l'abroger, la loi alors adoptée par le Parlement doit, à son tour, être validée par référendum.
En Suisse, au niveau fédéral, l'initiative populaire doit être présentée par 100 000 électeurs. Elle ne peut être mise en œuvre qu'en matière constitutionnelle.
Sauf dans le cas exceptionnel où elle porte sur une révision totale de la Constitution, l'initiative n'est pas directement soumise aux électeurs, mais elle est d'abord examinée par le Parlement fédéral.
Lorsque l'initiative est rédigée, c'est-à-dire susceptible d'être insérée telle quelle dans la Constitution, le Parlement fédéral peut présenter une contre-proposition. Le référendum porte donc soit sur le texte de l'initiative, soit à la fois sur ce texte et sur la contre-proposition.
En revanche, lorsque l'initiative est présentée sous forme de principes généraux et que le Parlement fédéral ne l'approuve pas, un premier référendum, portant sur l'opportunité de la révision, doit être organisé. Ensuite, si la majorité des votants approuve le principe de la révision, le Parlement fédéral doit élaborer une proposition de révision constitutionnelle, elle-même soumise à référendum. Lorsque le Parlement fédéral approuve une demande présentée en termes généraux, il élabore directement une proposition de révision constitutionnelle, également soumise à référendum.
Les propositions de révision constitutionnelle, qu'elles résultent d'une demande rédigée ou qu'elles aient été élaborées par le Parlement fédéral, doivent être approuvées à la double majorité des votants et des cantons.
Aux trois exemples étudiés, il convient d'ajouter celui de la Belgique, qui ignore actuellement le référendum au niveau fédéral, mais qui étudie la possibilité d'instaurer le référendum consultatif d'initiative populaire. "
Pour accéder au site du Sénat
- causonsen
- Messages: 309
- Enregistré le: Mar 13 Mar 2012 19:15
Re: QDQ - L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Profitons-en pour faire le point sur le référendum d'initiative "populaire" à la française, initié sous Sarkozy et poursuivi sous Hollande.
Un article du Huffington Post (21 novembre 2013) lui règle joliment son compte :
Extraits :
" Le référendum d'initiative "populaire" voté mais toujours inapplicable
(...) Les deux projets de loi sur le référendum d'initiative populaire promis par François Hollande ont obtenu le feu vert du Parlement ce jeudi 21 novembre, rendant théoriquement possible l'organisation d'une consultation à l'initiative des citoyens. (...)
Déjà votés mardi à l'Assemblée, les deux textes ont été approuvés par les sénateurs par 326 voix pour, tandis que les 20 sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) ont voté contre.
Sur le papier, un nouveau droit est donc désormais ouvert aux citoyens français: "à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement", une proposition de loi pourra être soumise à une consultation populaire et devra recueillir le soutien d'un "dixième des électeurs" pour s'imposer dans le calendrier législatif. Si le Parlement ne se saisit pas de la question dans un délai qui reste à définir, le président de la République est alors tenu de convoquer un référendum.
Une chance pour les défenseurs du droit de vote des étrangers qui militent (en vain) pour une révision constitutionnelle ? Pas du tout. Car le scénario d'un référendum d'initiative populaire "n'arrivera probablement jamais", prévient le président socialiste de la Commission des Lois à l'Assemblée, Jean-Jacques Urvoas.
Explications.
Un référendum partagé et non populaire
En réalité, le dispositif inscrit dans la Constitution n'a rien d'un référendum populaire : l'initiative appartient ici aux élus qui devront ensuite obtenir une caution populaire (exceptionnelle, nous y reviendrons) pour s'autosaisir d'une proposition de loi. Si au moins 185 parlementaires (1/5e du Parlement) ne proposent pas un texte de loi, ni les ONG ni les citoyens n'auront voix au chapitre.
Ce dispositif s'apparente ainsi d'avantage à une arme destinée à l'opposition plutôt qu'à un outil de démocratie participative. C'est pourquoi le dispositif a été renommé par les parlementaires "référendum d'initiative partagée".
(...)
Une pétition totalement inatteignable
Si tant est que le processus soit enclenché par les élus, les chances de réunir les signatures nécessaires sont "quasiment impossibles", tranche le constitutionnaliste Pascal Jan. La Constitution exige en effet qu'un électeur inscrit sur les listes électorales sur dix appuie une initiative pour qu'elle s'impose au Parlement. Soit... 4,5 millions de signatures.
(...)
Hypothèse d'école: imaginons que, par miracle, les défenseurs du droit de vote des étrangers obtiennent les signatures nécessaires. La proposition de loi reviendrait alors au Parlement qui devra s'en saisir dans des délais précis (qui seront définis dans le projet de loi organique), faute de quoi un référendum devrait être convoqué par le président de la République.
Problème: l'article inscrit dans la Constitution prévoit un autre obstacle majeur pour éviter le recours au référendum. Le texte prévoit qu'un référendum est convoqué uniquement "si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées" dans le délai prescrit. En clair, "il suffira aux deux chambres d'examiner -même pas de le rejeter- le texte pour que la voie référendaire s'écroule", explique au HuffPost le député socialiste Jean-Jacques Urvoas, président de la Commission des Lois.
"S'il est interprété au sens propre, le terme 'examiner' interdit de fait tout référendum", confirme le constitutionnaliste Pascal Jan, non sans évoquer la possibilité (infime) que la loi organique ne précise l'emploi de cette expression. "
Bref, le Référendum d'initiative populaire est à la France ce que l'Initiative citoyenne est à l'Europe : un progrès illusoire.
Sans doute considère-t-on que la politique est une affaire trop sérieuse pour laisser les citoyens s'en mêler de trop près.
Pour accéder au site du Huffington Post
Un article du Huffington Post (21 novembre 2013) lui règle joliment son compte :
Extraits :
" Le référendum d'initiative "populaire" voté mais toujours inapplicable
(...) Les deux projets de loi sur le référendum d'initiative populaire promis par François Hollande ont obtenu le feu vert du Parlement ce jeudi 21 novembre, rendant théoriquement possible l'organisation d'une consultation à l'initiative des citoyens. (...)
Déjà votés mardi à l'Assemblée, les deux textes ont été approuvés par les sénateurs par 326 voix pour, tandis que les 20 sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen (CRC) ont voté contre.
Sur le papier, un nouveau droit est donc désormais ouvert aux citoyens français: "à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement", une proposition de loi pourra être soumise à une consultation populaire et devra recueillir le soutien d'un "dixième des électeurs" pour s'imposer dans le calendrier législatif. Si le Parlement ne se saisit pas de la question dans un délai qui reste à définir, le président de la République est alors tenu de convoquer un référendum.
Une chance pour les défenseurs du droit de vote des étrangers qui militent (en vain) pour une révision constitutionnelle ? Pas du tout. Car le scénario d'un référendum d'initiative populaire "n'arrivera probablement jamais", prévient le président socialiste de la Commission des Lois à l'Assemblée, Jean-Jacques Urvoas.
Explications.
Un référendum partagé et non populaire
En réalité, le dispositif inscrit dans la Constitution n'a rien d'un référendum populaire : l'initiative appartient ici aux élus qui devront ensuite obtenir une caution populaire (exceptionnelle, nous y reviendrons) pour s'autosaisir d'une proposition de loi. Si au moins 185 parlementaires (1/5e du Parlement) ne proposent pas un texte de loi, ni les ONG ni les citoyens n'auront voix au chapitre.
Ce dispositif s'apparente ainsi d'avantage à une arme destinée à l'opposition plutôt qu'à un outil de démocratie participative. C'est pourquoi le dispositif a été renommé par les parlementaires "référendum d'initiative partagée".
(...)
Une pétition totalement inatteignable
Si tant est que le processus soit enclenché par les élus, les chances de réunir les signatures nécessaires sont "quasiment impossibles", tranche le constitutionnaliste Pascal Jan. La Constitution exige en effet qu'un électeur inscrit sur les listes électorales sur dix appuie une initiative pour qu'elle s'impose au Parlement. Soit... 4,5 millions de signatures.
(...)
Hypothèse d'école: imaginons que, par miracle, les défenseurs du droit de vote des étrangers obtiennent les signatures nécessaires. La proposition de loi reviendrait alors au Parlement qui devra s'en saisir dans des délais précis (qui seront définis dans le projet de loi organique), faute de quoi un référendum devrait être convoqué par le président de la République.
Problème: l'article inscrit dans la Constitution prévoit un autre obstacle majeur pour éviter le recours au référendum. Le texte prévoit qu'un référendum est convoqué uniquement "si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées" dans le délai prescrit. En clair, "il suffira aux deux chambres d'examiner -même pas de le rejeter- le texte pour que la voie référendaire s'écroule", explique au HuffPost le député socialiste Jean-Jacques Urvoas, président de la Commission des Lois.
"S'il est interprété au sens propre, le terme 'examiner' interdit de fait tout référendum", confirme le constitutionnaliste Pascal Jan, non sans évoquer la possibilité (infime) que la loi organique ne précise l'emploi de cette expression. "
Bref, le Référendum d'initiative populaire est à la France ce que l'Initiative citoyenne est à l'Europe : un progrès illusoire.
Sans doute considère-t-on que la politique est une affaire trop sérieuse pour laisser les citoyens s'en mêler de trop près.
Pour accéder au site du Huffington Post
- voxpop
- Messages: 304
- Enregistré le: Ven 24 Fév 2012 11:41
Re: QDQ - L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Un brin optimiste, NEAsay, l'organe d'information de EU-LOGOS.ORG, titre, en date du 21 mars 2014 : " Vers une reconnaissance du droit à l'eau. Un droit fondamental ! La démocratie européenne est en marche ! Le prochain cas l'énergie ? "
Extraits de l'article :
" Cette initiative citoyenne européenne (ICE) "Right2Water" vise à ce que le droit à l'eau et à l'assainissement soit reconnu comme droit de l'homme, et appelait la Commission à proposer une législation qui garantisse ce droit. La mise en place d'un service public et l'exclusion du marché de l'eau de la libéralisation faisaient également partie des revendications de l'ICE. «Right2Water» ont demandé à la Commission de faire en sorte que tous les citoyens de l'UE jouissent du droit à l'eau et à garantir ce droit dans le monde entier. Enfin veiller à ce que l'accès aux ressources hydriques ne soient pas soumis aux règles du marché intérieur. "
Bon programme. Par contre, comment l'UE pourrait-elle " garantir ce droit (à l'eau) dans le monde entier ?
" La Commission expose sa réaction dans une communication (cf. infra « pour en savoir plus »), qui s'attache tout d'abord à décrire l'énorme volume de travail déjà accompli par l'UE dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Ainsi, l'UE a établi des normes ambitieuses pour la qualité de l'eau et apporté une aide financière pour le développement et l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau dans les États membres.
La décision sur l'optimisation des services liés à l'eau est entièrement du ressort des pouvoirs publics des États membres, et la Commission continuera à se conformer aux règles du traité imposant à l'UE de rester neutre à l'égard des décisions nationales régissant le régime de propriété des entreprises de distribution d'eau. De même, dans les négociations commerciales internationales, la Commission continuera de veiller à ce que les choix faits à l'échelon national, régional et local en matière de gestion des services liés à l'eau soient respectés et garantis. "
Bel exercice de promotion / diplomatie : on commence par décrire " l'énorme volume de travail déjà accompli par l'UE ".
On botte ensuite en touche : " La décision sur l'optimisation des services liés à l'eau est entièrement du ressort des pouvoirs publics des États membres, et la Commission continuera à se conformer aux règles du traité imposant à l'UE de rester neutre à l'égard des décisions nationales régissant le régime de propriété des entreprises de distribution d'eau. "
Ce à quoi s'engage la Commission : (c'est nous nous soulignons) :
" La Commission s'est engagée, à prendre les mesures concrètes et nouvelles actions suivantes dans les domaines qui présentent un intérêt direct pour l'initiative et ses objectifs :
• intensifier les efforts en vue de la mise en œuvre intégrale par les États membres de la législation de l'UE sur l'eau;
• lancer une consultation publique au niveau de l'UE concernant la directive sur l'eau potable pour déterminer les améliorations à apporter et la manière de procéder;
• améliorer l'information aux citoyens grâce à une gestion et à une diffusion des données simplifiées et plus transparentes dans le domaine des eaux urbaines résiduaires et de l'eau potable;
• instaurer un dialogue structuré entre les parties prenantes sur la transparence dans le secteur de l'eau;
• coopérer avec des initiatives existantes dans le but de définir un ensemble de critères de référence plus large pour les services liés à l'eau, améliorant ainsi la transparence et responsabilisant davantage les prestataires dans ce domaine en mettant à la disposition des citoyens des données sur les principaux indicateurs
économiques et qualitatifs;
• encourager les approches innovantes pour l'aide au développement (par exemple, soutien aux partenariats entre les compagnies de distribution d'eau et aux partenariats public-public) et promouvoir les bonnes pratiques entre les États membres (portant, par exemple, sur les instruments de solidarité);
• promouvoir l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement en tant que domaine prioritaire dans les objectifs de développement durable pour l'après-2015;
• enfin, inviter les États membres, agissant dans le cadre de leurs compétences, à tenir compte des préoccupations exprimées par les citoyens au moyen de cette initiative et les encourager à intensifier leurs efforts pour garantir la fourniture d'eau potable à un prix abordable pour tous.
• [i]étudier la mise en place d'une évaluation comparative de la qualité de l'eau.[/i] "
Bref, tout cela va consommer beaucoup d'énergie mais n'engage à rien.
On nous dit pourtant que " «Right2Water», la première initiative citoyenne européenne à avoir abouti, a recueilli le soutien de 1,68 million de citoyens et les seuils légaux ont été largement dépassés dans 13 États membres. "
Attendons maintenant de voir si la Commission se décide à soumettre une proposition législative et quel sera son contenu. En l'état actuel des choses, la procédure ICE ne contraint en rien la Commission à dépasser le stade des bonnes intentions.
Incidemment l'article nous apprend que " Au total, plus de 5 millions de citoyens de l'UE ont, pour l'heure, signé plus de 20 initiatives différentes. " (y compris Right2Water ?). Cela fait une moyenne de 250.000 signatures par ICE, très en-deçà du seuil minimum de 1.000.000.
Pour accéder à l'article complet et aux liens qu'il propose : NEAsay
Extraits de l'article :
" Cette initiative citoyenne européenne (ICE) "Right2Water" vise à ce que le droit à l'eau et à l'assainissement soit reconnu comme droit de l'homme, et appelait la Commission à proposer une législation qui garantisse ce droit. La mise en place d'un service public et l'exclusion du marché de l'eau de la libéralisation faisaient également partie des revendications de l'ICE. «Right2Water» ont demandé à la Commission de faire en sorte que tous les citoyens de l'UE jouissent du droit à l'eau et à garantir ce droit dans le monde entier. Enfin veiller à ce que l'accès aux ressources hydriques ne soient pas soumis aux règles du marché intérieur. "
Bon programme. Par contre, comment l'UE pourrait-elle " garantir ce droit (à l'eau) dans le monde entier ?
" La Commission expose sa réaction dans une communication (cf. infra « pour en savoir plus »), qui s'attache tout d'abord à décrire l'énorme volume de travail déjà accompli par l'UE dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Ainsi, l'UE a établi des normes ambitieuses pour la qualité de l'eau et apporté une aide financière pour le développement et l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau dans les États membres.
La décision sur l'optimisation des services liés à l'eau est entièrement du ressort des pouvoirs publics des États membres, et la Commission continuera à se conformer aux règles du traité imposant à l'UE de rester neutre à l'égard des décisions nationales régissant le régime de propriété des entreprises de distribution d'eau. De même, dans les négociations commerciales internationales, la Commission continuera de veiller à ce que les choix faits à l'échelon national, régional et local en matière de gestion des services liés à l'eau soient respectés et garantis. "
Bel exercice de promotion / diplomatie : on commence par décrire " l'énorme volume de travail déjà accompli par l'UE ".
On botte ensuite en touche : " La décision sur l'optimisation des services liés à l'eau est entièrement du ressort des pouvoirs publics des États membres, et la Commission continuera à se conformer aux règles du traité imposant à l'UE de rester neutre à l'égard des décisions nationales régissant le régime de propriété des entreprises de distribution d'eau. "
Ce à quoi s'engage la Commission : (c'est nous nous soulignons) :
" La Commission s'est engagée, à prendre les mesures concrètes et nouvelles actions suivantes dans les domaines qui présentent un intérêt direct pour l'initiative et ses objectifs :
• intensifier les efforts en vue de la mise en œuvre intégrale par les États membres de la législation de l'UE sur l'eau;
• lancer une consultation publique au niveau de l'UE concernant la directive sur l'eau potable pour déterminer les améliorations à apporter et la manière de procéder;
• améliorer l'information aux citoyens grâce à une gestion et à une diffusion des données simplifiées et plus transparentes dans le domaine des eaux urbaines résiduaires et de l'eau potable;
• instaurer un dialogue structuré entre les parties prenantes sur la transparence dans le secteur de l'eau;
• coopérer avec des initiatives existantes dans le but de définir un ensemble de critères de référence plus large pour les services liés à l'eau, améliorant ainsi la transparence et responsabilisant davantage les prestataires dans ce domaine en mettant à la disposition des citoyens des données sur les principaux indicateurs
économiques et qualitatifs;
• encourager les approches innovantes pour l'aide au développement (par exemple, soutien aux partenariats entre les compagnies de distribution d'eau et aux partenariats public-public) et promouvoir les bonnes pratiques entre les États membres (portant, par exemple, sur les instruments de solidarité);
• promouvoir l'accès universel à l'eau potable et à l'assainissement en tant que domaine prioritaire dans les objectifs de développement durable pour l'après-2015;
• enfin, inviter les États membres, agissant dans le cadre de leurs compétences, à tenir compte des préoccupations exprimées par les citoyens au moyen de cette initiative et les encourager à intensifier leurs efforts pour garantir la fourniture d'eau potable à un prix abordable pour tous.
• [i]étudier la mise en place d'une évaluation comparative de la qualité de l'eau.[/i] "
Bref, tout cela va consommer beaucoup d'énergie mais n'engage à rien.
On nous dit pourtant que " «Right2Water», la première initiative citoyenne européenne à avoir abouti, a recueilli le soutien de 1,68 million de citoyens et les seuils légaux ont été largement dépassés dans 13 États membres. "
Attendons maintenant de voir si la Commission se décide à soumettre une proposition législative et quel sera son contenu. En l'état actuel des choses, la procédure ICE ne contraint en rien la Commission à dépasser le stade des bonnes intentions.
Incidemment l'article nous apprend que " Au total, plus de 5 millions de citoyens de l'UE ont, pour l'heure, signé plus de 20 initiatives différentes. " (y compris Right2Water ?). Cela fait une moyenne de 250.000 signatures par ICE, très en-deçà du seuil minimum de 1.000.000.
Pour accéder à l'article complet et aux liens qu'il propose : NEAsay
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: QDQ - L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Au détour d'un article paru dans le Huffington Post du 6 avril 2014, cosigné par Patrick Martin-Genier, Maître de conférence en droit public à Science-Po et Henri Malosse, président du Conseil économique et social européen, on découvre cet avis, qui illustre bien la considération portée par la Commission européenne à la procédure ICE (Initiative citoyenne européenne) :
" (...) Depuis vingt ans, toutes les enquêtes d'opinion ont montré que la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions européennes s'érode de plus en plus, pour devenir aujourd'hui négative dans une majorité de pays de l'UE ! Il faut dire que la Commission européenne n'y a pas vraiment mis du sien pour regagner la confiance des citoyens ! Un exemple frappant, le traitement des Initiatives Citoyennes Européennes (ICE), la seule innovation majeure du traité de Lisbonne. L'ICE aurait pu permettre de faire regagner la confiance en donnant un droit de proposition aux citoyens (s'ils sont plus d'1 million venus au moins de 7 pays différents).
Or, en écartant toute idée de transformer la première Initiative ayant réussi à récolter près de 1,9 millions de signatures (Right2water, projet dont la finalité est que l'accès à l'eau pour tous soit garantie dans l'UE), la Commission a non seulement refusé un projet très légitime, mais surtout commis une faute politique majeure à deux mois des élections européennes, laissant à tout le moins supposer une forme de mépris à l'égard de celles et ceux qu'elle doit représenter, précisément au nom de l'intérêt général ! "
On ne saurait mieux dire.
" (...) Depuis vingt ans, toutes les enquêtes d'opinion ont montré que la confiance des citoyens vis-à-vis des institutions européennes s'érode de plus en plus, pour devenir aujourd'hui négative dans une majorité de pays de l'UE ! Il faut dire que la Commission européenne n'y a pas vraiment mis du sien pour regagner la confiance des citoyens ! Un exemple frappant, le traitement des Initiatives Citoyennes Européennes (ICE), la seule innovation majeure du traité de Lisbonne. L'ICE aurait pu permettre de faire regagner la confiance en donnant un droit de proposition aux citoyens (s'ils sont plus d'1 million venus au moins de 7 pays différents).
Or, en écartant toute idée de transformer la première Initiative ayant réussi à récolter près de 1,9 millions de signatures (Right2water, projet dont la finalité est que l'accès à l'eau pour tous soit garantie dans l'UE), la Commission a non seulement refusé un projet très légitime, mais surtout commis une faute politique majeure à deux mois des élections européennes, laissant à tout le moins supposer une forme de mépris à l'égard de celles et ceux qu'elle doit représenter, précisément au nom de l'intérêt général ! "
On ne saurait mieux dire.
- causonsen
- Messages: 309
- Enregistré le: Mar 13 Mar 2012 19:15
Re: QDQ - L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'initiative elle-même, son site est : http://www.right2water.eu/fr/
- agénor
- Site Admin
- Messages: 287
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:12
12 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Des procédures pour faire bouger l'Europe
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités