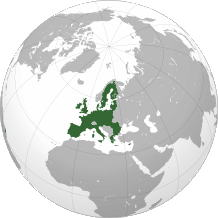" La France dans l'Union européenne " constitue une précieuse référence statistique, fondée en grande partie sur les données " Eurostat " "système statistique de l'Union européenne.
Outre son contenu, c'est la rigueur méthodologique de cet ouvrage (définition précise des données et des sources) qui en fait l'intérêt.
Nous en avons extrait les paragraphes qui introduisent les principaux chapitres.
" Introduction
À la veille des élections européennes, cet ouvrage rassemble les principaux éléments de cadrage statistique permettant de comparer la situation économique et sociale de la France à celle de ses partenaires de l’Union européenne. Une telle mise en perspective dégage les grandes tendances, communes ou divergentes, affectant l’Union dans son ensemble. Cela est d’autant plus important que l’Union, constituée en 1958 de six pays, en comporte aujourd’hui vingt-huit, aux histoires et aux situations géographiques variées, aux niveaux de développement économique et aux structures institutionnelles et sociales différents. C’est dire si le travail de comparaison est délicat. Cet ouvrage est dans la lignée de celui publié en 2008, année où la France a présidé l’Union européenne.
Cinq dossiers traitent de la croissance économique, des inégalités et de la pauvreté, des nouvelles catégories socio-économiques européennes, des sorties précoces du système scolaire et des échanges extérieurs agroalimentaires. Une vingtaine de fiches présentent de manière synthétique les questions liées à la population, aux conditions de vie, au marché du travail et à l’économie.
La statistique publique produit régulièrement des éléments permettant de réaliser des comparaisons européennes. En particulier, des fiches internationales sont publiées dans la plupart des ouvrages thématiques de la collection « Insee Références ». Plusieurs de ces documents sont repris ici.
Cet ouvrage s’adresse aux personnes cherchant à mieux connaître les économies européennes et l’insertion de notre pays dans l’Union, qu’il s’agisse d’étudiants, d’enseignants, de chercheurs,
d’acteurs publics ou de citoyens désireux de disposer d’éléments de cadrage objectifs et utiles à une participation éclairée au débat démocratique.
(...)
L’Union européenne : une puissance économique « unie dans la diversité »
L’Union européenne, considérée dans son ensemble, est aujourd’hui une puissance économique à croissance modérée, dont le processus de rattrapage par rapport aux États-Unis s’est interrompu il y a plus de 30 ans ,mais dont les déséquilibres macroéconomiques sont comparativement moins marqués. Pris individuellement, les pays qui composent l’Union européenne restent très hétérogènes d’un point de vue macroéconomique. Une description fondée sur un ensemble de critères reflétant cette hétérogénéité les classe en quatre groupes : les « pays de l’Est » (pays baltes, Bulgarie et Roumanie) dont la phase de rattrapage par rapport au reste de la zone est toujours en cours ; les « pays du centre de l’Europe » (Croatie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie et Slovénie, ainsi que Malte), également dans une phase de rattrapage mais qui se distinguent du groupe précédent par le moindre impact de la crise sur leur économie ; les « pays de la périphérie » (Irlande, Grèce,
Espagne, Chypre, Portugal et Royaume-Uni) pour lesquels la crise s’est traduite par un affaiblissement de la croissance, une augmentation du taux de chômage et un accroissement de la dette publique plus importants que dans les autres pays européens ; les « pays de l’Ouest et du Nord » (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Pays-Bas et Suède), groupe qui rassemble des pays dont les performances récentes ne sont pas pleinement homogènes mais qui ont comme caractéristique commune d’être des économies matures ayant montré une certaine résilience à la crise.
(...)
Inégalités, pauvreté et protection sociale en Europe : état des lieux et impact de la crise
En 2011, le niveau de vie médian de la France la place au sein des pays de l’Union européenne à revenus élevés. En termes d’inégalités de niveaux de vie, la France se situe dans la moyenne des 28 pays européens. Les indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale utilisés au niveau européen – pauvreté monétaire, privation matérielle et exclusion du marché du travail – la situent cependant dans une position plutôt favorable vis-à-vis de ses voisins européens. Cette position tient au fait que notre pays fait partie des plus avancés en termes de niveau de développement économique ; elle est aussi due à l’importance relative des transferts sociaux.
Toutefois, depuis le début de la crise, les inégalités de niveau de vie se sont légèrement redressées en France, tandis qu’elles sont restées relativement stables en Europe. De même, si la pauvreté monétaire reste plus basse que la moyenne européenne, elle a un peu augmenté depuis 2007. De fait, les transferts sociaux ont certes amorti le premier impact de la crise en 2008 et 2009, mais cet effet bénéfique s’est ensuite un peu atténué.
En revanche, l’augmentation du risque de pauvreté et d’exclusion sociale dans son ensemble a été plus faible en France qu’en Europe. De nombreux pays européens ont été beaucoup plus touchés par la crise (Europe du Sud, Irlande, pays baltes…).
(...)
Les Européens au travail en sept catégories socio-économiques
En 2011, 218 millions de personnes de 15 ans ou plus travaillaient dans l’un des 27 pays de l’Union européenne (UE). Décrire le fonctionnement de ce marché du travail à travers le seul prisme des activités économiques (agriculture, industrie, services…) n’est pas suffisant.
Un nouvel outil alliant l’économique et le social permettra d’aller plus loin dans l’analyse de cet espace complexe qu’est l’Union européenne, en répartissant la population active en sept groupes socio-économiques homogènes, allant du cadre dirigeant à l’employé le moins qualifié. Cette grille de lecture est utile, par exemple, pour analyser le fonctionnement du marché du travail de chaque pays (risque de chômage, temps partiel, mobilité…) ainsi que l’impact de la crise économique sur son évolution.
(...)
Réduire les sorties précoces : un objectif central du programme « Éducation et formation 2020 »
Les politiques d’éducation et de formation de l’Union européenne ont conquis une place nouvelle depuis la stratégie de Lisbonne (2000) et le programme « Éducation et formation 2020 » (2009) intégré à la stratégie « Europe 2020 ». Si chaque État membre conserve une souveraineté politique, les retombées sont fortes sur le pilotage national des systèmes d’éducation et de formation. On présente ici l’un des critères de référence retenu par l’Union européenne, associé à des enjeux socio-économiques majeurs : les sorties précoces. Ces dernières désignent les jeunes qui ont quitté le système éducatif sans diplôme et sans suivre de formation après leur sortie. Au-delà des nombreuses difficultés que pose leur mesure dans un cadre de comparaison internationale, il apparaît qu’un jeune Européen sur huit sort précocement du système scolaire. La France est dans une situation légèrement meilleure que la moyenne européenne, les sorties précoces étant plus fréquentes dans le sud de l’Europe. Aux Pays-Bas particulièrement où une politique volontariste a été suivie, les sorties précoces ont connu une décrue rapide (de 16 % au début des années 2000 à moins de 9 % en 2012).
(...)
Les échanges extérieurs agricoles et agroalimentaires de l’Union européenne
Depuis la crise survenue à la fin 2008, la production européenne de produits agricoles et agroalimentaires n’augmente plus. Les échanges extérieurs des pays européens, qui affichaient une forte croissance, ralentissent ausi bien en valeur qu’en volume. Les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers stagnent. Mais les exportations vers les pays tiers, soutenues par la demande en provenance d’Asie accélèrent.
Au sein de l’Union européenne (UE), la France, premier exportateur vers les pays tiers, suit cette tendance. En revanche, à destination des pays de l’UE, les exportations françaises augmentent deux fois moins vite que celles des autres pays européens. Néanmoins, la France reste le troisième exportateur européen, toutes destinations confondues. "
Ces quelques développements ne sont qu'un pâle reflet de la richesse de l'ouvrage de l'INSEE, qui est par ailleurs abondamment illustré de tableaux et graphiques.
Pour y accéder : INSEE
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Faits et chiffres : " La France dans l'Union européenne " (INSEE - Edition 2014)
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers Informations et analyses globales et comparatives
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- France / Allemagne 2014 - Un comparatif par Natixis
par causonsen » Lun 09 Juin 2014 12:59 - 0 Réponses
- 1683 Vus
- Dernier message par causonsen

Lun 09 Juin 2014 12:59
- France / Allemagne 2014 - Un comparatif par Natixis
-
- " What's the matter with France ", par Paul Krugman (The New York Times)
par causonsen » Jeu 28 Aoû 2014 16:21 - 0 Réponses
- 1568 Vus
- Dernier message par causonsen

Jeu 28 Aoû 2014 16:21
- " What's the matter with France ", par Paul Krugman (The New York Times)
-
- Selon Ernst and Young : " Il est beaucoup plus simple de créer une entreprise en France qu'ailleurs " !
par causonsen » Ven 30 Aoû 2013 18:56 - 0 Réponses
- 1458 Vus
- Dernier message par causonsen

Ven 30 Aoû 2013 18:56
- Selon Ernst and Young : " Il est beaucoup plus simple de créer une entreprise en France qu'ailleurs " !
-
- " Temps partiel et partage du travail : comparaison France / Allemagne " - Une étude de la Direction du Trésor
par causonsen » Mer 28 Jan 2015 21:26 - 0 Réponses
- 1422 Vus
- Dernier message par causonsen

Mer 28 Jan 2015 21:26
- " Temps partiel et partage du travail : comparaison France / Allemagne " - Une étude de la Direction du Trésor
-
- " Comment l'évolution des coûts salariaux unitaires en France se situe-t-elle par rapport aux partenaires de la zone euro ? "
par voxpop » Ven 05 Sep 2014 20:40 - 0 Réponses
- 1471 Vus
- Dernier message par voxpop

Ven 05 Sep 2014 20:40
- " Comment l'évolution des coûts salariaux unitaires en France se situe-t-elle par rapport aux partenaires de la zone euro ? "
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité