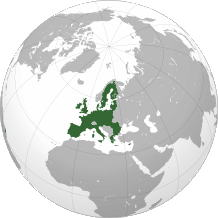La Cour de Luxembourg (CJUE, Cour de justice de l’Union européenne) vient de se prononcer contre l’adhésion de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme.
Pour comprendre cette décision apparemment déroutante, il faut se souvenir - belle illustration de « l’Europe plurielle » - que « deux Europe » et deux juridictions sont ici en jeu :
- l’Union européenne (UE, 28 Etats membres), à laquelle se rattache la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE ou Cour de Luxembourg) ;
- le Conseil de l’Europe (CE, 47 Etats membres, parmi lesquels les 28 Etats membres de l’UE), auquel se rattache la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH ou Cour de Strasbourg).
La Convention européenne des droits de l’homme est une émanation du Conseil de l’Europe et non de l’Union européenne. Elle est présentée comme suit sur le site institutionnel de la CEDH :
« La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’homme a été ouverte à la signature à Rome le 1er novembre 1950 et est entrée en vigueur en 1953. Elle a été le premier instrument concrétisant et rendant contraignants certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
L’importance de la Convention réside non seulement dans l’étendue des droits fondamentaux qu’elle protège, mais aussi dans le mécanisme de protection établi à Strasbourg pour examiner les violations alléguées et veiller au respect par les Etats de leurs obligations découlant de la Convention. Ainsi, en 1959, la Cour européenne des droits de l’homme a été instituée. (…) Elle peut être saisie directement de requêtes individuelles et étatiques alléguant de violations des droits civils et politiques énoncés dans la Convention.
Depuis son adoption en 1950, la Convention a été amendée plusieurs fois et enrichie de nombreux droits qui sont venus s’ajouter au texte initial. »
De son côté, l’Union européenne s’est dotée d’une Charte des droits fondamentaux, présentée comme suit sur le site Europa de L’UE :
« La Charte des droits fondamentaux reconnaît un ensemble de droits personnels, civils, politiques, économiques et sociaux aux citoyens de l’UE et les inscrit dans la législation de l’UE.
En juin 1999, (…) il a été jugé opportun de réunir les droits fondamentaux en vigueur au niveau de l’Union européenne (UE) dans une charte de manière à leur donner une plus grande visibilité. Selon les attentes des chefs d’État ou de gouvernement, cette charte devait contenir les principes généraux énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 et ceux résultant des traditions constitutionnelles communes des pays de l’UE. Par ailleurs, la charte devait inclure les droits fondamentaux réservés aux citoyens de l’Union européenne et les droits économiques et sociaux tels qu’énoncés dans la charte sociale du Conseil de l’Europe et dans la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs. Elle devait également refléter les principes résultant de la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme. (…)
(La charte) a été formellement adoptée à Nice en décembre 2000 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission. En décembre 2009, avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la charte s’est vue confier la même force juridique obligatoire que les traités. À cette fin, la charte a été modifiée et proclamée une deuxième fois en décembre 2007.
La charte réunit en un seul document les droits qui, jusqu’à présent, étaient dispersés dans divers instruments législatifs, tels que les législations nationales et de l’UE, ainsi que les conventions internationales du Conseil de l’Europe, des Nations unies (ONU) et de l’Organisation internationale du travail (OIT). En donnant visibilité et clarté aux droits fondamentaux, la charte instaure une sécurité juridique au sein de l’UE. (…)
La signification et le champ d’application de tout droit qui correspond aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme doivent être conformes à ceux définis par celle-ci. À noter que la législation de l’UE peut prévoir une protection plus étendue. »
Il faut donc comprendre que, alors même que la Charte des droits fondamentaux, instrument de l’UE, « contient les principes généraux énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 », la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée contre l’adhésion pure et simple de l’UE à la Convention européenne des droits de l’homme. Il semble que l’objectif des magistrats de CJUE soit ici d’éviter que l’UE puisse être poursuivie devant la CEDH dans des affaires qui respecteraient par ailleurs la Charte des droits fondamentaux.
Exemple : l'UE se refuse à être poursuivie devant la CEDH parce qu'elle se serait opposée à la clause d'arbitrage dans le TAFTA (Transatlantic free trade agreement).
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
QDQ - La Cour de justice de l'Union européenne s'oppose à l'adhésion de l'UE à la Convention européenne des droits de l'homme
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers Les institutions européennes
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Comment la Cour de justice européenne alimente le déficit démocratique de l'UE
par gerald » Jeu 06 Juil 2017 14:46 - 0 Réponses
- 3210 Vus
- Dernier message par gerald

Jeu 06 Juil 2017 14:46
- Comment la Cour de justice européenne alimente le déficit démocratique de l'UE
-
- QDQ - L'initiative législative au sein de l'Union européenne : qu'en est-il ?
par voxpop » Lun 21 Avr 2014 21:31 - 0 Réponses
- 1590 Vus
- Dernier message par voxpop

Lun 21 Avr 2014 21:31
- QDQ - L'initiative législative au sein de l'Union européenne : qu'en est-il ?
-
- QDQ - La majorité qualifiée au Conseil de l'Union Européenne
par pierre » Jeu 04 Avr 2013 12:22 - 0 Réponses
- 1669 Vus
- Dernier message par pierre

Jeu 04 Avr 2013 12:22
- QDQ - La majorité qualifiée au Conseil de l'Union Européenne
-
- QDQ - Connaissez-vous le Comité des régions de l'Union européenne ?
par causonsen » Mer 29 Oct 2014 21:14 - 0 Réponses
- 1563 Vus
- Dernier message par causonsen

Mer 29 Oct 2014 21:14
- QDQ - Connaissez-vous le Comité des régions de l'Union européenne ?
-
- QDQ - Ce qui va changer cette année dans le processus de désignation du Président de la Commission européenne
par scripta manent » Ven 21 Fév 2014 20:35 - 8 Réponses
- 2120 Vus
- Dernier message par causonsen

Ven 13 Juin 2014 21:36
- QDQ - Ce qui va changer cette année dans le processus de désignation du Président de la Commission européenne
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités