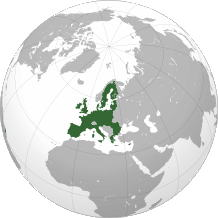L’enlisement institutionnel de l’UE : la directive « congé maternité »
Dans son numéro de janvier 2016, le « Monde Diplomatique » publie une enquête d’Anne-Cécile Robert sur « L’édifiant destin de la directive européenne sur le congé maternité » dont elle fait le symbole de certaines tares institutionnelles de l’UE.
Résumé :
Actuellement le congé maternité dans l’UE varie beaucoup selon les Etats à la fois par sa durée (du simple au quintuple), la définition des ayants droit, les montants et les types de prestations. La politique sociale, dont les droits de congé maternité font partie, relève du principe de subsidiarité, c’est à dire les sujets traités en priorité par les Etats, l’UE ne pouvant adopter que des mesures de coordination. Ce partage de compétences vise à préserver des modèles sociaux disparates que les gouvernements estiment ne pas avoir à justifier ni à discuter à Bruxelles.
En 2008 la Commission européenne propose d’étendre à 18 semaines au minimum le congé maternité indemnisé, précédemment fixé à 14 semaines depuis une directive de 1992. Ce projet est voté en première lecture en 2010 par le Parlement qui l’amende en proposant d’augmenter le congé à 20 semaines. Le Parlement passe ensuite le dossier au Conseil des ministres. Fin 2015, c’est à dire 7 ans après le lancement de la proposition, il n’en est toujours pas sorti ! En se demandant pourquoi, l’auteure de l’enquête fait entrer le lecteur dans les rouages du Conseil.
Le Conseil, à la présidence tournante, est un organe à composition variable avec la présence de ministres spécialisés des Etats membres qui se rendent à Bruxelles ponctuellement selon les sujets à l’ordre du jour des séances. La permanence de l’institution est assurée par un Comité des représentants permanents (COREPER) dont les membres, nommés pour 5 ans, résident à Bruxelles pour assurer l’interface entre chaque capitale et les instances de l’UE. Les représentants et leurs adjoints se voient attribuer les droits et prérogatives des ambassadeurs. Instance diplomatique, le COREPER travaille dans le secret des négociations entre gouvernements. Il dispose d’un secrétariat général, et pour l’assister sur le plan technique, de 250 à 300 groupes de travail composés de fonctionnaires. Deux formations se réunissent chaque semaine au sein du COREPER : le COREPER 1, composé des représentants adjoints qui prépare les travaux des 6 formations du Conseil (agriculture et pêche ; transports, télécoms et énergie ; compétitivité ; éducation, jeunesse, culture et sport ; emploi, politique sociale, santé et consommateurs ; environnement) ; le COREPER 2 réunit les représentants permanents pour préparer les réunions des différents conseils (affaires générales, affaires étrangères, affaires économiques et financières, justice et affaires intérieures). En anticipation des réunions du Conseil, le COREPER distingue les points « A » sur lesquels les représentants permanents se sont entendus et que les ministres se contentent d’adopter sans débat (environ 80% des ordres du jour), et les points « B » jugés trop politiques et qui doivent être tranchés par les ministres eux-mêmes. Le COREPER effectue un vrai travail politique et juridique qui aboutit souvent à déterminer la position du Conseil sur des dossiers importants.
Cependant, la culture du COREPER est de parvenir à tout prix à une décision. Même dans les domaines régis par le vote à la majorité qualifiée (c’est le cas du congé maternité), les 28 représentants permanents cherchent le consensus, ce qui aboutit souvent à s’accorder sur le plus petit dénominateur commun. Une pratique de négociation multi-niveaux a été développée, consistant à discuter de plusieurs sujets à la fois, ce qui favorise le « donnant-donnant », où les gouvernements cèdent sur un dossier pour gagner sur un autre. Les représentants permanents et leurs équipes qui résident quasiment tous sur place se fréquentent et « cette mécanique villageoise huilée par l’idéologie dominante, libérale et intégrationniste favorise des compromis droitiers négociés dans les antichambres par de jeunes technocrates « revenus de tout sans être allés nulle part » selon l’auteure. Les allers-retours consultatifs sont incessants avec les capitales, le représentant permanent devant non seulement rallier ses partenaires aux positions de sa capitale, mais aussi rallier sa capitale aux positions des autres. « Instance intergouvernementale, le COREPER peut ainsi se transformer en pratique en outil d’intégration européenne ».
Dans le cas de la directive congé maternité, il s’avère que le COREPER n’a jamais entamé les travaux de conciliation des positions nationales. Selon un fonctionnaire européen belge cité dans l’article : « Au printemps 2015, les représentations permanentes des gouvernements ont boycotté les réunions proposées par la députée belge Maria Arena…très en pointe sur ce dossier, arguant qu’il était inutile de discuter en l’absence de consensus entre les ministres ». Le processus est donc interrompu sans que l’on sache précisément quels Etats bloquent et sur quelle base. Choqués par l’attitude du COREPER, marquée par l’opacité et le refus de se prononcer alors que le processus de décision a été enclenché, les députés socialistes européens considèrent que : « Mieux légiférer ne peut consister à retirer les dossiers conflictuels. Mieux légiférer, c’est assumer le débat politique sur les propositions législatives ». Selon un conseiller parlementaire : « Le Conseil ne respecte ni la Commission ni le Parlement ». Pendant l’été 2015, la Commission annonce qu’elle reprend la main en vertu de son pouvoir général d’initiative : elle retire sa proposition sur le congé maternité de 2008 et en fera une autre plus large sur le marché du travail incluant ce sujet en 2016.
Les pratiques du « trilogue », instance qui réunit les représentants du Parlement, du Conseil et de la Commission pour parvenir à une version commune des textes en discussion, rappellent celles du COREPER dans leur manque de transparence, critiqué par la médiatrice européenne Emily O’Reilly : « Aucun compte rendu n’est publié…On ne sait jamais vraiment quand les réunions ont lieu ou comment les décisions sont prises ». On évoque même une « coreperisation » du processus de décision, les institutions du trilogue négociant de façon informelle, retirant des points des discussions, en modifiant d’autres, dès la première lecture des textes.
L’auteure termine ainsi son enquête : « Le petit psychodrame qui a entouré la directive congé maternité ne serait-il que l’arbre qui cache l’immense forêt du consensus où sont installées les institutions européennes ? Au-delà des luttes de pouvoir entre les institutions, la logique de la discussion permanente favorise en effet le conformisme, dépolitise les dossiers et brouille les responsabilités….Elle conduit également à une fédéralisation technico-juridique rampante qui accorde aux experts, présents à tous les stades du processus législatif, un pouvoir échappant au contrôle démocratique ».
----
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Cela reste un article de journalisme, et donc une opinion, qui semble susciter débat, ce qui me semble relever déjà d'un certain niveau d'analyse. La journaliste fait plus que se contenter de relayer une information. Ce qui pour moi relève entièrement du journalisme, dans le sens noble.
Ensuite, son opinion est seulement basée sur son étude d'un phénomène, ou d'une information. Pour sa défense, la journaliste tente, à mon avis, de rester relativement objective, et de pointer certains éléments qui lui semblent problématiques.
Je partage entièrement ton avis sur le fait que l'on a tendance à considérer qu'il y a usurpation de la démocratie lorsque les élus prennent leurs décisions en fondant leur jugement sur des expertises. Et que c'est une erreur.
C'est à mon sens une dérive naturelle du monde moderne, qui s'est tellement complexifié, que ceux qui nous représentent doivent souvent être incapables de juger de la pertinence des expertises. L'expert jouit d'une autorité indéniable, et d'un pouvoir non négligeable.
Maintenant, il serait peut-être intéressant de penser comment encadrer ces experts? De vérifier après coup si leurs jugements étaient véritablement pertinents. Un des rôles essentiel du parlement ne devrait-il pas être de mesurer la qualité et la validité des experts, de leurs expertises, et de disqualifier ceux qui, par leurs erreurs, se trompent, nous trompent, et mettent notre société en difficulté, et même parfois en péril.
De ce point de vue là, si l'on fait référence à la crise de 2008, combien de mauvais experts ont-ils été disqualifiés? Y a-t-il une véritable évaluation des expertises par nos élus?
A mon sens, c'est à ce niveau que le système politique européen, et probablement l'ensemble des systèmes politiques actuels, font preuve de déficience.
Mais l'élu, qui prend ses fonctions pour quelques années, et par extension le parlement, ont-ils les moyens d'effectuer ce travail qui semble pourtant assez crucial?
Notons qu'il est assez remarquable de voir à quel point notre monde évolue, se transforme, mute, se complexifie, se diversifie, et de constater à quel point le système électoral semble rester figé, avec un principe de représentativité et de gouvernance qui fait preuve de très peu de possibilité pour permettre une forme de continuité. Les élus ont-ils le temps et le recul pour analyser et étudier l'impact des décisions prises en fonction d'expertises? Entre la nécessaire campagne électorale, la nécessité de plaire à son électorat, le temps nécessaire à appréhender les différents dossiers, comment ces derniers pourraient-ils en plus, rendre compte, et faire preuve d'auto critique par rapport à des choix qu'ils ont posés, des expertises qu'ils ont validés?
L'électeur, lui, ne jugera que le politique, responsable, et n'acceptera probablement jamais qu'un de ses représentants ne présente un bilan objectif, critique, montrant les erreurs d'expertise.
En somme, dans le système actuel, nous, électeurs, sommes voués à devoir choisir nos représentants, sur base d'un marketing bien établi, qui empêche de facto le parlementaire de réaliser son travail de manière efficace. Quelle chance un parlementaire aurait-il de se faire élire s'il s'attachait à mettre en évidence les erreurs des experts qui l'ont conseillé, et auxquels il a accordé crédit?
Un sacré cercle vicieux, qui devrait nous faire méditer sur la nécessité de repenser notre système électoral, de le moderniser, afin de permettre une meilleure gestion, et un meilleur contrôle des experts, qui sont indéniablement indispensables. Rappelons-nous aussi que ce système électoral représentatif, qui a très peu évolué, date d'une époque ou la chose publique n'existait quasiment pas, et ou le rôle des parlementaires était bien plus limité qu'aujourd'hui.
L'enlisement institutionnel de l'UE : la directive "congé maternité"
4 messages
• Page 1 sur 1
Re: L'enlisement institutionnel de l'UE : la directive "congé maternité"
Globalement l'article du Monde diplomatique se démarque par le fait qu'il donne plus d'éléments d'information factuels ce qui révèle, pour une fois, un vrai travail de journalisme.Comme pour s'en excuser l'auteure effectue malheureusement un curieux mélange de ces éléments avec des refrains tout faits sur les institutions européennes sans qu'aucune logique ne fasse le lien entre eux. Il dénonce un conformisme qu'il manifeste ainsi assez bien lui-même. Croire que les négociations en trilogue débouchent toujours sur du conformisme c'est les méconnaître. Il en est qui permettent à des individus, députés talentueux, de défendre avec succès le point de vue des élus, et d'obtenir des améliorations de la législation.
Par ailleurs quand l'auteure critique la présence d'experts à tous les stades, on est un peu perplexe, voire agacé par ce qui ne semble pouvoir être que soit de la démagogie soit une déconnexion des réalités pratiques. De tous temps le pouvoir politique s''est entouré d'"experts", on peut critiquer leur (manque d') indépendance voire leurs conflits d'intérêts, l'accès déséquilibré pour certaines catégories d'experts, mais comment peut-on nier leur nécessité? Chacun son rôle: le politique donne des directions, des principes essentiels, pose des questions, pointe des incohérences, et in fine décide tandis que l'expert propose des options, explore la faisabilité, évalue les conséquences,..et n'a pas sa place à la table des négociations: un trilogue c'est pour trois, Parlement, Conseil, Commission.
Les députés sont présents et décisionnaires à tous les stades du processus de négociation en trilogue. Ils sont tenus de faire rapport régulièrement de l'avancement des négociations en réunion publique de la commission parlementaire qui a mandaté l'équipe de négociation. Dans la mesure où côté Parlement ce sont toujours des politiciens élus qui négocient, comment l'auteure peut-elle parler de "coreperisation"? Cette affirmation n'est pas étayée. Le fait que le Conseil envoie des fonctionnaires négocier avec des députés élus, fussent-ils haut-fonctionnaires, cela oui est regrettable.
Bref, un bel effort qui s'arrête à mi-chemin et n'a pas l'honnêteté de le reconnaître.
Par ailleurs quand l'auteure critique la présence d'experts à tous les stades, on est un peu perplexe, voire agacé par ce qui ne semble pouvoir être que soit de la démagogie soit une déconnexion des réalités pratiques. De tous temps le pouvoir politique s''est entouré d'"experts", on peut critiquer leur (manque d') indépendance voire leurs conflits d'intérêts, l'accès déséquilibré pour certaines catégories d'experts, mais comment peut-on nier leur nécessité? Chacun son rôle: le politique donne des directions, des principes essentiels, pose des questions, pointe des incohérences, et in fine décide tandis que l'expert propose des options, explore la faisabilité, évalue les conséquences,..et n'a pas sa place à la table des négociations: un trilogue c'est pour trois, Parlement, Conseil, Commission.
Les députés sont présents et décisionnaires à tous les stades du processus de négociation en trilogue. Ils sont tenus de faire rapport régulièrement de l'avancement des négociations en réunion publique de la commission parlementaire qui a mandaté l'équipe de négociation. Dans la mesure où côté Parlement ce sont toujours des politiciens élus qui négocient, comment l'auteure peut-elle parler de "coreperisation"? Cette affirmation n'est pas étayée. Le fait que le Conseil envoie des fonctionnaires négocier avec des députés élus, fussent-ils haut-fonctionnaires, cela oui est regrettable.
Bref, un bel effort qui s'arrête à mi-chemin et n'a pas l'honnêteté de le reconnaître.
- Oufti
- Messages: 21
- Enregistré le: Ven 30 Déc 2011 00:02
Re: L'enlisement institutionnel de l'UE : la directive "congé maternité"
Bref, un bel effort qui s'arrête à mi-chemin et n'a pas l'honnêteté de le reconnaître.
Cela reste un article de journalisme, et donc une opinion, qui semble susciter débat, ce qui me semble relever déjà d'un certain niveau d'analyse. La journaliste fait plus que se contenter de relayer une information. Ce qui pour moi relève entièrement du journalisme, dans le sens noble.
Ensuite, son opinion est seulement basée sur son étude d'un phénomène, ou d'une information. Pour sa défense, la journaliste tente, à mon avis, de rester relativement objective, et de pointer certains éléments qui lui semblent problématiques.
Je partage entièrement ton avis sur le fait que l'on a tendance à considérer qu'il y a usurpation de la démocratie lorsque les élus prennent leurs décisions en fondant leur jugement sur des expertises. Et que c'est une erreur.
C'est à mon sens une dérive naturelle du monde moderne, qui s'est tellement complexifié, que ceux qui nous représentent doivent souvent être incapables de juger de la pertinence des expertises. L'expert jouit d'une autorité indéniable, et d'un pouvoir non négligeable.
Maintenant, il serait peut-être intéressant de penser comment encadrer ces experts? De vérifier après coup si leurs jugements étaient véritablement pertinents. Un des rôles essentiel du parlement ne devrait-il pas être de mesurer la qualité et la validité des experts, de leurs expertises, et de disqualifier ceux qui, par leurs erreurs, se trompent, nous trompent, et mettent notre société en difficulté, et même parfois en péril.
De ce point de vue là, si l'on fait référence à la crise de 2008, combien de mauvais experts ont-ils été disqualifiés? Y a-t-il une véritable évaluation des expertises par nos élus?
A mon sens, c'est à ce niveau que le système politique européen, et probablement l'ensemble des systèmes politiques actuels, font preuve de déficience.
Mais l'élu, qui prend ses fonctions pour quelques années, et par extension le parlement, ont-ils les moyens d'effectuer ce travail qui semble pourtant assez crucial?
Notons qu'il est assez remarquable de voir à quel point notre monde évolue, se transforme, mute, se complexifie, se diversifie, et de constater à quel point le système électoral semble rester figé, avec un principe de représentativité et de gouvernance qui fait preuve de très peu de possibilité pour permettre une forme de continuité. Les élus ont-ils le temps et le recul pour analyser et étudier l'impact des décisions prises en fonction d'expertises? Entre la nécessaire campagne électorale, la nécessité de plaire à son électorat, le temps nécessaire à appréhender les différents dossiers, comment ces derniers pourraient-ils en plus, rendre compte, et faire preuve d'auto critique par rapport à des choix qu'ils ont posés, des expertises qu'ils ont validés?
L'électeur, lui, ne jugera que le politique, responsable, et n'acceptera probablement jamais qu'un de ses représentants ne présente un bilan objectif, critique, montrant les erreurs d'expertise.
En somme, dans le système actuel, nous, électeurs, sommes voués à devoir choisir nos représentants, sur base d'un marketing bien établi, qui empêche de facto le parlementaire de réaliser son travail de manière efficace. Quelle chance un parlementaire aurait-il de se faire élire s'il s'attachait à mettre en évidence les erreurs des experts qui l'ont conseillé, et auxquels il a accordé crédit?
Un sacré cercle vicieux, qui devrait nous faire méditer sur la nécessité de repenser notre système électoral, de le moderniser, afin de permettre une meilleure gestion, et un meilleur contrôle des experts, qui sont indéniablement indispensables. Rappelons-nous aussi que ce système électoral représentatif, qui a très peu évolué, date d'une époque ou la chose publique n'existait quasiment pas, et ou le rôle des parlementaires était bien plus limité qu'aujourd'hui.
- Demos
- Messages: 47
- Enregistré le: Jeu 02 Juil 2015 16:49
Re: L'enlisement institutionnel de l'UE : la directive "congé maternité"
Je maintiens que prétendre écrire un article aussi long et aussi fouillé (du moins en apparence et c'est bien là que le bât blesse) sur le caractère démocratique du processus législatif européen et ne pas lire les quelques paragraphes concernant ce processus dans le règlement (public) de l'assemblé législative européenne, sur son site public, dénote un manque confondant de déontologie. Et d'objectivité. 
- Oufti
- Messages: 21
- Enregistré le: Ven 30 Déc 2011 00:02
4 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Les institutions européennes
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- QDQ - " Notre Europe " formule une proposition pour une réforme de la Commission
par causonsen » Dim 27 Juil 2014 20:28 - 0 Réponses
- 1654 Vus
- Dernier message par causonsen

Dim 27 Juil 2014 20:28
- QDQ - " Notre Europe " formule une proposition pour une réforme de la Commission
-
- QDQ - " 5 ans après, comment le traité de Lisbonne a changé l'Europe "
par voxpop » Mar 02 Déc 2014 18:42 - 0 Réponses
- 1627 Vus
- Dernier message par voxpop

Mar 02 Déc 2014 18:42
- QDQ - " 5 ans après, comment le traité de Lisbonne a changé l'Europe "
-
- " L’ONU presse l’UE de s’engager dans un accord international sur la dette souveraine ", selon Euractiv
par causonsen » Dim 17 Mai 2015 12:43 - 0 Réponses
- 1475 Vus
- Dernier message par causonsen

Dim 17 Mai 2015 12:43
- " L’ONU presse l’UE de s’engager dans un accord international sur la dette souveraine ", selon Euractiv
-
- QDQ - Un Commissaire européen par Etat-membre : " Les égoïsmes nationaux malmènent l’esprit des traités "
par voxpop » Mar 04 Juin 2013 11:15 - 1 Réponses
- 1679 Vus
- Dernier message par agénor

Mer 05 Juin 2013 11:23
- QDQ - Un Commissaire européen par Etat-membre : " Les égoïsmes nationaux malmènent l’esprit des traités "
-
- " Présider la Commission, gouverner l'UE "
par scripta manent » Jeu 23 Avr 2015 22:34 - 0 Réponses
- 1526 Vus
- Dernier message par scripta manent

Jeu 23 Avr 2015 22:34
- " Présider la Commission, gouverner l'UE "
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité