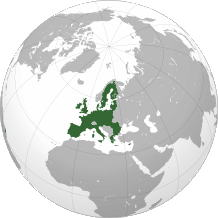» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
De l’Etat soumis à l’Etat souverain
11 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
De l’Etat soumis à l’Etat souverain
Nota : Cet article fait suite à " De l'Etat souverain à l'Etat soumis "
Les abandons de pouvoir (monétaire, douanier), ainsi que les dérégulations et privatisations consentis par la puissance publique depuis bientôt une quarantaine d’années, ont laissé le champ libre à un libéralisme outrancier (« ultralibéralisme »), livrant l’économique et le social aux engouements erratiques d’une finance spéculative hypertrophiée, opaque et moutonnière.
Aux antipodes de la prospérité et de l’harmonie que promettaient ses partisans, le marché « pur et parfait » a généré les taux de croissance les plus faibles de l’après-guerre (1,6 % par an dans la décennie 2001-2010, à comparer aux 4,6 % de la décennie 1961-1970, moyennes OCDE), une succession de crises sans précédent, ainsi qu’une recrudescence brutale des inégalités de revenus et de patrimoines.
L’autorégulation et la capacité à générer sa propre éthique - modérateurs internes annoncés par les promoteurs et partisans de ce nouveau règne - n’ont pas été au rendez-vous. Ce ne sont pas les initiatives ni les « labels » qui manquent (responsabilité sociale d’entreprise, commerce équitable, économie sociale et solidaire …), mais ils ne pèsent pas lourd dans un système où la recherche du profit à court terme a fini par banaliser les petites combines et les grands scandales, financiers, sanitaires ou environnementaux.
Désormais, deux impuissances se font face : un Etat exsangue, discrédité, désarmé et démoralisé ; une sphère économico-financière incapable de se discipliner et de se moraliser. La situation est inédite et dramatique. Des deux protagonistes, l’un ne gouverne plus vraiment, l’autre n’en a ni la vocation ni les moyens.
Comment, dans ce champ de ruines de la démocratie, l’Etat peut-il se remettre en situation de proposer et de conduire un projet de société ?
Il lui faut tout d’abord remettre en vigueur deux principes qui, pour être de bon sens, n’en sont pas moins bafoués aujourd’hui :
- l’Etat n’est souverain que si la hiérarchie légitime des pouvoirs est respectée : le politique régulant l’économique, lui-même servi et non asservi par la finance ;
- l’Etat n’est souverain que s’il est maître de son territoire, ce qui est incompatible avec l’ouverture inconditionnelle des frontières.
La première condition n’est pas hors de portée. Ce que les lois et règlements ont fait ou laissé faire, des lois et règlements peuvent le défaire. Encore faut-il le vouloir. Sans doute parce qu’ils sont les plus attachés à la perpétuation d’un système économique dont ils ont été les théoriciens et les premiers adeptes, les pays anglo-saxons ont pris quelques décisions emblématiques en ce sens, les britanniques en conditionnant les plans de soutien à leurs huit plus grandes banques à une « nationalisation » partielle, les USA en infligeant des amendes retentissantes aux délinquants les plus notoires. En France, le système bancaire s’est empressé de solder les aides publiques dont il avait bénéficié, afin de préserver sa totale liberté de mouvement, que rien ne menaçait d’ailleurs puisque ces aides n’avaient été assorties d’aucune contrepartie.
La seconde condition implique de mettre fin au combat inégal entre un monde politique qui reste territorialement morcelé et un monde économique désormais sans frontières. Cette remise en harmonie du couple pouvoir/territoire relèverait, pour les uns, d’une « gouvernance mondiale » ou, pour les autres, d’un « repli » nationaliste. Ni l'une ni l'autre de ces deux propositions antagonistes ne sont crédibles : la première relève - et relèvera pour longtemps encore - d'une prospective chimérique et la seconde d'une rétrospective stérile : aucun des Etats européens n’est aujourd’hui de taille, seul, à peser sur les destinées du monde. Avant la fin de la décennie en cours, l’Etat le plus peuplé et le plus prospère d’Europe (l’Allemagne), n’atteindra pas 1% de la population mondiale ni 4% de son PIB.
La seule issue réaliste se situe au niveau des grandes régions mondiales, et c’est à l’Europe bien sûr que nous pensons, non pour qu’elle se coupe du monde mais pour qu’elle s’autorise à réguler à ses frontières, en tant que de besoin, les flux de marchandises, de capitaux et de personnes.
Il faut ensuite que l’Etat retrouve et le moral et la dignité ; en d’autres termes, il doit se défaire de la fascination hypnotique qui semble l’avoir saisi à l’égard de la gestion privée, supposée plus efficace et plus rigoureuse que la gestion publique, en tous lieux, en tous temps et en toutes circonstances.
C’est en application de ce postulat que le principe d’intermédiation - qui consiste à recourir à des intermédiaires privés pour des projets ou missions jusqu’alors accomplis en direct par la puissance publique - fait des ravages depuis maintenant une quarantaine d’années. Il en résulte un transfert de pouvoirs, et souvent d’actifs, mais aussi une hémorragie de ressources financières car tout ceci se traduit le plus souvent par un surcoût pour les budgets publics.
Il en va ainsi des Partenariats publics privés (PPP) qui, après 22 ans d’existence en Grande-Bretagne (sous le nom de Private finance initiative, PFI) et 10 ans en France, ont fini par susciter des réserves tant du comité parlementaire au Trésor britannique (« Le coût moyen du capital (d’un PPP) est de 8 %, le double des emprunts de l’Etat », août 2011) que de la Cour des comptes française (« A périmètre comparable, la gestion publique semble moins onéreuse », octobre 2011).
Il en va également ainsi de l’obligation de recourir aux marchés financiers pour toute forme de financement d’un organisme public. Tout récemment, le Collectif pour un audit citoyen de la dette publique a publié une étude solidement documentée aboutissant à la conclusion suivante : « Si l’État, au lieu de se financer depuis 30 ans sur les marchés financiers, avait recouru à des emprunts directement auprès des ménages ou des banques à un taux d’intérêt réel de 2 %, la dette publique serait aujourd’hui inférieure de 29 points de PIB (soit 589 milliards €) à son niveau actuel. » En janvier 2012, Michel Rocard et Pierre Larrouturou avaient émis une proposition encore plus radicale, consistant à « contourner » le carcan des lois et traités actuels : la BCE prêterait à 0,01 % des fonds à la BEI ou à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui les prêteraient au secteur public à 0,02 %, au moins pour assurer le refinancement de la « vieille dette ».
L’indépendance des banques centrales et l’interdiction qui leur est faite de consentir des financements directs au secteur public - sont doublement néfastes :
- Elles sanctuarisent la politique monétaire dans un organisme hors de contrôle de l’Etat, alors que politique monétaire, politique budgétaire et politique des revenus sont trois cartes qui devraient être tenues dans une seule main et utilisées de façon coordonnée, en fonction d’une stratégie économique globale ;
- Elles renchérissent le financement du secteur public, au bénéfice du secteur privé ; les degrés de liberté de l’Etat en matière de gestion budgétaire s’en trouvent réduits, alors même que l’instrument budgétaire pourrait être d’une efficacité supérieure à l‘instrument monétaire.
Arrêtons-nous un instant sur ce dernier point. Les facilités consenties au système bancaire par l’institut d’émission européen n’ont jamais été aussi considérables qu’aujourd’hui. Pour autant, cela ne se traduit pas par une relance économique. Il faudrait pour cela que les banques se décident à utiliser ces facilités pour financer l’économie, ce qui supposerait aussi que des demandes solvables leur soient présentées par les entreprises. Or, tout cela ne se décrète pas : la banque centrale est indépendante mais le système bancaire et les entreprises le sont évidemment aussi. On peut en arriver ainsi à une situation ubuesque où le taux de la facilité de dépôt devient négatif afin de sanctionner les banques laissant « dormir » à la BCE les financements qui leur sont accordés (cf les décisions annoncées le 5 juin 2014 par le Conseil des gouverneurs de la BCE). Au lieu de se réjouir bruyamment de ces décisions « tant attendues », nos gouvernants auraient mieux fait de se demander s’il est bien sain que l’Etat en soit réduit à « attendre » de « bonnes » dispositions des oracles de Francfort.
Ces liquidités qui coulent à flot ne sont pas perdues pour tout le monde. Sous le titre « Quels effets probables des énormes quantités de monnaie créées par les banques centrales », Natixis a pu écrire en janvier 2014 : « Si la hausse très forte de la liquidité mondiale rapportée au Produit Intérieur Brut mondial d’une part est durable, d’autre part ne conduit ni au retour du crédit ni au retour de l’inflation, que va-t-elle impliquer ? La conclusion normale est qu’elle va conduire à une hausse durable du prix des actifs par rapport au niveau compatible normalement avec la situation de l’économie réelle. » En d’autres termes, les bulles spéculatives sont plus que jamais à l’ordre du jour…
Dans l’hypothèse même où les anticipations des opérateurs économiques, prêteurs et emprunteurs, les conduiraient à tirer parti des facilités monétaires, rien ne garantit que cela irrigue principalement l’économie locale. En situation de libre-échange inconditionnel, une relance effective de la consommation peut profiter plus aux importations qu’à la production et aux emplois locaux.
Par opposition à ce pilotage incertain par la politique monétaire, l’injection de liquidités par la politique budgétaire donne une bien meilleure maîtrise du dispositif, pour deux raisons : si la dépense est voulue, elle est assurée ; elle peut être ciblée sur des projets profitant pour l’essentiel à l’activité locale.
Mais aujourd’hui, l’Etat, qui n’avait déjà plus le contrôle de la politique monétaire, a perdu sa liberté de manœuvre budgétaire en raison de la dégradation des finances publiques et s’est placé en situation de dépendance à l’égard des marchés financiers.
Que l’on veuille faire maigrir l’Etat (administrations centrales et collectivités territoriales) là où il fait de la mauvaise graisse, fort bien. Mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Pour agir sur le modèle de société, pour réguler l’économie, nous avons besoin d’un Etat en capacité d’intervenir et donc en capacité budgétaire.
Le libre jeu des intérêts privés ne conduit pas à un optimum social. L’Etat a un rôle régulateur et planificateur à jouer. Il ne peut l’assumer que s’il dispose de ces degrés de liberté budgétaire.
Pour autant, on ne peut évidemment pas s’installer dans le déficit chronique et la dette abyssale.
On ne pourra sortir de ce tissu de contraintes qu’en prenant des dispositions à la hauteur des difficultés du moment :
- revenir sur le principe d’indépendance de la banque centrale ;
- financer la nouvelle dette publique au meilleur taux auprès de la banque centrale et des ménages (selon l’INSEE, le taux d’épargne des ménages français, à 17 % du revenu en moyenne, n’a jamais été aussi élevé, étant précisé que 40 % des ménages n’ont pas la possibilité d’épargner) ;
- refinancer une part à définir de la « vieille » dette par une ligne de crédit à taux zéro, remboursable en cas de retour à meilleure fortune (excédents budgétaires) ;
- promouvoir un secteur bancaire public apte à relayer efficacement et loyalement les mesures de politique monétaire ;
- remettre en cause l’ouverture inconditionnelle des frontières européennes aux mouvements de marchandises et de capitaux ;
- comprendre enfin qu’un renforcement de l’Union européenne serait aussi une source d’efficacité budgétaire, grâce à la mutualisation des dépenses dans de nombreux domaines : défense, diplomatie, recherche et innovation, grands programmes d’infrastructure (énergie, transports et communications).
Détricoter l’écheveau ultralibéral que l’on a laissé se développer ne se fera évidemment pas sans difficultés, mais la fuite en avant en annonce aussi beaucoup, et de bien pires. Tant qu’à rencontrer des difficultés, autant que ce soit en poursuivant des objectifs que l’on a choisis plutôt qu’en se laissant porter par un flot dont on ne maîtrise pas le cours.
Un mouvement est nécessaire. Il est possible et il se fera ; précédé ou entériné par une évolution des traités ; dans le calme relatif d’une trêve des crises ou sous la pression de nouveaux épisodes critiques, d’origine financière et/ou sociale.
Les abandons de pouvoir (monétaire, douanier), ainsi que les dérégulations et privatisations consentis par la puissance publique depuis bientôt une quarantaine d’années, ont laissé le champ libre à un libéralisme outrancier (« ultralibéralisme »), livrant l’économique et le social aux engouements erratiques d’une finance spéculative hypertrophiée, opaque et moutonnière.
Aux antipodes de la prospérité et de l’harmonie que promettaient ses partisans, le marché « pur et parfait » a généré les taux de croissance les plus faibles de l’après-guerre (1,6 % par an dans la décennie 2001-2010, à comparer aux 4,6 % de la décennie 1961-1970, moyennes OCDE), une succession de crises sans précédent, ainsi qu’une recrudescence brutale des inégalités de revenus et de patrimoines.
L’autorégulation et la capacité à générer sa propre éthique - modérateurs internes annoncés par les promoteurs et partisans de ce nouveau règne - n’ont pas été au rendez-vous. Ce ne sont pas les initiatives ni les « labels » qui manquent (responsabilité sociale d’entreprise, commerce équitable, économie sociale et solidaire …), mais ils ne pèsent pas lourd dans un système où la recherche du profit à court terme a fini par banaliser les petites combines et les grands scandales, financiers, sanitaires ou environnementaux.
Désormais, deux impuissances se font face : un Etat exsangue, discrédité, désarmé et démoralisé ; une sphère économico-financière incapable de se discipliner et de se moraliser. La situation est inédite et dramatique. Des deux protagonistes, l’un ne gouverne plus vraiment, l’autre n’en a ni la vocation ni les moyens.
Comment, dans ce champ de ruines de la démocratie, l’Etat peut-il se remettre en situation de proposer et de conduire un projet de société ?
Il lui faut tout d’abord remettre en vigueur deux principes qui, pour être de bon sens, n’en sont pas moins bafoués aujourd’hui :
- l’Etat n’est souverain que si la hiérarchie légitime des pouvoirs est respectée : le politique régulant l’économique, lui-même servi et non asservi par la finance ;
- l’Etat n’est souverain que s’il est maître de son territoire, ce qui est incompatible avec l’ouverture inconditionnelle des frontières.
La première condition n’est pas hors de portée. Ce que les lois et règlements ont fait ou laissé faire, des lois et règlements peuvent le défaire. Encore faut-il le vouloir. Sans doute parce qu’ils sont les plus attachés à la perpétuation d’un système économique dont ils ont été les théoriciens et les premiers adeptes, les pays anglo-saxons ont pris quelques décisions emblématiques en ce sens, les britanniques en conditionnant les plans de soutien à leurs huit plus grandes banques à une « nationalisation » partielle, les USA en infligeant des amendes retentissantes aux délinquants les plus notoires. En France, le système bancaire s’est empressé de solder les aides publiques dont il avait bénéficié, afin de préserver sa totale liberté de mouvement, que rien ne menaçait d’ailleurs puisque ces aides n’avaient été assorties d’aucune contrepartie.
La seconde condition implique de mettre fin au combat inégal entre un monde politique qui reste territorialement morcelé et un monde économique désormais sans frontières. Cette remise en harmonie du couple pouvoir/territoire relèverait, pour les uns, d’une « gouvernance mondiale » ou, pour les autres, d’un « repli » nationaliste. Ni l'une ni l'autre de ces deux propositions antagonistes ne sont crédibles : la première relève - et relèvera pour longtemps encore - d'une prospective chimérique et la seconde d'une rétrospective stérile : aucun des Etats européens n’est aujourd’hui de taille, seul, à peser sur les destinées du monde. Avant la fin de la décennie en cours, l’Etat le plus peuplé et le plus prospère d’Europe (l’Allemagne), n’atteindra pas 1% de la population mondiale ni 4% de son PIB.
La seule issue réaliste se situe au niveau des grandes régions mondiales, et c’est à l’Europe bien sûr que nous pensons, non pour qu’elle se coupe du monde mais pour qu’elle s’autorise à réguler à ses frontières, en tant que de besoin, les flux de marchandises, de capitaux et de personnes.
Il faut ensuite que l’Etat retrouve et le moral et la dignité ; en d’autres termes, il doit se défaire de la fascination hypnotique qui semble l’avoir saisi à l’égard de la gestion privée, supposée plus efficace et plus rigoureuse que la gestion publique, en tous lieux, en tous temps et en toutes circonstances.
C’est en application de ce postulat que le principe d’intermédiation - qui consiste à recourir à des intermédiaires privés pour des projets ou missions jusqu’alors accomplis en direct par la puissance publique - fait des ravages depuis maintenant une quarantaine d’années. Il en résulte un transfert de pouvoirs, et souvent d’actifs, mais aussi une hémorragie de ressources financières car tout ceci se traduit le plus souvent par un surcoût pour les budgets publics.
Il en va ainsi des Partenariats publics privés (PPP) qui, après 22 ans d’existence en Grande-Bretagne (sous le nom de Private finance initiative, PFI) et 10 ans en France, ont fini par susciter des réserves tant du comité parlementaire au Trésor britannique (« Le coût moyen du capital (d’un PPP) est de 8 %, le double des emprunts de l’Etat », août 2011) que de la Cour des comptes française (« A périmètre comparable, la gestion publique semble moins onéreuse », octobre 2011).
Il en va également ainsi de l’obligation de recourir aux marchés financiers pour toute forme de financement d’un organisme public. Tout récemment, le Collectif pour un audit citoyen de la dette publique a publié une étude solidement documentée aboutissant à la conclusion suivante : « Si l’État, au lieu de se financer depuis 30 ans sur les marchés financiers, avait recouru à des emprunts directement auprès des ménages ou des banques à un taux d’intérêt réel de 2 %, la dette publique serait aujourd’hui inférieure de 29 points de PIB (soit 589 milliards €) à son niveau actuel. » En janvier 2012, Michel Rocard et Pierre Larrouturou avaient émis une proposition encore plus radicale, consistant à « contourner » le carcan des lois et traités actuels : la BCE prêterait à 0,01 % des fonds à la BEI ou à la Caisse des Dépôts et Consignations, qui les prêteraient au secteur public à 0,02 %, au moins pour assurer le refinancement de la « vieille dette ».
L’indépendance des banques centrales et l’interdiction qui leur est faite de consentir des financements directs au secteur public - sont doublement néfastes :
- Elles sanctuarisent la politique monétaire dans un organisme hors de contrôle de l’Etat, alors que politique monétaire, politique budgétaire et politique des revenus sont trois cartes qui devraient être tenues dans une seule main et utilisées de façon coordonnée, en fonction d’une stratégie économique globale ;
- Elles renchérissent le financement du secteur public, au bénéfice du secteur privé ; les degrés de liberté de l’Etat en matière de gestion budgétaire s’en trouvent réduits, alors même que l’instrument budgétaire pourrait être d’une efficacité supérieure à l‘instrument monétaire.
Arrêtons-nous un instant sur ce dernier point. Les facilités consenties au système bancaire par l’institut d’émission européen n’ont jamais été aussi considérables qu’aujourd’hui. Pour autant, cela ne se traduit pas par une relance économique. Il faudrait pour cela que les banques se décident à utiliser ces facilités pour financer l’économie, ce qui supposerait aussi que des demandes solvables leur soient présentées par les entreprises. Or, tout cela ne se décrète pas : la banque centrale est indépendante mais le système bancaire et les entreprises le sont évidemment aussi. On peut en arriver ainsi à une situation ubuesque où le taux de la facilité de dépôt devient négatif afin de sanctionner les banques laissant « dormir » à la BCE les financements qui leur sont accordés (cf les décisions annoncées le 5 juin 2014 par le Conseil des gouverneurs de la BCE). Au lieu de se réjouir bruyamment de ces décisions « tant attendues », nos gouvernants auraient mieux fait de se demander s’il est bien sain que l’Etat en soit réduit à « attendre » de « bonnes » dispositions des oracles de Francfort.
Ces liquidités qui coulent à flot ne sont pas perdues pour tout le monde. Sous le titre « Quels effets probables des énormes quantités de monnaie créées par les banques centrales », Natixis a pu écrire en janvier 2014 : « Si la hausse très forte de la liquidité mondiale rapportée au Produit Intérieur Brut mondial d’une part est durable, d’autre part ne conduit ni au retour du crédit ni au retour de l’inflation, que va-t-elle impliquer ? La conclusion normale est qu’elle va conduire à une hausse durable du prix des actifs par rapport au niveau compatible normalement avec la situation de l’économie réelle. » En d’autres termes, les bulles spéculatives sont plus que jamais à l’ordre du jour…
Dans l’hypothèse même où les anticipations des opérateurs économiques, prêteurs et emprunteurs, les conduiraient à tirer parti des facilités monétaires, rien ne garantit que cela irrigue principalement l’économie locale. En situation de libre-échange inconditionnel, une relance effective de la consommation peut profiter plus aux importations qu’à la production et aux emplois locaux.
Par opposition à ce pilotage incertain par la politique monétaire, l’injection de liquidités par la politique budgétaire donne une bien meilleure maîtrise du dispositif, pour deux raisons : si la dépense est voulue, elle est assurée ; elle peut être ciblée sur des projets profitant pour l’essentiel à l’activité locale.
Mais aujourd’hui, l’Etat, qui n’avait déjà plus le contrôle de la politique monétaire, a perdu sa liberté de manœuvre budgétaire en raison de la dégradation des finances publiques et s’est placé en situation de dépendance à l’égard des marchés financiers.
Que l’on veuille faire maigrir l’Etat (administrations centrales et collectivités territoriales) là où il fait de la mauvaise graisse, fort bien. Mais ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Pour agir sur le modèle de société, pour réguler l’économie, nous avons besoin d’un Etat en capacité d’intervenir et donc en capacité budgétaire.
Le libre jeu des intérêts privés ne conduit pas à un optimum social. L’Etat a un rôle régulateur et planificateur à jouer. Il ne peut l’assumer que s’il dispose de ces degrés de liberté budgétaire.
Pour autant, on ne peut évidemment pas s’installer dans le déficit chronique et la dette abyssale.
On ne pourra sortir de ce tissu de contraintes qu’en prenant des dispositions à la hauteur des difficultés du moment :
- revenir sur le principe d’indépendance de la banque centrale ;
- financer la nouvelle dette publique au meilleur taux auprès de la banque centrale et des ménages (selon l’INSEE, le taux d’épargne des ménages français, à 17 % du revenu en moyenne, n’a jamais été aussi élevé, étant précisé que 40 % des ménages n’ont pas la possibilité d’épargner) ;
- refinancer une part à définir de la « vieille » dette par une ligne de crédit à taux zéro, remboursable en cas de retour à meilleure fortune (excédents budgétaires) ;
- promouvoir un secteur bancaire public apte à relayer efficacement et loyalement les mesures de politique monétaire ;
- remettre en cause l’ouverture inconditionnelle des frontières européennes aux mouvements de marchandises et de capitaux ;
- comprendre enfin qu’un renforcement de l’Union européenne serait aussi une source d’efficacité budgétaire, grâce à la mutualisation des dépenses dans de nombreux domaines : défense, diplomatie, recherche et innovation, grands programmes d’infrastructure (énergie, transports et communications).
Détricoter l’écheveau ultralibéral que l’on a laissé se développer ne se fera évidemment pas sans difficultés, mais la fuite en avant en annonce aussi beaucoup, et de bien pires. Tant qu’à rencontrer des difficultés, autant que ce soit en poursuivant des objectifs que l’on a choisis plutôt qu’en se laissant porter par un flot dont on ne maîtrise pas le cours.
Un mouvement est nécessaire. Il est possible et il se fera ; précédé ou entériné par une évolution des traités ; dans le calme relatif d’une trêve des crises ou sous la pression de nouveaux épisodes critiques, d’origine financière et/ou sociale.
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: De l’Etat soumis à l’Etat souverain
Paru sur Agoravox, cet article a donné lieu à quelques réactions des europhobes : Agoravox
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: De l’Etat soumis à l’Etat souverain
Si l'on en juge par les déclarations de notre ministre des Finances, Michel Sapin, aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, il y a du chemin à faire pour que " l'Etat retrouve et le moral et la dignité ", comme évoqué dans l'article ci-dessus.
Selon la 12-15 du Monde.fr de ce jour (7 juillet 2014) :
" "Nous avons à répondre à une très belle question : " Y a-t-il une finance heureuse, au service d'investissements heureux ? " Je l'exprimerais autrement et vous verrez ma part de provocation. Notre amie, c'est la finance : la bonne finance "
Le ministre des finances, Michel Sapin, a déclaré dimanche que la finance était l'"amie" du gouvernement et de l'économie, dans une intervention aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Selon lui, la "mauvaise" finance est celle de la spéculation, "qu'il fallait combattre et qu'il faut encore combattre pied à pied parce qu'elle est encore là, elle est encore derrière, elle est encore en dessous, prête parfois à bondir".
"C'est celle qui ne cherche pas à construire ses gains (…) sur du solide, qui ne cherche pas à construire ses gains sur de la durée", a-t-il ajouté.
Au contraire, pour le ministre, la "bonne" finance est "celle dont nous avons besoin, celle dont l'Etat a besoin, y compris pour se financer lui-même".
"Surtout dans la période actuelle, nous avons besoin d'une finance qui vienne aider" les entreprises françaises "à se financer", pour créer de la croissance, a affirmé M. Sapin. "
Et la banque centrale, l'Etat n'en a pas " besoin pour se financer lui-même " ?
Ce serait bien de répondre à cette " très belle question ".
Selon la 12-15 du Monde.fr de ce jour (7 juillet 2014) :
" "Nous avons à répondre à une très belle question : " Y a-t-il une finance heureuse, au service d'investissements heureux ? " Je l'exprimerais autrement et vous verrez ma part de provocation. Notre amie, c'est la finance : la bonne finance "
Le ministre des finances, Michel Sapin, a déclaré dimanche que la finance était l'"amie" du gouvernement et de l'économie, dans une intervention aux Rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Selon lui, la "mauvaise" finance est celle de la spéculation, "qu'il fallait combattre et qu'il faut encore combattre pied à pied parce qu'elle est encore là, elle est encore derrière, elle est encore en dessous, prête parfois à bondir".
"C'est celle qui ne cherche pas à construire ses gains (…) sur du solide, qui ne cherche pas à construire ses gains sur de la durée", a-t-il ajouté.
Au contraire, pour le ministre, la "bonne" finance est "celle dont nous avons besoin, celle dont l'Etat a besoin, y compris pour se financer lui-même".
"Surtout dans la période actuelle, nous avons besoin d'une finance qui vienne aider" les entreprises françaises "à se financer", pour créer de la croissance, a affirmé M. Sapin. "
Et la banque centrale, l'Etat n'en a pas " besoin pour se financer lui-même " ?
Ce serait bien de répondre à cette " très belle question ".
- causonsen
- Messages: 309
- Enregistré le: Mar 13 Mar 2012 19:15
Re: De l’Etat soumis à l’Etat souverain
Paru sur Médiapart, cet article de notre forum a donné lieu à quelques intéressants commentaires : Médiapart
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: De l’Etat soumis à l’Etat souverain
Un renfort (pas tout-à-fait) inattendu et de poids pour les tenants de la politique budgétaire : Mario Draghi, qui a la haute main sur la politique monétaire.
Une fois de plus, il crée la surprise.
Le 22 août à la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming), il a déclaré :
" La zone euro souffre depuis 2010 d'une politique budgétaire insuffisante (“less available and effective”), surtout si on la compare aux autres économies avancées. Ce n'est pas le résultat d'une dette publique élevée, en moyenne la dette européenne n'est pas supérieure à celle des Etats-Unis ou du Japon. Elle résulte du fait que, dans les autres pays, la banque centrale a joué un rôle de cran de sécurité (“backstop”) pour le financement des Etats. C'est pourquoi il serait utile que la politique budgétaire joue un rôle plus actif aux côtés de la politique monétaire. "
Pour en savoir plus sur le contexte : Le Monde.fr
Une fois de plus, il crée la surprise.
Le 22 août à la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming), il a déclaré :
" La zone euro souffre depuis 2010 d'une politique budgétaire insuffisante (“less available and effective”), surtout si on la compare aux autres économies avancées. Ce n'est pas le résultat d'une dette publique élevée, en moyenne la dette européenne n'est pas supérieure à celle des Etats-Unis ou du Japon. Elle résulte du fait que, dans les autres pays, la banque centrale a joué un rôle de cran de sécurité (“backstop”) pour le financement des Etats. C'est pourquoi il serait utile que la politique budgétaire joue un rôle plus actif aux côtés de la politique monétaire. "
Pour en savoir plus sur le contexte : Le Monde.fr
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: De l’Etat soumis à l’Etat souverain
Médiapart, dans son édition du 29 novembre 2014, fait état d'un ouvrage du sociologue allemand Wolfgang Streeck (" Du temps acheté " paru chez Gallimard dans sa version française) qui " analyse le divorce consommé entre capitalisme et démocratie. Il ne voit guère que l'État-nation pour freiner aujourd'hui les méfaits du « libéralisme de marché hayékien ». "
Voilà qui est bien dans notre sujet !
Extraits de l'article :
" Rares sont les essais dont la lecture s’apparente à un voile qui se déchire. Celui de Wolfgang Streeck est de ceux-là. Né en 1947, directeur émérite de l’Institut Max-Planck pour l’étude des sociétés de Cologne, il s'attache à « la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique », sous le titre Du temps acheté. Et il démontre ce qui advient sous nos yeux : les pays industriels, grevés par leurs dettes, laissent les manettes au marché créancier ; ces États démunis n’assurant plus que la répression des citoyens récalcitrants.
(...)
Wolfgang Streeck met en évidence le changement de paradigme permettant « que l’économie capitaliste soit sans cesse, et de plus en plus, délivrée de l’intervention démocratique » : l’ère de l’endettement étatique. L’inflation avait fait son temps et débouché, a contrario, sur la stabilisation monétaire menée au pas de charge par Mr Reagan et Mrs Thatcher avec, en contrepartie d’une monnaie enfin saine, le chômage de masse et une résistance syndicale brisée de méchante façon. Difficile d'aller plus loin dans l'immédiat. Comment ne pas ponctionner davantage d’impôts ni démonter encore plus sauvagement l’État social ? Comment acheter une paix relative ? Par l’endettement, étatique puis privé. Un endettement vertigineux aux allures de fuite en avant. Avec, au bout du compte, l’addition néolibérale que les politiques allaient présenter à leur peuple : privatisations, dérégulations, emplois asséchés ou précaires, protection déclinante ou inexistante. Les élus n’étaient plus que de vagues régisseurs des quatre volontés de la main invisible du marché. En témoigne la mercantilisation de la couverture sociale, dévolue aux compagnies d’assurance privée.
(...)
Sur fond de résignation populaire, la prétendue justice du marché a donc supplanté feu la justice sociale, en l’absence de toute correction démocratique, désormais rendue impossible. Le discours dominant fustige « les dépenses trop élevées », alors que le cœur du problème, rappelle Wolfgang Streeck, gît dans des recettes trop basses. Échapper à l’impôt, de la part des grosses sociétés ou des grandes fortunes passées maîtres dans l’évasion fiscale, s’inscrit dans un projet politique consistant à réduire à néant l’État : « Affamer la bête » (“starving the beast”), selon le slogan du néolibéralisme yankee. "
Pour accéder à l'article dans sa totalité : Médiapart
Voilà qui est bien dans notre sujet !
Extraits de l'article :
" Rares sont les essais dont la lecture s’apparente à un voile qui se déchire. Celui de Wolfgang Streeck est de ceux-là. Né en 1947, directeur émérite de l’Institut Max-Planck pour l’étude des sociétés de Cologne, il s'attache à « la crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique », sous le titre Du temps acheté. Et il démontre ce qui advient sous nos yeux : les pays industriels, grevés par leurs dettes, laissent les manettes au marché créancier ; ces États démunis n’assurant plus que la répression des citoyens récalcitrants.
(...)
Wolfgang Streeck met en évidence le changement de paradigme permettant « que l’économie capitaliste soit sans cesse, et de plus en plus, délivrée de l’intervention démocratique » : l’ère de l’endettement étatique. L’inflation avait fait son temps et débouché, a contrario, sur la stabilisation monétaire menée au pas de charge par Mr Reagan et Mrs Thatcher avec, en contrepartie d’une monnaie enfin saine, le chômage de masse et une résistance syndicale brisée de méchante façon. Difficile d'aller plus loin dans l'immédiat. Comment ne pas ponctionner davantage d’impôts ni démonter encore plus sauvagement l’État social ? Comment acheter une paix relative ? Par l’endettement, étatique puis privé. Un endettement vertigineux aux allures de fuite en avant. Avec, au bout du compte, l’addition néolibérale que les politiques allaient présenter à leur peuple : privatisations, dérégulations, emplois asséchés ou précaires, protection déclinante ou inexistante. Les élus n’étaient plus que de vagues régisseurs des quatre volontés de la main invisible du marché. En témoigne la mercantilisation de la couverture sociale, dévolue aux compagnies d’assurance privée.
(...)
Sur fond de résignation populaire, la prétendue justice du marché a donc supplanté feu la justice sociale, en l’absence de toute correction démocratique, désormais rendue impossible. Le discours dominant fustige « les dépenses trop élevées », alors que le cœur du problème, rappelle Wolfgang Streeck, gît dans des recettes trop basses. Échapper à l’impôt, de la part des grosses sociétés ou des grandes fortunes passées maîtres dans l’évasion fiscale, s’inscrit dans un projet politique consistant à réduire à néant l’État : « Affamer la bête » (“starving the beast”), selon le slogan du néolibéralisme yankee. "
Pour accéder à l'article dans sa totalité : Médiapart
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: De l’Etat soumis à l’Etat souverain
Parmi les " brèves " de l'édition 12-15 du Monde.fr (16 mars 2015), on trouve notamment ceci :
" Jennifer Pahlka (@pahlkadot, Wikipedia), est la fondatrice et directrice de Code for America. En octobre dernier, elle était l'invitée des Talks at Google (@googletalks), le programme de conférences internes de Google (organisées le plus souvent sans grand formalisme contrairement aux conférences TED), et qui publie nombre d'entre elles sur une chaîne YouTube dédiée. Dans la vidéo de son intervention, Jennifer Pahlka défend l'innovation gouvernementale, rappelant combien les investissements de l'Etat américain dans l'innovation ont permis à celle-ci de se développer. Sans eux, il n'y aurait pas eu de GPS ni de téléphonie mobile. "Les gens pensent que quand ils obtiennent la météo sur Yahoo ou Google, elle vient de Google ou Yahoo, alors qu'elle vient d'un service de l'administration américaine, la National Oceanic and Atmospheric Administration. C'est le gouvernement qui permet l'innovation du secteur privé et on ne l'en remercie pas assez." Jennifer Pahlka fait ici référence à l'importance des contributions de l'Etat quant aux innovations que la Silicon Valley revendique, qu'évoque Mariana Mazzucato (@MazzucatoM), auteure de L'Etat entrepreneurial, qui rappelle l'importance de l'innovation publique dans la constitution des marchés innovants (voir également la tribune de l'économiste Bruno Amable, "L'authentique entrepreneur innovant est l'Etat").
Pourtant, souligne Jennifer Pahlka, peu de gens pensent que le gouvernement est toujours innovant.
Dans l'un de ses derniers articles publiés dans l'édition de janvier de Foreign Affairs et consacré à l'innovation, Mariana Mazzucato rappelle qu'en matière d'innovation, le rôle de l'Etat n'est pas seulement de réglementer pour permettre aux innovateurs d'innover. Longtemps, les investissements publics ont soutenu la recherche, rappelle l'économiste, mais depuis la crise des années 70, sous prétexte de la maîtrise des dépenses publiques, ces investissements de fonds n'ont cessé partout de se réduire. Les politiques pour favoriser l'investissement privé en diminuant les taux de taxation des fonds d'investissement n'ont conduit qu'a augmenter les inégalités plus que l'investissement et à favoriser l'innovation à court terme. "Amener les gouvernements à voir grand sur l'innovation ne signifie pas distribuer plus d'argent des contribuables à plus d'activités, mais exige de reconsidérer le rôle traditionnel de l'Etat dans l'économie." Ils doivent diriger l'économie vers de nouveaux "paradigmes techno-économiques", selon les mots de la spécialiste de l'innovation Carlota Perez. Ils ne doivent pas seulement réparer les échecs du marché, mais les créer activement pour remédier au fait que les marchés sont trop souvent aveugles, négligeant les préoccupations sociales ou environnementales. Ainsi, les sociétés de l'énergie préfèrent investir dans l'extraction de pétrole dans les confins les plus profonds de la Terre que dans l'énergie propre. Or, ces orientations ne sont pas générées spontanément des forces du marché : ils sont en grande partie le résultat de décisions délibérées de l'Etat. "
Pour accéder à l'article complet : http://internetactu.blog.lemonde.fr/
Salutaires mises au point en ces temps où l'on entend si souvent dire que " seul le privé crée de la richesse ".
" Jennifer Pahlka (@pahlkadot, Wikipedia), est la fondatrice et directrice de Code for America. En octobre dernier, elle était l'invitée des Talks at Google (@googletalks), le programme de conférences internes de Google (organisées le plus souvent sans grand formalisme contrairement aux conférences TED), et qui publie nombre d'entre elles sur une chaîne YouTube dédiée. Dans la vidéo de son intervention, Jennifer Pahlka défend l'innovation gouvernementale, rappelant combien les investissements de l'Etat américain dans l'innovation ont permis à celle-ci de se développer. Sans eux, il n'y aurait pas eu de GPS ni de téléphonie mobile. "Les gens pensent que quand ils obtiennent la météo sur Yahoo ou Google, elle vient de Google ou Yahoo, alors qu'elle vient d'un service de l'administration américaine, la National Oceanic and Atmospheric Administration. C'est le gouvernement qui permet l'innovation du secteur privé et on ne l'en remercie pas assez." Jennifer Pahlka fait ici référence à l'importance des contributions de l'Etat quant aux innovations que la Silicon Valley revendique, qu'évoque Mariana Mazzucato (@MazzucatoM), auteure de L'Etat entrepreneurial, qui rappelle l'importance de l'innovation publique dans la constitution des marchés innovants (voir également la tribune de l'économiste Bruno Amable, "L'authentique entrepreneur innovant est l'Etat").
Pourtant, souligne Jennifer Pahlka, peu de gens pensent que le gouvernement est toujours innovant.
Dans l'un de ses derniers articles publiés dans l'édition de janvier de Foreign Affairs et consacré à l'innovation, Mariana Mazzucato rappelle qu'en matière d'innovation, le rôle de l'Etat n'est pas seulement de réglementer pour permettre aux innovateurs d'innover. Longtemps, les investissements publics ont soutenu la recherche, rappelle l'économiste, mais depuis la crise des années 70, sous prétexte de la maîtrise des dépenses publiques, ces investissements de fonds n'ont cessé partout de se réduire. Les politiques pour favoriser l'investissement privé en diminuant les taux de taxation des fonds d'investissement n'ont conduit qu'a augmenter les inégalités plus que l'investissement et à favoriser l'innovation à court terme. "Amener les gouvernements à voir grand sur l'innovation ne signifie pas distribuer plus d'argent des contribuables à plus d'activités, mais exige de reconsidérer le rôle traditionnel de l'Etat dans l'économie." Ils doivent diriger l'économie vers de nouveaux "paradigmes techno-économiques", selon les mots de la spécialiste de l'innovation Carlota Perez. Ils ne doivent pas seulement réparer les échecs du marché, mais les créer activement pour remédier au fait que les marchés sont trop souvent aveugles, négligeant les préoccupations sociales ou environnementales. Ainsi, les sociétés de l'énergie préfèrent investir dans l'extraction de pétrole dans les confins les plus profonds de la Terre que dans l'énergie propre. Or, ces orientations ne sont pas générées spontanément des forces du marché : ils sont en grande partie le résultat de décisions délibérées de l'Etat. "
Pour accéder à l'article complet : http://internetactu.blog.lemonde.fr/
Salutaires mises au point en ces temps où l'on entend si souvent dire que " seul le privé crée de la richesse ".
- scripta manent
- Site Admin
- Messages: 330
- Enregistré le: Mer 06 Juil 2011 11:35
Re: De l’Etat soumis à l’Etat souverain
''FIN DE L'OCCIDENT, NAISSANCE DU MONDE''
Ce Points-Essais édité au Seuil en 2014 est un cri d'espérance d'Hervé Kempf, actuel rédacteur en chef du site Reporterre.
Filons les métaphores animales et cyclistes : nous sommes ici aux antipodes de l'autruche la tête dans le sable ou du troupeau affolé bêlant devant le précipice. Il s'agit de lever le nez du guidon et de changer de braquet !
''Les contraintes écologiques interdisent de généraliser à l'échelle de la planète le niveau de vie occidental. Il devra donc baisser pour que chacun ait sa juste part, rendant ainsi inéluctable notre appauvrissement. ''
Dans la première moitié de l'essai, l'auteur prend son temps pour planter le décor historique, puis le rythme s'accélère, appuyé d'un tir nourri de statistiques.
Il s'agit pour la "foule sentimentale'' ayant ''soif d'idéal'', comme dit la chanson, d'échapper à une sorte d'addiction, à l'engrenage d'un système destructeur qu'il décrit.
Florilège :
''L 'espérance de vie en bonne santé commence à régresser en Allemagne chez les hommes, en Espagne chez les femmes et en France, aux Pays-Bas et en Autriche pour les deux sexes.''
''Comment la crise est arrivée … le tryptique « inégalités spéculation et endettement » a commencé à se substituer, dans les pays occidentaux, au tryptique « équité, productivité et croissance » qui avait assuré la prospérité durant les décennies précédentes .''
Un individualisme sans mesure obnubilé par des indices fallacieux (ex. la privatisation des prisons, et par suite l'augmentation du nombre de détenus, est favorable à la croissance du Produit Intérieur Brut).
Défauts du PIB : ''Le principal, et qui rend cet indicateur inapte à guider la politique nécessaire à notre époque, est qu'il ne rend pas compte d'un effet majeur de l'activité économique, son impact sur l'environnement. Comme l'avenir du monde repose sur la capacité de maintenir l'équilibre de la biosphère, toute augmentation du PIB signifie en réalité l'affaiblissement de cette capacité vitale.''
Illustrée dans l'actualité par la COP21, ''La question dominant la diplomatie mondiale demeure bien celle du partage et de la gestion de l'atmosphère au regard du risque climatique. De quoi s'agit-il ? D'un bien commun. Sur lequel toute appopriation sous forme de gaz à effet de serre dans une proportion supérieure à celle des autres apparaît illégitime et discutable. D'autres bien communs vont émerger à mesure que les contradictions énergétiques et écologiques s'aiguiseront : les océans, l'Arctique, l'Antarctique, l'espace, la monnaie.
… l'humanité se trouve dans une situation paradoxale : nous avons trop d'énergie fossile … En conséquence, si l'on veut limiter le réchauffement climatique, il faudra limiter la consommation de pétrole, de gaz et de charbon.''
L'Europe a sa partition à jouer : ''… elle ne dispose quasi plus de réserves d'énergie fossile. Sa dépendance énergétique passerait de 50% en 2010 à 70% d'ici à 2022. Elle est donc obligée d'adopter une politique vigoureuse d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Autrement dit de cultiver les valeurs de sobriété et d'efficacité qui seront les qualités économiques de l'avenir.''
En même temps, l'auteur ne mâche pas ses mots pour qualifier la stratégie du Royaume Uni et de sa City devenue ''le plus grand paradis fiscal du monde'' et plus largement en Europe la ''trahison par les élites de l'idéal européen, qui se fondait sur les principes démocratiques de souveraineté des citoyens. Les traités successifs ont avalisé la liberté de la finance : création monétaire abandonnée aux banques privées, interdiction faite à la Banque Centrale Européenne de prêter aux Etats, interdiction à ceux-ci de limiter les mouvements de capitaux, règle de l'unanimité en matière fiscale- ce qui favorise le dumping fiscal- … En réalité, l'Union a été progressivement remise aux mains du système financier''.
Pour Hervé Kempf, la force de l'Europe serait sa faiblesse énergétique, paradoxalement, ainsi que sa culture de la paix après les déchirements passés.
Cet essai contribuera-t-il à dessiller les yeux de certaines victimes du système actuel ?
Ces idées, qu'à contre-courant l'auteur a longtemps contribué à développer, finiront-elles par infuser ? Il est encore temps de se réveiller.
L'actualité presse : est-il tenable, même à moyen terme, de se laver les mains de tout ce que, médusés, nous voyons advenir ?
Ce Points-Essais édité au Seuil en 2014 est un cri d'espérance d'Hervé Kempf, actuel rédacteur en chef du site Reporterre.
Filons les métaphores animales et cyclistes : nous sommes ici aux antipodes de l'autruche la tête dans le sable ou du troupeau affolé bêlant devant le précipice. Il s'agit de lever le nez du guidon et de changer de braquet !
''Les contraintes écologiques interdisent de généraliser à l'échelle de la planète le niveau de vie occidental. Il devra donc baisser pour que chacun ait sa juste part, rendant ainsi inéluctable notre appauvrissement. ''
Dans la première moitié de l'essai, l'auteur prend son temps pour planter le décor historique, puis le rythme s'accélère, appuyé d'un tir nourri de statistiques.
Il s'agit pour la "foule sentimentale'' ayant ''soif d'idéal'', comme dit la chanson, d'échapper à une sorte d'addiction, à l'engrenage d'un système destructeur qu'il décrit.
Florilège :
''L 'espérance de vie en bonne santé commence à régresser en Allemagne chez les hommes, en Espagne chez les femmes et en France, aux Pays-Bas et en Autriche pour les deux sexes.''
''Comment la crise est arrivée … le tryptique « inégalités spéculation et endettement » a commencé à se substituer, dans les pays occidentaux, au tryptique « équité, productivité et croissance » qui avait assuré la prospérité durant les décennies précédentes .''
Un individualisme sans mesure obnubilé par des indices fallacieux (ex. la privatisation des prisons, et par suite l'augmentation du nombre de détenus, est favorable à la croissance du Produit Intérieur Brut).
Défauts du PIB : ''Le principal, et qui rend cet indicateur inapte à guider la politique nécessaire à notre époque, est qu'il ne rend pas compte d'un effet majeur de l'activité économique, son impact sur l'environnement. Comme l'avenir du monde repose sur la capacité de maintenir l'équilibre de la biosphère, toute augmentation du PIB signifie en réalité l'affaiblissement de cette capacité vitale.''
Illustrée dans l'actualité par la COP21, ''La question dominant la diplomatie mondiale demeure bien celle du partage et de la gestion de l'atmosphère au regard du risque climatique. De quoi s'agit-il ? D'un bien commun. Sur lequel toute appopriation sous forme de gaz à effet de serre dans une proportion supérieure à celle des autres apparaît illégitime et discutable. D'autres bien communs vont émerger à mesure que les contradictions énergétiques et écologiques s'aiguiseront : les océans, l'Arctique, l'Antarctique, l'espace, la monnaie.
… l'humanité se trouve dans une situation paradoxale : nous avons trop d'énergie fossile … En conséquence, si l'on veut limiter le réchauffement climatique, il faudra limiter la consommation de pétrole, de gaz et de charbon.''
L'Europe a sa partition à jouer : ''… elle ne dispose quasi plus de réserves d'énergie fossile. Sa dépendance énergétique passerait de 50% en 2010 à 70% d'ici à 2022. Elle est donc obligée d'adopter une politique vigoureuse d'économies d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Autrement dit de cultiver les valeurs de sobriété et d'efficacité qui seront les qualités économiques de l'avenir.''
En même temps, l'auteur ne mâche pas ses mots pour qualifier la stratégie du Royaume Uni et de sa City devenue ''le plus grand paradis fiscal du monde'' et plus largement en Europe la ''trahison par les élites de l'idéal européen, qui se fondait sur les principes démocratiques de souveraineté des citoyens. Les traités successifs ont avalisé la liberté de la finance : création monétaire abandonnée aux banques privées, interdiction faite à la Banque Centrale Européenne de prêter aux Etats, interdiction à ceux-ci de limiter les mouvements de capitaux, règle de l'unanimité en matière fiscale- ce qui favorise le dumping fiscal- … En réalité, l'Union a été progressivement remise aux mains du système financier''.
Pour Hervé Kempf, la force de l'Europe serait sa faiblesse énergétique, paradoxalement, ainsi que sa culture de la paix après les déchirements passés.
Cet essai contribuera-t-il à dessiller les yeux de certaines victimes du système actuel ?
Ces idées, qu'à contre-courant l'auteur a longtemps contribué à développer, finiront-elles par infuser ? Il est encore temps de se réveiller.
L'actualité presse : est-il tenable, même à moyen terme, de se laver les mains de tout ce que, médusés, nous voyons advenir ?
- pierre
- Messages: 161
- Enregistré le: Dim 18 Sep 2011 15:58
Re: De l’Etat soumis à l’Etat souverain
Article très intéressant dans le monde diplomatique :
"Votre percepteur est coté en Bourse" (par Christian De Brie).
Et moi qui pensait que l'impôt restait une des dernières prérogatives de l'Etat. Et bien, en fait non... Et cela ne vaut pas seulement pour les régates, mais aussi pour les dons, pour le financement de la culture, de la presse, etc.
Personne n'aime payer d'impôts. Peut-être serait-il intéressant d'éclairer les gens sur le fait qu'ils en paient aux entreprises aussi. Et qu'à l'inverse de ceux qu'ils paient à l'Etat, ils n'ont absolument aucun contrôle sur ceux-là...
C'est peut-être la force de ces entreprises, car comment luter contre quelque chose sur lequel on a aucun contrôle... L'entreprise, c'est aussi notre patron, et face à lui, que pouvons-nous dire?
"Votre percepteur est coté en Bourse" (par Christian De Brie).
...Confortablement installé sur votre canapé, grignotant chips et saucisses sèches, vous suivez sur votre écran l'arrivée d'une course opposant le trimaran du géant de la charcuterie à celui du roi de la pomme de terre. Savez-vous que la facture de la régate est dans votre assiette? Les coûts de la course et des bateaux affrétés par les sociétés pour leur promotion sont intégralement répercutés dans le prix des produits qu'elles vous vendent. En réalité, elles ont effectués sur vous un prélèvement pécuniaire, par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie directe, ce qui est la définition même de l'impôt.
Et moi qui pensait que l'impôt restait une des dernières prérogatives de l'Etat. Et bien, en fait non... Et cela ne vaut pas seulement pour les régates, mais aussi pour les dons, pour le financement de la culture, de la presse, etc.
En définitive, tous se passe comme si les pouvoirs publiques, censés représenter en démocratie la volonté des citoyens, abandonnaient au secteur privé les moyens de financer les politiques culturelles, sportives, environnementales et autres, en lui transférant indirectement une partie des recettes fiscales et le pouvoir de lever l'impôt, au prétexte que l'Etat... n'a plus d'argent!
... Cette évolution s'inscrit dans un mouvement plus global de privatisation des moyens d'action des Etats au profit de ceux que Susan Georges appelle les "usurpateurs".
Personne n'aime payer d'impôts. Peut-être serait-il intéressant d'éclairer les gens sur le fait qu'ils en paient aux entreprises aussi. Et qu'à l'inverse de ceux qu'ils paient à l'Etat, ils n'ont absolument aucun contrôle sur ceux-là...
C'est peut-être la force de ces entreprises, car comment luter contre quelque chose sur lequel on a aucun contrôle... L'entreprise, c'est aussi notre patron, et face à lui, que pouvons-nous dire?
- Demos
- Messages: 47
- Enregistré le: Jeu 02 Juil 2015 16:49
Re: De l’Etat soumis à l’Etat souverain
http://www.levif.be/actualite/belgique/gerer-l-etat-belge-pas-la-s-a-belgique/article-opinion-501737.html
Ces deux chercheurs ont une vision intéressante de notre monde moderne. Depuis quelques temps, je pensais que le libéralisme, ou néo-libéralisme, ne pouvait suffire à expliquer l'évolution de nos sociétés. J'étais arrivé à la conclusion que le système capitaliste en lui-même, accompagné du néo-libéralisme détruisait notre société. Je trouve que ces deux chercheurs apportent une vision plus nuancée, en parlant d'économisation. L'Etat ne s'affaiblit pas, mais il se soumet à ce principe. Ce qui tend à tuer tout forme de diversité dans la pensée politique. Tout le monde n'est-il pas d'accord, sur un très large spectre de la pensée politique qu'il nous faut un Etat, une nation, économiquement fort? De la croissance a tout prix!
Si l'on reprend l'idée de départ :
Le premier principe semble directement évacué. L'économisation empêchant de facto toute possibilité de lui permettre d'exister.
Une piste qui me semble intéressante en ces termes, serait d'octroyer une allocation universelle, qui pourrait nous libérer du joug de l'économisation (en rendant notre survie moins dépendante de cette logique).
Et qui sait, peut-être pourrions-nous la financer en nous attaquant au dernier pilier de l'ordre ancien, l'armée?
L'Eglise, la noblesse et l'armée dirigeaient notre monde. Nous nous sommes révoltés contre la noblesse. Nous avons bouté l'Eglise hors du pouvoir. Mais jamais, nous n'avons même envisagé de nous attaquer au dernier pilier, l'armée. 1600 milliards de dollars de dépenses annuelles, dont la seule utilité est la destruction.
Et lorsque l'on voit ce genre d'info :
http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/021818536227-2015-un-tournant-dans-les-depenses-militaires-mondiales-1211743.php?euHwp1m7dvgqH9Tg.99
On se dit qu'il y a peut-être des investissements plus heureux que ceux-là...
Gérer l'Etat belge, pas la S.A. Belgique
En s'engouffrant dans le piège de l'économisation et en nourrissant un imaginaire de crise permanente qui justifie qu'il " faut " faire des économies, l'Etat naturalise les inégalités sociales tout en plongeant les citoyens dans un état léthargique.
La sortie remarquée du premier président de la Cour de cassation qui dénonce la transformation de notre Etat de droit en "Etat voyou" et les grèves dans les établissements pénitentiaires pour protester face aux projets de rationalisation du ministre de la Justice sont des exemples marquants d'un phénomène qui a tendance à se généraliser à l'ensemble de l'activité de l'Etat. Ces protestations font écho à la carte blanche (Le Soir, 3 mars 2016) de Manuella Cadelli, la Présidente de l'Association syndicale des magistrats, qui dénonçait le sous-financement chronique dans le secteur de la justice et attaquait vivement le néolibéralisme ambiant qu'elle comparait à un fascisme. Plutôt qu'à des réactions sur le fond de son analyse, dont l'actualité ne cesse pourtant de confirmer l'acuité, ses détracteurs se sont le plus souvent limité à contester l'existence même du néolibéralisme pour s'enfermer dans une querelle de mots. Parmi les plus virulents d'entre eux, Corentin de Salle (Directeur scientifique du Centre Jean Gol) rétorqua à Manuella Cadelli dans l'émission "Soir Première" sur la RTBF que les attaques qu'elle porte envers ce qu'elle pense être le "néolibéralisme" constituent en réalité des attaques à l'encontre du "libéralisme" et un travestissement de la pensée des plus grands auteurs libéraux. Nous souhaitons reprendre certains des termes du débat sur le néolibéralisme pour proposer d'en ouvrir les perspectives afin d'envisager les enjeux liés à ce qui s'apparente à une véritable "économisation" des politiques publiques dépassant largement les frontières du secteur de la Justice.
Premièrement, l'argument selon lequel le néolibéralisme n'existe pas au prétexte que l'on ne trouve personne qui se qualifie de "néolibéral" est fallacieux. De très grands intellectuels, dont certains ne sont pas suspectés d'être de dangereux gauchistes, ont consacré des dizaines d'années de recherche scientifique rigoureuse pour mettre en exergue la construction sociale et politique d'une variété de néolibéralismes à travers le monde et les contextes économiques et sociaux. Ils ont démontré que le néolibéralisme est le produit historique d'un collectif de pensée que l'on relie souvent à la création, en 1947, à Vevey (Suisse), de la Société du Mont Pèlerin. Les membres fondateurs de cette Société comprenaient des économistes et intellectuels célèbres, tels que Friedrich Hayek, Milton Friedman, Karl Popper ou encore Michael Polanyi. La société a été créée pour former un réseau transnational d'acteurs qui n'ont eu de cesse de promouvoir activement le retrait de l'Etat et la création et la protection de marchés "libres". Le collectif de pensée néolibéral ne s'est pas limité à la Société du Mont Pèlerin ou à l'Ecole de Chicago. Il s'appuie également aujourd'hui sur des réseaux de think-tanks internationaux comme l'Atlantis Network ou nationaux comme Libera ! (qui travaille notamment sous le patronage de Jan Jambon) ou encore l'Institut Hayek, fondé par Corentin de Salle et Drieu Godefridi, que l'on retrouve aujourd'hui au sein d'un autre think-tank conservateur, l'Institut Turgot. La doctrine politique prônée par les membres qui peuplent ces différents instituts ou sociétés "scientifiques" combine la pensée libérale classique qui consacre la capacité des marchés à fonctionner convenablement et à améliorer le bien-être social avec un nouvel engagement politique qui vise à étendre les relations de marché dans des domaines traditionnellement publics comme la santé, l'éducation, la recherche, la gestion de l'environnement ou la justice. Contrairement au "laissez-faire" classique, les néolibéraux ont compris que les conditions permettant aux marchés de fonctionner étaient le plus souvent peu susceptibles d'émerger naturellement et que, par conséquent, ils avaient besoin d'un Etat fort et du soutien d'institutions internationales comme le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et, serions-nous tentés d'ajouter aujourd'hui, l'Union Européenne, au regard de sa gestion catastrophique de la crise financière, de la crise de l'Eurozone et de la crise de l'asile et des migrants.
Deuxièmement, il est fondamental de ne pas s'arrêter à une querelle de mots pour appréhender le nihilisme dont parle Manuella Cadelli. Qu'on le relie au "libéralisme" ou "néolibéralisme", ce phénomène se rapporte en fait à une logique plus large qu'Elisabeth Popp Berman[1] a qualifiée d' "économisation" de l'Etat et de la société. Ce concept implique une préoccupation politique grandissante avec ce qui touche à "l'économie" et aux abstractions économiques qui s'y rattachent (la croissance, la productivité, la balance des paiements). Dans un contexte global de mise en concurrence généralisée, ces abstractions économiques deviennent des objets de connaissance et un principe d'action général sur base duquel les gouvernements entendent agir et au nom duquel il convient de réorienter l'agenda des priorités politiques, sacrifiant au passage des pans entiers de la sécurité sociale, de la justice, de la culture ou de la recherche fondamentale. Alors que le néolibéralisme est une conception étroite et polarisante, l'économisation est bien plus inquiétante, car elle est compatible à la fois avec des approches politiques néolibérales et des approches politiques interventionnistes. D'un côté à l'autre de l'échiquier politique, il sera facile de trouver d'ardents défenseurs de la maximisation de l'économie et il sera très difficile de trouver des contestataires de l'idée qu'il faut une économie forte. L'évaluation de chacune des mesures politiques à l'aune de sa seule contribution à l'économie nous rend prisonniers d'un faux dilemme moral qui consiste à nous éloigner de ce qui devrait être la préoccupation majeure de nouveaux projets politiques humanistes et solidaires, à savoir leur contribution à l'amélioration de la qualité de vie du plus grand nombre.
En s'engouffrant dans le piège de l'économisation et en nourrissant un imaginaire de crise permanente qui justifie qu'il "faut" faire des économies, l'Etat naturalise les inégalités sociales tout en plongeant les citoyens dans un état léthargique. Les actes de résistances quotidiennes sont anesthésiés, puisque de toute façon "there is no alternative". L'économisation de la politique dépolitise cette dernière, nourrissant la frustration de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, voudraient s'exprimer, se défendre, résister, et qui pourraient ne trouver d'exutoire que dans le populisme, la haine de l'autre et le fanatisme religieux. Quand la politique s'assoupit, rappelons-nous qu'il faut se méfier de l'eau qui dort...
Pierre Delvenne, Chercheur qualifié FNRS à l'Université de Liège, Co-Directeur du Centre de recherches SPIRAL, Département de Science Politique
Nicolas Rossignol, Chercheur à l'Université de Liège, Centre de recherches SPIRAL, Département de Science Politique
[1] Popp Berman, Elisabeth: "Not Just Neoliberalism: Economization in US Science and Technology Policy", Science, Technology and Human Values 39 (3), 2014.
Ces deux chercheurs ont une vision intéressante de notre monde moderne. Depuis quelques temps, je pensais que le libéralisme, ou néo-libéralisme, ne pouvait suffire à expliquer l'évolution de nos sociétés. J'étais arrivé à la conclusion que le système capitaliste en lui-même, accompagné du néo-libéralisme détruisait notre société. Je trouve que ces deux chercheurs apportent une vision plus nuancée, en parlant d'économisation. L'Etat ne s'affaiblit pas, mais il se soumet à ce principe. Ce qui tend à tuer tout forme de diversité dans la pensée politique. Tout le monde n'est-il pas d'accord, sur un très large spectre de la pensée politique qu'il nous faut un Etat, une nation, économiquement fort? De la croissance a tout prix!
Si l'on reprend l'idée de départ :
Il lui faut tout d’abord remettre en vigueur deux principes qui, pour être de bon sens, n’en sont pas moins bafoués aujourd’hui :
- l’Etat n’est souverain que si la hiérarchie légitime des pouvoirs est respectée : le politique régulant l’économique, lui-même servi et non asservi par la finance ;
- l’Etat n’est souverain que s’il est maître de son territoire, ce qui est incompatible avec l’ouverture inconditionnelle des frontières.
Le premier principe semble directement évacué. L'économisation empêchant de facto toute possibilité de lui permettre d'exister.
Une piste qui me semble intéressante en ces termes, serait d'octroyer une allocation universelle, qui pourrait nous libérer du joug de l'économisation (en rendant notre survie moins dépendante de cette logique).
Et qui sait, peut-être pourrions-nous la financer en nous attaquant au dernier pilier de l'ordre ancien, l'armée?
L'Eglise, la noblesse et l'armée dirigeaient notre monde. Nous nous sommes révoltés contre la noblesse. Nous avons bouté l'Eglise hors du pouvoir. Mais jamais, nous n'avons même envisagé de nous attaquer au dernier pilier, l'armée. 1600 milliards de dollars de dépenses annuelles, dont la seule utilité est la destruction.
Et lorsque l'on voit ce genre d'info :
http://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/021818536227-2015-un-tournant-dans-les-depenses-militaires-mondiales-1211743.php?euHwp1m7dvgqH9Tg.99
...A la troisième place du classement des 15 Etats qui dépensent le plus pour leur armée, le Sipri affiche une surprise : l'Arabie saoudite (87,2 milliards) aurait détrôné la Russie (66,4 milliards) l'an dernier....
...Au cours des dix dernières années, les dépenses militaires de l'Arabie saoudite ont augmenté de 97% pour atteindre le record de 13,7 % du PNB du pays, quand celles de la Russie ont cru de 91 % et représente 5,4 % du PNB national....
On se dit qu'il y a peut-être des investissements plus heureux que ceux-là...
- Demos
- Messages: 47
- Enregistré le: Jeu 02 Juil 2015 16:49
11 messages
• Page 1 sur 2 • 1, 2
Retourner vers Notes du portail
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- 1973-2013 : De l’Etat souverain à l’Etat soumis
par scripta manent » Mer 17 Avr 2013 09:04 - 7 Réponses
- 4897 Vus
- Dernier message par Demos

Ven 23 Sep 2016 17:57
- 1973-2013 : De l’Etat souverain à l’Etat soumis
-
- Maurice Lévy : " Profitons-en pour repenser l'Etat "
par scripta manent » Sam 11 Fév 2012 21:26 - 1 Réponses
- 3838 Vus
- Dernier message par voxpop

Mer 28 Mar 2012 18:18
- Maurice Lévy : " Profitons-en pour repenser l'Etat "
-
- Ils veulent " repenser l'Etat "
par scripta manent » Mer 18 Sep 2013 13:13 - 7 Réponses
- 4509 Vus
- Dernier message par causonsen

Dim 29 Mar 2015 12:45
- Ils veulent " repenser l'Etat "
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité