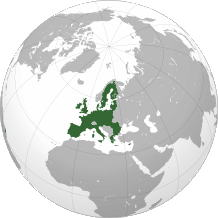Un long épisode du feuilleton grec vient de prendre fin avec la rupture des négociations et l'annonce d'un référendum grec sur la proposition européenne. Il y avait deux options à l' issue de ce duel entre le petit État Grec et ce qu'on a appelé la Troïka (Commission Européenne, Banque Centrale Européenne et Fonds Monétaire International): ou bien les parties gagnaient toutes les deux, ou bien elles perdaient toutes les deux. L'option d'un échec commun semble avoir été retenue.
Comment en est-on arrivé là ?
Trop souvent, on fait remonter les prémisses de la crise de la dette en Europe et en particulier en Grèce, aux extravagances bancaires de 2008. Or, ce cataclysme financier n'a fait qu'accélérer les choses mais le scénario était écrit depuis 1980.
Les années 1980 sont celles de l'arrivée au pouvoir de Ronald REAGAN aux États-Unis et de Margaret THATCHER en Grande Bretagne, deux chantres inconditionnels du libéralisme. L'objectif devient alors la compétitivité des économies dans un monde qui voit ses échanges s'intensifier depuis 1945. Dès lors, le moyen de l'atteindre est de faire baisser les salaires et les coûts associés. La mise au pas des syndicats en Angleterre participe de cette logique ainsi que les critiques de plus en plus virulentes du modèle social de l’état providence et la mise en œuvre de son dé-tricotage progressif.
La création de l'Organisation Mondiale du Commerce en 1995, précédée de peu par la chute de l'URSS et la réunification allemande ainsi que la conversion de la Chine au nouveau dogme mondial finalisent la mise en place de l'idéologie triomphante (le communisme est écrasé et d'une certaine façon son avatar le socialisme).
Selon la formule de Laurent CARROUE (Géographe et économiste), la mondialisation actuelle est un «processus géohistorique d’extension progressive du capitalisme à l’échelle planétaire ; c'est à la fois une idéologie – le libéralisme –, une monnaie – le dollar –, un outil – le capitalisme –, un système politique – la démocratie –, une langue – l’anglais» (La mondialisation, genèse, acteurs et enjeux : 2005). Il faudrait sans doute compléter cette définition en qualifiant ce capitalisme de financier et la démocratie de formelle.
Pourquoi donc dans ce contexte, les cinquante dernières années ont-elle conduit à cette impasse actuelle de la dette dans tant de pays dont la Grèce ?
On peut relever trois types de facteurs :
Un environnement mondial,
Des responsabilités grecques,
Le fonctionnement de l’Union Européenne.
Au niveau global plusieurs raisons semblent émerger sans qu'on ait nécessairement fait le tour du sujet :
Marx avait prédit la fin du capitalisme par la loi des rendements décroissants. Le capitalisme l'a contredit par un emploi massif du crédit, une véritable fuite en avant ! Peut-on imaginer que cette explosion du crédit n'ait pas de limite ? Si l'on pense que l'espace terrestre n'est pas cette immensité galactique qui l'entoure et qui semble permettre une expansion illimitée (encore que les astrophysiciens se demandent aujourd'hui si on ne retournera pas un jour à une contraction), la bulle-crédit porte en elle-même ses propres limites voire son anéantissement. Et les solutions autres que le remboursement sont à la fois plus nombreuses et plus probables......
Le commerce mondial n'est pas régulé ou si peu. L'OMC ne se salit les mains ni dans les manipulations de change, ni dans les lois sociales des pays ni même dans les conditions de travail (elle n'est pas concernée par le travail des enfants par exemple). On voit donc monter des déséquilibres insensés des balances commerciales que l'on retrouve dans l'endettement d'un côté et dans les réserves de change de l'autre. Se contenter de dire que la balance commerciale de l'UE est positive sans voir les déséquilibres internes n'a aucun sens en dehors d'une intégration dont plus personne ne semble vouloir.
La conséquence parfaitement prévisible de l'application de la doctrine libérale pour ses partisans était la baisse progressive mais inévitable des salaires des pays développés, la baisse de leurs standards sociaux, la disparition de l’état providence et une montée inéluctable des inégalités entre ceux qui sauraient tirer partie de cette nouvelle situation et les laissés pour compte.
Or les revenus réels n'ont pas baissé suffisamment pour être concurrentiels avec les pays émergents dopés par le flux d'investissements et les transferts de technologie, quand ces mêmes pays ne se shootaient pas aux taux de change comme la Corée du sud ou la Chine.
En Europe de l'ouest, des trois moteurs de la croissance: les exportations, les investissements et la consommation, les deux premiers sont en panne dans de nombreux pays et le troisième a été maintenu artificiellement par l'emprunt. Aucun gouvernement démocratiquement élu n'aurait pu imposer à son peuple la cure d'amaigrissement que suppose la globalisation. Sans l'endettement de ses partenaires, même l'Allemagne n'aurait pu réussir en dépit de son talent industriel, de sa réunification, de la modération salariale des années 2000 et de l'entrée des anciennes démocraties populaires dans l'UE qui sont pour elle à la fois clientes, centres de production à faible coût et réservoir de main d’œuvre à charges sociales réduites.
Dans ce contexte mondial, la Grèce apparaît comme un pays spécifique avec finalement peu d'atouts.
Jusqu'aux années 1950, la Grèce tirait ses ressources de l'agriculture. En 2011, celles-ci ne représentaient plus que 3,2% du PIB du pays. Beaucoup de Grecs se plaignent qu'ils consomment de plus en plus de biens importés. En outre, l'exode rural s'est révélé moins important que dans les pays de l'Union et a, de ce fait, joué sur la dimension des exploitations ( moins de regroupements ), leurs investissements et leur productivité.
Enfin, du fait des reliefs, la surface agricole utile (SAU: Terres arables, herbages, cultures pérennes tels que vigne et olivier, jardins familiaux) dépasse à peine les 20% contre 54% par exemple pour la France. Quant à l'industrie, elle est peu développée (autour de 20% du PIB) et plus de la moitié de l'activité du pays se trouve dans les services, principalement le tourisme.
La formation brute de capital fixe (les investissements dans l'agriculture, l’industrie, les services, les communications, les établissements publics) plafonne à 12% du PIB quand l'Allemagne ou la France y consacrent autour de 20%. Or, ces investissements sont source d'emploi et de productivité accrue.
«Le système de retraite grec pèse lourdement sur les dépenses de l’état avec une part trop faible des cotisations des salariés et des employeurs. Le déséquilibre menaçait déjà le système avant la crise de 2009. Il s'est aggravé durant les six années de récession avec un taux de chômage qui est passé de 9,5% à 26,6% et le PIB amputé d'un quart. La Grèce compte actuellement 2,6 millions de retraités et 1,2 million de chômeurs pour 3,5 millions de population active. C'est aussi l'un des pays les plus âgés d'Europe avec 20,5% de la population âgée de plus de 65 ans.» (Le Figaro économie du 26/06/2015).
Cependant, le chômage pèse peu sur les dépenses publiques dans la mesure où les chômeurs (moins de 400 € par mois) ne sont plus indemnisés et ne bénéficient plus de couverture sociale après un an.
Beaucoup trop de Grecs sont réticents à l'impôt et aux déclarations fiscales. On a longtemps entendu avant 2008 que ce refus se justifiait par la corruption et le mauvais usage des fonds publics. Aujourd'hui, la raison est que l'on refuse de payer des impôts pour rembourser une dette dont on ne se sent pas responsable. Les histoires répétées mettant en scène des fonctionnaires des impôts «ripoux» s'ajoutent aux cas vécus d'entreprises de plusieurs dizaines de salariés vous proposant aujourd'hui (06/2015) un paiement en cash sans TVA alors que leur activité est tellement transparente qu'un contrôle de routine dévoilerait la pratique. Un tel système ne peut survivre sans des protections de la part de certains fonctionnaires.
Beaucoup de médias ont rapporté la proportion importante des dépenses publiques pour justifier les coupes sombres y compris dans la santé et l'éducation. La part des dépenses publiques (60% en 2013 : Eurostat) apparaît démesurée aujourd'hui compte tenu de la baisse du PIB de ces dernières années (autour de 25%). En 2014, elle s'établissait à 49,3% en dépit d'une très faible hausse du PIB (moins de 1%) ce qui montre la brutalité des restrictions budgétaires. Le malheur de la Grèce est que nombre de postes de fonctionnaires, dans le passé, ont servi à acheter des voix lors des élections et les critères de recrutement se sont avérés parfois loin des normes affichées et peu en rapport avec les besoins des services publics.
Ensuite, la Grèce est une zone montagneuse et sismique avec des normes de construction plus onéreuses; elle possède 200 îles qu'il faut desservir de façon régulière à des tarifs ne couvrant pas toujours le coût des transports et présente, on l'a vu, une structure des générations peu favorable.
Enfin la Grèce en est à son cinquième défaut en matière de dettes souveraines, chiffre important compte tenu de sa courte histoire (1830) mais qui n'est rien à côté de l'Espagne (15) ou de la France (10), sur une période plus longue, il est vrai. Son parlement a jugé la dette grecque illégitime, illégale, odieuse, insoutenable. La Grèce ne peut s’exonérer de toute responsabilité ! Le rapport parlementaire met en cause les taux d'intérêts, la corruption attachée aux dépenses militaires, la crise financière, la politique de la Troïka...... Trop de Grecs ne se sentent pas responsables de cette dette ! Il suffirait de dire qu'elle est insoutenable pour qu'on les comprenne........
Sur ce terreau où contexte mondial et spécificités grecques aggravent la situation, l'Europe, emboîtant le pas au FMI, a décidé d'intervenir. De nombreuses fautes stratégiques ont été commises par ces institutions en même temps qu'elles ont montré l'inefficacité de leurs politiques.
L'Europe a été le moteur de l'entrée des pays membres dans la logique libérale et le recrutement de ses dirigeants s'en ressent. On aurait peine à trouver un commissaire, ou un membre de la BCE qui ne serait pas «certifié libéral». Dans ce climat les solutions ne pouvaient être que libérales !
Les acteurs de ce «soutien contre réformes» ont été:
le Fonds Européen de Stabilité Financière puis le Mécanisme Européen de Stabilité (MES) depuis 2012. Cette institution financière européenne dirigée par le collège des ministres des finances de ses membres (zone euro) intervient un peu comme le FMI procurant des liquidités aux pays de L'UE moyennant un train de réformes,
le FMI qui est intervenu parallèlement,
la BCE, en rachetant des obligations du pays sur le marchés secondaire et en mobilisant ses fonds d'urgence pour aider les banques grecques.
Trois institutions pour régler un même problème ! Cela montre à la fois la faiblesse des institutions européennes et leur inadaptation à gérer des crises de cette importance. On n'ose imaginer ce qui surviendrait si un autre pays comme l'Italie ou la France se trouvait confronté aux mêmes difficultés.....
Enfin, cerise sur le gâteau, les acteurs de l'UE ont réussi ce tour de force de faire passer les dettes bancaires, donc privées, vers les contribuables européens alors que ces mêmes banques sont en partie la cause des désordres actuels et que leurs profits sont redevenus florissants. Le principe de privatisation des profits et de socialisation des pertes mériterait presque d'être inclus dans la Constitution Européenne !
L'objectif de la Troïka était de diminuer le niveau des salaires et des prix pour redonner à la Grèce la compétitivité qui lui manquait. En même temps, le dogme libéral réclamait de réduire le rôle de l’État pour faire apparaître un excédent budgétaire, gage du paiement des intérêts de la dette et des remboursements futurs. La formule est universelle et ne tient pas compte des spécificités du pays. En bonne logique, en réduisant les revenus, on réduit la demande et les importations,tandis qu'on relance les exportations et qu'on enclenche ainsi un mécanisme de reprise. La recette a fonctionné dans l'Allemagne des années 2000, en rendant compétitives les industries exportatrices par une réduction de leurs salaires et des services qu'elles utilisent. Malheureusement, en Grèce, la purge a tué le malade et aboutit à des effets secondaires allant à l'encontre du but fixé. Ci-dessous les quelques chiffres tirés d'Eurostat (Libération du 11 avril 2014) qui sont loin de refléter la misère que peut engendrer de tels bouleversements.
............................................................................... 2008...............2009...............2010..............2011...................2012................2013
CHÔMAGE en % de la population sans emploi.......... 7,70%..............9,50%.............12,60%...........17,70%...............24,30%.............27,30%
PIB Grec en milliers d' Euros................................... 233 198 €.......213 108 €.......222 152 €......208 532 €.........193 347 €.........182 054 €
DETTE en % du PIB.................................................112,90%...........129,70%..........148,30%.........170,30%.............156,90%...........177,30%
En dépit de ces chiffres, la Troïka continue à penser qu'il ne faut pas changer de méthode !
Enfin, il reste une grenade dégoupillée parce que cette politique suppose que la croissance reparte et bénéficie ainsi de la baisse des revenus. Or, il semble que rien ne soit moins sûr au niveau mondial et que la Grèce ne fasse pas exception. Si c'est le cas et si les politiques américaines et européennes d'injection massive de liquidité dans le système bancaire n'ont d'autre effet que de créer de nouvelles bulles spéculatives, alors, on voit mal comment on pourra sortir de cette crise sans une volonté politique de rééquilibrer les échanges et sans qu'on décide, au niveau mondial, d'un «hair cut» (suppression ou tonte) massif de toutes les dettes. Même les pays créanciers devraient en voir l'avantage.
La Troïka soutenue par l'Allemagne a ensuite fait une triple erreur tactique:
La Troïka a remis en selle les anciens «Barons voleurs» qui ont conduit le pays dans cette impasse, se privant ainsi d'une enquête internationale pour révéler les manipulations et corruptions de ces mêmes élites. Mme MERKEL et M. SCHAUBLE n'ont jamais caché leurs sympathies pour les politiques menées dans des pays dirigés par des responsables du même bord qu'eux, discréditant au passage les partis d'opposition. Au regard de cette conception, M.TSIPRAS n'est pas légitime !
Faute d'institutions véritablement représentatives en Europe, les négociations ont été confiées à des technocrates libéraux qui ont donné l'image d'une élite avide de pouvoir et qui, n'étant pas issue du suffrage universel, n'en avaient que faire. (Lire en particulier « De la démocratie en Europe » de Mario MONTI). Il faut se souvenir du tollé qu'avait provoqué la proposition de M PAPANDREOU d'un référendum. Alexis TSIPRAS semble au moins bénéficier de plus de mansuétude parce que ces mêmes technocrates espèrent que, tétanisés par la crainte des conséquences du GREXIT, les électeurs se rangeront à leurs propositions.
Enfin, l'Allemagne n'a cessé de jouer la mouche du coche apparaissant aujourd'hui comme le vrai patron auto-désigné de l'Europe alors que Jean-Claude JUNCKER ne réussit pas à troquer son costume de premier ministre d'un «paradis fiscal» pour celui d'un dirigeant européen. Or, cette même Allemagne doit son succès, comme précisé plus haut, à un ensemble de causes qui ne relèvent pas toutes de son caractère industrieux et méthodique. Le rôle de certaines entreprises dans la corruption de quelques politiques Grecs, l'allégement de sa dette au sortir de la guerre, son attitude contestable dans les termes de sa réunification afin de ne pas verser d'indemnités à la Grèce jusqu'à certains articles nauséabonds dans le journal Die Welt ont constitué un obstacle sérieux à un climat propice à la négociation. (http://www.latribune.fr/economie/union- ... 84327.html).
Que faudrait-il faire maintenant? Sans doute faire confiance à la Grèce. La corruption n'est pas un monopole de ce pays et ceux qui critiquent l'apparente nonchalance des Grecs devraient venir travailler sur les chantiers en plein soleil avec un équipement souvent réduit ou obsolète ou regarder plus avant les statistiques de temps de travail!
La Grèce a peut-être un problème d'âge de départ à la retraite mais elle a surtout un problème de chômage comme beaucoup de pays en Europe. Compte tenu de la moyenne d'âge, le non-remplacement des départs à la retraite dans l'administration aurait pu rapidement ajuster les effectifs. Elle a actuellement de façon certaine un problème d'accès à la santé et d'investissement dans son avenir par la formation. Pourquoi ne pas faire confiance au gouvernement actuel, démocratiquement élu sur une période de 2 ans, afin de voir de quoi il est capable et geler pour cette période les remboursements et l'aide correspondante de l'Europe ? En cas d'échec, nul doute que les Grecs eux-mêmes ne pardonneraient pas à leurs dirigeants et en changeraient.
L'union Européenne redorerait un blason bien terni par des années d'échec de sa politique en Grèce et par l'obsession de ses dirigeants à se comporter en chef d'un État européen qu'ils sont incapables de mettre sur les rails. A continuer de la sorte, cette Europe-là et même l'idée d'Europe tout court risque fort de disparaître devant la montée des extrêmes qu'elle aura elle-même suscitée.
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
La Grèce entre rupture des négociations et référendum
3 messages
• Page 1 sur 1
La Grèce entre rupture des négociations et référendum
Modifié en dernier par KERHUNE le Mer 12 Aoû 2015 09:10, modifié 1 fois.
- KERHUNE
- Messages: 56
- Enregistré le: Mer 26 Oct 2011 19:59
Re: La Grèce entre rupture des négociations et référendum
Les sources de la dette belge :
http://www.onveutsavoir.be/d-ou-vient-la-dette.php
Pour corroborer cette magnifique analyse, je me permets de pointer un petit article sur les sources de la dette belge, qui devrait nous renseigner sur les très probables sources de la dette grecque.
Incroyable comme les chiffres peuvent nous ramener à la dure réalité. La politique du début des années 80 de Tatcher et Reagan ont fait perdre des centaines de milliard d'euros aux acteurs publiques, et tout cela de manière particulièrement discrète. Evidemment, ce genre de détails ne fait pas partie de l'argumentaire néo libéral, qui continue de nous asséner jour après jour, que si les Etats sont endettés, ce n'est du qu'à leur mauvaise gestion.
La politique monétaire de l'Union n'est pas en reste. Une forfaiture totalement étrange qui permet à la BCE de prêter aux acteurs privés a des taux proches des 0%, tandis que les Etats qui s'endetteront auprès de ces fameux acteurs privés, devront s'acquitter de taux bien plus élevés (dépassant parfois les 10%).
Sans une modification substantielle de ce système vicié, personnellement, je ne pense pas qu'une solution à plus long terme soit possible. La question qui continue de me tarauder, comment a-t-on pu laisser un tel monstre se mettre en place, alors que nous sortions aux début des années 80 d'une des périodes les plus fastes qu'ait connu l'Europe, les 30 glorieuses. Pourquoi devoir passer aux 30 infernales, avec son cortège de crises à répétition?
http://www.onveutsavoir.be/d-ou-vient-la-dette.php
Pour corroborer cette magnifique analyse, je me permets de pointer un petit article sur les sources de la dette belge, qui devrait nous renseigner sur les très probables sources de la dette grecque.
1. Les sauvetages des banques de 2008 et de 2011
Aujourd'hui, on ne parle quasiment que du problème du déficit et des dettes publiques. Pourtant, si la dette publique a augmenté, c’est surtout à cause du sauvetage des banques privées. On a donc socialisé massivement des dettes privées.
Ce sauvetage a provoqué une augmentation de la dette publique de 32,5 milliards €. Il ne faut cependant pas oublier les possibles nouvelles recapitalisations et les garanties publiques octroyées aux banques belges qui constituent une menace très grave pour les finances publiques.
2. L'explosion des taux d'intérêts fin des années 70
En 1979, pour lutter contre l'inflation, attirer les capitaux et relancer la machine économique américaine (notamment par un grand programme militaro-industriel), le gouvernement des États-Unis a décidé unilatéralement de relever fortement les taux d'intérêts. Cette hausse s’est répercutée rapidement au niveau mondial et la Belgique n'a pas échappé à la contagion. A cette époque, l'État belge a emprunté à des taux allant jusqu'à 14% ! Les charges d'intérêts ont alors explosé : au cours des années 80, la Belgique payait annuellement près de 20 milliards €… uniquement en intérêts de la dette (on est à environ 13 milliards € aujourd'hui).
3. Une politique fiscale socialement injuste
L'accroissement de la dette de l'État ces 30 dernières années est également dû à un choix politique qui a mis en place une fiscalité favorisant les grosses fortunes et les grandes entreprises privées : intérêts notionnels, réduction de la progressivité de l'impôt, précompte mobilier libératoire, amnisties fiscales… Ces mesures ont provoqué une diminution importante des recettes publiques. Contrairement à ce que beaucoup affirment, la crise de la dette belge est donc une crise des recettes et non une crise des dépenses.
4. Une politique monétaire socialement injuste
Depuis 1992 et le Traité de Maastricht, les pays de l'Union européenne ont renoncé à la possibilité d'emprunter à un taux de 0% auprès de leur banque centrale nationale. Ils sont désormais obligés de s'adresser aux banques privées qui prêtent à des taux fixés par les marchés internationaux de capitaux. Ce choix a coûté très cher à la Belgique :
Sur la période 1992-2011, l'État belge a remboursé, en intérêts de la dette, un montant équivalent à 313 milliards €. S’il avait pu emprunter les mêmes montants auprès de sa banque centrale, à un taux de 1%, il aurait alors économisé 250 milliards €…
Incroyable comme les chiffres peuvent nous ramener à la dure réalité. La politique du début des années 80 de Tatcher et Reagan ont fait perdre des centaines de milliard d'euros aux acteurs publiques, et tout cela de manière particulièrement discrète. Evidemment, ce genre de détails ne fait pas partie de l'argumentaire néo libéral, qui continue de nous asséner jour après jour, que si les Etats sont endettés, ce n'est du qu'à leur mauvaise gestion.
La politique monétaire de l'Union n'est pas en reste. Une forfaiture totalement étrange qui permet à la BCE de prêter aux acteurs privés a des taux proches des 0%, tandis que les Etats qui s'endetteront auprès de ces fameux acteurs privés, devront s'acquitter de taux bien plus élevés (dépassant parfois les 10%).
Quels sont les montants en jeu ?
Au total, les banques pourront emprunter jusqu'à 400 milliards d'euros sur quatre ans (dans la limite de 7 % de leur stock de crédit aux ménages et entreprises, hors immobilier) lors de l'opération du 18 septembre, puis de celle du 11 décembre.
Le taux d'emprunt est très avantageux : il est de 0,15 %.
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/economie/article/ ... l94XuVZ.99
Sans une modification substantielle de ce système vicié, personnellement, je ne pense pas qu'une solution à plus long terme soit possible. La question qui continue de me tarauder, comment a-t-on pu laisser un tel monstre se mettre en place, alors que nous sortions aux début des années 80 d'une des périodes les plus fastes qu'ait connu l'Europe, les 30 glorieuses. Pourquoi devoir passer aux 30 infernales, avec son cortège de crises à répétition?
- Demos
- Messages: 47
- Enregistré le: Jeu 02 Juil 2015 16:49
Re: La Grèce entre rupture des négociations et référendum
Sortie médiatique de Verhofstadt, largement relayée dans la presse, de manière injuste par rapport au déroulement de la séance euro parlementaire. Une opinion de Bleri Lleshi, politologue et philosophe.
http://www.levif.be/actualite/international/quand-tsipras-mouche-verhofstadt/article-opinion-404749.html
On sera intéressé d'apprendre que la Grèce est le pays européen ayant mis en oeuvre le plus de réformes ces dernières années. Que la presse montre un Verhofstadt ovationné au parlement européen, et fait croire qu'il est nettement plus plébiscité que Tsipras, alors que ce dernier a été applaudi deux fois plus longuement. Anecdotique peut-être, mais le genre d'anecdote qui fausse la réalité et occulte l'intérêt et l'écoute des parlementaires européens. En jouant la star, Verhofstadt offre aux caméras un angle de vue du parlement qui ne correspond guère à la réalité. Belle mise en scène, surtout de la part d'un des plus gros "cumulards" du parlement.
Tsipras répond très "professionnellement" et avance de nombreux arguments, qui seront tout simplement éclipsés par les médias.
Pour conclure, Tsipras rappelle un moment clé de l'histoire européenne, l'année 1953, ou la moitié de la dette allemande fut purement et simplement annulée.
On nous mentirait donc, et on essaierait de nous imposer une vision idéologisée de cette crise ?
http://www.levif.be/actualite/international/quand-tsipras-mouche-verhofstadt/article-opinion-404749.html
On sera intéressé d'apprendre que la Grèce est le pays européen ayant mis en oeuvre le plus de réformes ces dernières années. Que la presse montre un Verhofstadt ovationné au parlement européen, et fait croire qu'il est nettement plus plébiscité que Tsipras, alors que ce dernier a été applaudi deux fois plus longuement. Anecdotique peut-être, mais le genre d'anecdote qui fausse la réalité et occulte l'intérêt et l'écoute des parlementaires européens. En jouant la star, Verhofstadt offre aux caméras un angle de vue du parlement qui ne correspond guère à la réalité. Belle mise en scène, surtout de la part d'un des plus gros "cumulards" du parlement.
Verhofstadt dénonce son dégoût du clientélisme en Grèce. Pour cette saillie, il a reçu les applaudissements des conservateurs et des libéraux au sein du parlement. Il a raison, car le clientélisme est un problème en Grèce. Seulement c'est pour le moins hypocrite que ce soit justement Verhofstadt qui se lance sur ce sujet.
C'est d'autant plus ironique que l'un des plus grands cumulards est... Guy Verhofstadt. Seuls trois parlementaires européens font mieux que lui. Verhofstadt a au moins 11 mandats et gagne de cette façon plus de 200.000 euros supplémentaires par an. Ce même Verhofstadt a également reçu une prime de 327.000 euros pour la rénovation de sa maison. En parlant de privilèges...
Tsipras répond très "professionnellement" et avance de nombreux arguments, qui seront tout simplement éclipsés par les médias.
Le premier ministre grec précise son propos en égrenant en moins de deux minutes les différentes réformes que la Grèce a appliquées et veut encore introduire. Honnêtement, l'exercice ne devait pas être compliqué, car la Grèce est le pays européen qui a mis en application le plus grand nombre de réformes. Il semble que Verhofstadt et ses applaudissant comparses n'en soient pas informés. Au fur et à mesure que Tsipras énonce les différentes réformes, Verhofstadt perd de sa superbe.
Pour conclure, Tsipras rappelle un moment clé de l'histoire européenne, l'année 1953, ou la moitié de la dette allemande fut purement et simplement annulée.
Par souci d'honnêteté, rappelons que Verhofstadt ne fut pas le seul à être mouché. Le leader du parti populaire européen, l'allemand Manfred Weber, a aussi piqué un fard lorsque Tsipras lui a rappelé que l'Union européenne est avant tout une question de solidarité et que l'un des plus importants moments de cette solidarité fut l'année 1953. L'année où l'Europe a effacé la moitié des milliards de la dette allemande.
On nous mentirait donc, et on essaierait de nous imposer une vision idéologisée de cette crise ?
- Demos
- Messages: 47
- Enregistré le: Jeu 02 Juil 2015 16:49
3 messages
• Page 1 sur 1
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Referendum grec: entretien avec Coralie Delaume
par Apache » Lun 06 Juil 2015 00:19 - 0 Réponses
- 1570 Vus
- Dernier message par Apache

Lun 06 Juil 2015 00:19
- Referendum grec: entretien avec Coralie Delaume
-
- La Grèce mise en perspective
par KERHUNE » Mer 12 Aoû 2015 09:02 - 0 Réponses
- 1698 Vus
- Dernier message par KERHUNE

Mer 12 Aoû 2015 09:02
- La Grèce mise en perspective
-
- Grèce : responsables et boucs émissaires
par scripta manent » Sam 25 Fév 2012 18:17 - 0 Réponses
- 1884 Vus
- Dernier message par scripta manent

Sam 25 Fév 2012 18:17
- Grèce : responsables et boucs émissaires
-
- Les mesures imposées à la Grèce ont été catastrophiques pour l’environnement
par agénor » Dim 05 Juil 2015 23:47 - 1 Réponses
- 1504 Vus
- Dernier message par Demos

Mar 07 Juil 2015 15:19
- Les mesures imposées à la Grèce ont été catastrophiques pour l’environnement
-
- Jürgen Habermas : Pourquoi la politique de Merkel vis-à-vis de la Grèce est une erreur
par agénor » Dim 28 Juin 2015 13:25 - 0 Réponses
- 1530 Vus
- Dernier message par agénor

Dim 28 Juin 2015 13:25
- Jürgen Habermas : Pourquoi la politique de Merkel vis-à-vis de la Grèce est une erreur
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité