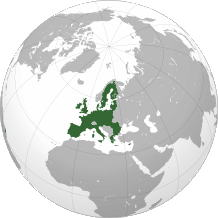La Direction générale du Trésor en France vient de publier une étude comparative des systèmes de protection sociale en France et en Allemagne. Belle occasion de prendre connaissance des données réelles d'une problématique souvent évoquée de façon partisane et polémique.
Nous en reproduisons ci-dessous le résumé, ainsi que la synthèse de chaque chapître :
RESUME
" La Direction générale du Trésor s’est livrée à une analyse comparée des systèmes de protection sociale en France et en Allemagne autour de 9 thématiques : le financement de la protection sociale, l’assurance maladie, l’assurance des soins de longue durée, la politique familiale, la pauvreté et les minima sociaux, le système de retraites, les dispositifs d’épargne retraite, les politiques de l’emploi et le chômage partiel.
Il en ressort que le système socio-fiscal protège mieux en France contre le risque de pauvreté (13,3 % en France contre 15,6 % en Allemagne en 2009), essentiellement grâce au système de prélèvements et de protection sociale puisque les taux de pauvreté avant transferts socio-fiscaux sont comparables (autour de 24 % dans les deux pays). France et Allemagne consacrent à la politique familiale une part comparable de leur budget, mais la France se singularise par une natalité nettement plus dynamique et un taux d’emploi des mères bien plus élevé.
En revanche, le système allemand apparaît par certains aspects plus simple, à la fois dans sa gouvernance (avec notamment un système généralisé de retraite par point), dans la lisibilité des dispositifs (minima sociaux moins nombreux, structuration de l’épargne retraite autour d’un produit phare, dispositif de chômage partiel plus simple), et dans ses modalités de fonctionnement (notamment en ce qui concerne la prise en charge des personnes handicapées et des personnes dépendantes). Les moyens alloués à l’accompagnement et au suivi des demandeurs d’emploi allemands sont plus importants en Allemagne tandis que l’indemnisation du chômage est plus faible. Enfin, le pilotage financier est plus exigeant en Allemagne (obligation d’équilibre de l’assurance maladie, régulation de l’offre de soins, non indexation de certaines prestations). "
1 - LE FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
" Le système allemand de protection sociale s’est structuré à la fin du XIXème siècle autour d’une logique contributive d’assurance sociale. Le système français s’est initialement largement inspiré de cette logique bismarckienne tout en intégrant également une dimension d’assistance sociale non contributive de type beveridgienne. Allocations familiales versées sans conditions de ressources, minimum vieillesse, ou encore universalité de la couverture maladie avec la CMU ont renforcé, au fil des années, cette dimension de solidarité en France, ce mouvement s’accompagnant d’une hausse de la part des recettes fiscales dans le financement de la protection sociale. En 2007, l’OCDE soulignait d’ailleurs le large mouvement
de convergence, depuis trois décennies, des systèmes bismarckiens et beveridgiens vers des systèmes mixtes.
Le système social public allemand couvre une plus faible partie de la population que le système français, puisqu’au-delà d’un seuil de revenu (salaire individuel de 4 050 € bruts par mois1), l’affiliation au régime public pour l’assurance maladie n’est plus obligatoire et les contribuables peuvent recourir à une assurance privée (c’est le cas pour 8,8 millions d’Allemands, soit environ 11 % de la population).
Le poids des recettes de protection sociale dans le PIB est comparable dans les deux pays mais les cotisations sociales effectives sur les salaires sont nettement plus élevées en France.
La dynamique récente de la structure des recettes de la protection sociale montre une tendance à la fiscalisation et à la réduction de la part des cotisations sociales dans les deux pays. Les allègements de cotisations sur les bas salaires s’inscrivent dans une volonté commune de réduire le coût du travail, notamment peu qualifié. Toutefois, ils sont, en France
plus importants : ils y sont fonction du salaire horaire et ils sont ciblés sur les cotisations patronales. À l’inverse ils réduisent en Allemagne les cotisations salariales et y sont liés au salaire mensuel.
Dans l’architecture du financement de la protection sociale il faut noter :
o La nature des recettes fiscales varie selon le pays : en Allemagne, 35 % environ des recettes de protection sociale viennent de transferts par l’État du produit d’impôts non explicitement affectés, qui servent également à équilibrer les régimes de sécurité sociale. En France, en revanche, la majeure partie des recettes fiscales (les deux tiers environ), proviennent de ressources exclusivement affectées telles que la CSG. Cette contribution a été créée pour se substituer à certaines cotisations : elle repose sur une assiette plus large que les cotisations sociales puisque les revenus du chômage, des retraites et du capital notamment, sont également soumis à ce prélèvement.
o Bien que contribuant pratiquement autant à la protection sociale dans les deux pays, les cotisations sociales diffèrent à de nombreux égards :
Quant à leur structure, premièrement, puisqu’en moyenne sur l’ensemble de la distribution des revenus, la part acquittée par les employeurs est plus importante en France qu’en Allemagne, et ce malgré les allègements de charges sur les bas salaires.
Deuxièmement, les dispositifs d’allègements de charges en France, notamment sur les bas salaires2, donnent aux cotisations sociales un caractère progressif dans le bas de l’échelle des revenus. C’est moins le cas en Allemagne où les allègements (portant sur les cotisations salariales cette fois) ne s’appliquent qu’aux salaires inférieurs à 800 €
Troisièmement, à l’inverse, les cotisations sociales sont plus souvent plafonnées en Allemagne qu’en France et dès lors, présentent un caractère plus fortement dégressif outre-Rhin dans la partie haute de la distribution de revenus. Les hauts salaires allemands s’avèrent ainsi moins sollicités pour le financement de la protection sociale. Ce trait se trouve d’ailleurs renforcé si l’on ajoute la CSG (exclusivité française) non plafonnée, et donc purement proportionnelle aux revenus. "
2- L'ASSURANCE MALADIE
" La situation financière de l’assurance maladie publique en Allemagne contraste avec celle de la France, puisqu’elle est globalement équilibrée voire excédentaire depuis 2004. Cette situation est le fruit d’une politique volontariste de la part des gouvernements allemands successifs qui s’articule autour de trois axes :
1. Tout d’abord depuis 1996, les gouvernements successifs ont mené une politique active de régulation de la demande de soins. Ces réformes comprennent à la fois des mesures réduisant le champ de la couverture publique du risque maladie
(déremboursement des cures thermales, des transports par taxis ou véhicules de location pour se rendre à l'hôpital, des prothèses dentaires, des lunettes sauf pour les moins de 18 ans). Parallèlement, la participation financière des assurés a été
fortement augmentée (ticket modérateur sur les consultations médicales : forfait de 10 € par trimestre ; forfait journalier hospitalier : 10 € par jour dans la limite de 28 jours calendaires, ticket modérateur sur les boîtes de médicaments prescrites : 10 % du prix du médicament prescrit avec un maximum de 10 € par boîte). Les conséquences négatives sur les gros consommateurs de soins sont limitées par un plafonnement du reste à charge dépendant des ressources.
2. Ensuite, les différentes réformes ont cherché à rationaliser et à réguler l’offre de soins. Des gains d'efficience à l'hôpital sont notamment attendus des restructurations, des fusions et les fermetures des centres hospitaliers peu rentables. Face aux défis des déserts médicaux, l’Allemagne a durci, dès 1993, les conditions d’installation des médecins. De même, les fortes hausses de dépenses de médicament ont conduit le gouvernement allemand à prendre des mesures afin de développer
la part de marché des génériques et de limiter les prescriptions de médicaments.
3. Enfin, l’Allemagne a instauré une mise en concurrence et un pilotage par les soldes pour ses caisses d’assurance maladie : celles-ci sont obligées d’augmenter leurs cotisations en cas de déséquilibre. Ces hausses ne peuvent représenter
chaque année plus de 1 % du revenu de l’assuré. Durant la crise, ce plafonnement n’a pas permis aux caisses de compenser par les seules hausses de cotisations la chute de leurs recettes. Sans l’intervention de l’État, la situation des caisses aurait
été bien plus dégradée. C’est, en effet, le doublement des subventions de l’État entre 2009 et 2010, passant de 7,1 Md€ à 15,6 Md€, qui a permis de préserver l’équilibre financier.
Au total, l'exemple allemand illustre un retour rapide à l'équilibre des comptes de l’assurance maladie au travers d’un plan de mesures de grande ampleur et à l’action sur plusieurs leviers :
- une hausse conséquente de la participation financière des assurés
- la modification du périmètre de remboursement avec l'exclusion du remboursement des prestations peu efficaces sur le plan médical, mais aussi de l'optique et des prothèses dentaires - une politique contraignante envers les professionnels de santé.
- des gains d'efficience à l'hôpital, résultant de restructurations, de fusions et de la fermeture des centres hospitaliers peu rentables ou dont l’activité ne permet pas de garantir une qualité suffisante des soins.
- des recettes supplémentaires. "
3 - L'ASSURANCE DES SOINS DE LONGUE DUREE
" 1- Trois caractéristiques distinguent le système allemand de celui qui existe en France pour la prise en charge des patients qui nécessitent des soins de longue durée. L’Allemagne a opté pour une assurance des soins de longue durée sans critère d’âge. Les personnes handicapées et dépendantes sont donc prises en charge suivant les mêmes règles. Ainsi, il n’existe pas, comme en France, la barrière des 60 ans qui sépare handicapés (personnes souffrant d’une incapacité physique) et dépendants (personnes âgées nécessitant une aide quotidienne). Les comparaisons entre le système allemand et français porte ici sur le champ des soins de longue durée. Les prestations handicap et dépendance sont ainsi
sommées dans le cas de la France.
L’Allemagne a créé une cinquième branche de la sécurité sociale pour couvrir le risque associé au handicap et à la dépendance. Une assurance dépendance obligatoire fondée sur la répartition, adossée à l’assurance maladie et financée par des cotisations sociales, a été mise en place en 1995. Les actifs et les retraités fournissent le même effort (1,95 % de leur
revenu ou pension). L’octroi des prestations ne dépend pas des ressources des bénéficiaires contrairement à la France. Le financement à parité des employeurs et des salariés est ajustable de façon à assurer en continu l’équilibre financier de la branche.
L’évaluation du besoin d’aide en Allemagne semble plus encadrée et codifiée. Ainsi, à chaque niveau de dépendance correspondent de façon très formalisée des niveaux de besoins d’aide en nature calculés en temps de prise en charge. En France, en revanche, une plus grande latitude est laissée à l’évaluateur. De plus, depuis la réforme de 2008 en Allemagne, la
démence, les maladies mentales et les maladies psychiques ont été explicitement incluses dans le calcul des aides. Les troubles mentaux ouvrent les droits à des majorations d’aides (100 € à 200 € par mois) pour financer la supervision de la personne dépendante et soulager les aidants.
2- Les comparaisons chiffrées sont rendues périlleuses par les différences importantes dans l’organisation de la prise en charge des personnes dépendantes et le champ de la couverture.
On compte 2,4 millions de bénéficiaires de prestations de soins de longue durée en Allemagne contre 1,6 millions en France (1,2 millions pour l’APA et 365 000 pour la PCH, l’ACTP et l’AEEH20).
En 2008, les dépenses liées aux soins de longue durée s’élevaient à 1,3 % du PIB en Allemagne contre 1,7 % en France (OCDE) avec, pour la France, une dépense qui se répartissait pour deux tiers sur les plus de 60 ans et le tiers restant sur les prestations du handicap.
En Allemagne, 68 % des dépenses sont financées par l’État et la sécurité sociale, 2 % par les assurances privées. Le reste à charge des ménages représente 30 % des dépenses de soins de longue durée. Il est du même ordre de grandeur pour les dépenses de dépendance en France, selon les comptes de la dépendance21 (10 milliards sur 32 milliards de dépenses totales). "
4 - LA POLITIQUE FAMILIALE
" La France et l’Allemagne font partie des pays de l’Union Européenne les plus généreux envers les familles. L’aide publique aux familles, hors aides fiscales et préscolarisation, est plus élevée en Allemagne : elle y représente en 2009 3,2 points de PIB contre 2,7 points de PIB en France, pour 2,3 points en moyenne dans l’Union Européenne à 25. La dépense publique
par enfant de moins de 18 ans y est également plus élevée, avec respectivement 5 000 € par an et 3 300 €. Lorsque l’on inclut les dépenses de préscolarisation et les avantages fiscaux, le constat s’inverse : d’après l’OCDE, en 2007, la France consacre 3,7 % de son PIB à la famille, l’Allemagne seulement 2,7 %. Rapportée au nombre d’enfants la dépense est
encore plus élevée en France.
Cette générosité est structurée, en France comme en Allemagne, autour de deux principes généraux communs :
- la fiscalité est un outil important de l’aide aux familles : dans les deux pays, près d’un quart de l’aide, hors préscolarisation, passe par des avantages fiscaux ;
- les prestations familiales reposent sur un large socle universel. En France comme en Allemagne, près des deux tiers de l’aide aux familles sont accordés sans condition de ressources.
Au-delà de ces grands traits communs, les modalités de l’aide aux familles diffèrent d’un pays à l’autre, ne traduisant pas seulement des choix techniques, mais des modèles différents :
- le socle universel des prestations familiales est plus généreux en Allemagne ;
- les aides sont davantage modulées selon le revenu en Allemagne qu’en France, notamment parce que les allocations forfaitaires et les avantages fiscaux sont substituables en Allemagne alors qu’ils se cumulent en France pour les ménages imposables.
Par ailleurs, les prestations sous condition de ressources sont limitées en France à certaines configurations familiales ;
- les aides à la famille tiennent compte du rang des enfants dans la fratrie en France, en accordant en particulier une prime à la « famille nombreuse » ; c’est moins le cas en Allemagne. En effet, en France, les aides à la famille excluent largement
les familles de un enfant et augmentent de façon significative au troisième enfant (attribution d’une part entière de quotient familial, majoration significative des allocations familiales, perception d’aides spécifiques). Ce n’est pas le cas en Allemagne où les allocations familiales sont versées à partir du premier enfant et croissent de façon proportionnelle avec le nombre d’enfants ;
- la politique d’accueil du jeune enfant diffère dans les deux pays. En Allemagne, le congé parental, réformé en 2007, est proportionnel au salaire antérieur et limité à un an. En France, il est forfaitaire et peut durer jusqu’à trois ans. Par ailleurs,
l’offre et le système d’aides à la garde sont plus développés en France. La réforme de 2007 a recentré la politique familiale allemande vers la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle. Le système français vise, quant à lui, une certaine neutralité par rapport au choix parental du mode de garde. L’effort de l’Allemagne en faveur de la garde ou de la scolarisation des enfants de moins de 5 ans demeure plus faible qu’en France.
Malgré le choix commun de soutenir largement les familles, les résultats des politiques familiales menées par chacun des pays diffèrent :
- la France fait preuve d’un fort dynamisme démographique avec un taux de fécondité s’élevant à 2, l’un des plus élevés de l’Union Européenne, contre seulement 1,4 pour l’Allemagne. Ces écarts de fécondité sont cohérents avec les écarts
de fécondité souhaitée : les femmes allemandes désirent 2 enfants en moyenne contre 2,6 pour les femmes françaises. La fécondité allemande est structurellement plus basse que celle de la France depuis la fin de la seconde guerre mondiale et l’écart se creuse depuis 10 ans. La différence entre les taux de fécondité de chacun des pays se traduit par un nombre plus important de ménages sans enfant en Allemagne (67 % contre 58 %) et par une plus forte part de ménages avec trois enfants ou plus en France (17 % contre 12 %).
- alors que le risque de pauvreté est globalement un peu plus élevé en Allemagne (15,6 % contre 13,3 % en France en 2009), les enfants y sont mieux protégés : en 2009, le taux de pauvreté des moins de 18 ans était de 17,5 % en Allemagne contre
17,9 % en France ;
- le taux d’emploi des mères allemandes, notamment quand elles ont deux enfants ou plus ou un enfant de moins de 6 ans, est plus faible que celui des mères françaises alors que les taux d’emploi des femmes sans enfant sont comparables. Lorsqu’elles sont en emploi, elles sont nettement plus souvent à temps partiel : 24 % des mères françaises d’un enfant de moins de 6 ans qui travaillent sont à temps partiel, contre 56 % pour les mères allemandes. "
5 - PAUVRETE ET MINIMA SOCIAUX
" Bien que le seuil de pauvreté soit proche dans les deux pays (autour de 900 €/mois pour une personne seule), le taux de pauvreté est plus élevé en Allemagne qu’en France (15,6 % contre 13,3 % en 2009). Le taux de pauvreté en condition de vie, désignant les cas de privations matérielles sévères, est comparable dans les deux pays.
En Allemagne, la pauvreté monétaire a beaucoup augmenté ces dernières années alors qu’elle est restée stable en France.
La différence de taux de pauvreté semble imputable au système de protection sociale. En effet, les taux de pauvreté avant transferts socio-fiscaux sont légèrement plus élevés en France qu’en Allemagne (25,2 % contre 24,2 %).
Les situations sont contrastées selon les sous-populations. Même si les législations sur le salaire minimum diffèrent en France et en Allemagne (existence du Smic en France, absence de minimum interprofessionnel et existence d’emplois à rémunération horaire et temps de travail très faibles en Allemagne), la part de travailleurs pauvres est similaire en France et en Allemagne, autour de 6-7 %. En revanche, les constats sont différents pour les familles et les personnes sans emploi :
- En Allemagne, les enfants de moins de 18 ans sont un peu moins souvent touchés par la pauvreté, protégés par des allocations familiales forfaitaires d’un montant élevé et des minima sociaux qui augmentent rapidement avec le nombre d’enfants à charge.
- Les plus de 65 ans sont moins bien protégés de la pauvreté en Allemagne qu’en France : 14,1 % d’entre eux sont pauvres en Allemagne contre 10,6 % en France.
- Dans les deux pays, les chômeurs sont plus souvent confrontés à la pauvreté que les personnes en emploi et les retraités, notamment en Allemagne : 70,0 % d’entre eux sont pauvres contre 33,1 % en France. Les systèmes d’indemnisation du chômage (chapitre 8.2) et les minima sociaux (chapitre 5.2) peuvent être à l’origine de ces différences.
Dans les deux pays, il existe des minima sociaux constituant un filet de sécurité contre l’extrême pauvreté. Ils y jouent un rôle comparable : ils constituent un revenu minimum garanti pour l’ensemble des foyers sans ressources, en accordant une large part à la logique de droits et devoirs.
Dans les deux pays les minima sociaux sont différentiels et familialisés. Ils occupent un poids, en termes de population couverte ou de dépenses (un peu plus de 1 point de PIB), comparable dans les deux pays. Néanmoins :
- En Allemagne, le système est constitué de trois minima sociaux et repose sur deux logiques. Les personnes capables de travailler bénéficient d’un minimum social, mais doivent chercher activement un emploi et accepter les offres qui leur sont proposées. Les personnes incapables de travailler en raison de leur âge ou de leur invalidité relèvent d’un autre régime. La distinction entre ces deux groupes repose essentiellement sur l’obligation de recherche d’emploi, le montant servi étant le même.
- En France, le système est structuré autour de la composante socle du Revenu de Solidarité Active (RSA socle) et de huit minima sociaux destinés à des publics spécifiques.
Le RSA socle s’adresse à l’ensemble des personnes de plus de 25 ans. Il comprend à la fois des personnes soumises à l’obligation de rechercher un emploi et des personnes exemptées de cette obligation en raison de difficultés sociales.
Les autres minima sociaux sont divers, aussi bien sur les obligations de recherche d’emploi que sur les montants. Ceux à destination des personnes âgées (Allocation de solidarité aux personnes âgées - ASPA) ou handicapées (Allocation aux adultes handicapés - AAH) ne sont pas assortis d’obligation de recherche d’emploi et garantissent un niveau de revenu plus élevé que le RSA socle. L’Allocation spécifique de solidarité (ASS), à destination des chômeurs en fin de droits, est assortie d’une obligation de recherche d’emploi et est d’un montant comparable au RSA socle.
- Enfin, si le barème des minima sociaux est indexé sur l’inflation en France, les revalorisations des minima sociaux sont en Allemagne à la discrétion du Bundesrat.
Suite à un arrêt de la cour constitutionnelle allemande, un mécanisme automatique de revalorisation des prestations sociales en fonction de l’évolution des prix devrait être prochainement mis en place. "
6 - LE SYSTEME DE RETRAITES
" 1. Les systèmes de retraite français et allemand sont proches dans leurs principes, mais différents dans leur organisation.
En France comme en Allemagne, le système de retraite repose sur trois piliers : les retraites publiques (1er pilier), les régimes complémentaires d’entreprise (2ème pilier), et les dispositifs d’épargne retraite individuelle (3ème pilier), mais les retraites publiques en constituent le coeur. Cet équilibre pourrait évoluer, l’Allemagne ayant fait le choix de développer au début des années 2000 les retraites par capitalisation.
Dans les deux pays, les régimes de retraite publics sont d’inspiration bismarckienne : il s’agit de régimes de retraite obligatoires contributifs financés en répartition, principalement par des cotisations sociales assises sur les salaires, et qui relèvent d’une logique sectorielle.
Toutefois, le système de retraite allemand a une organisation plus simple : l’assurance légale, en points, est prédominante alors qu’en France le régime général coexiste avec de nombreux régimes, de base et complémentaires, en annuités ou en points, obéissant à des règles différentes.
Dans les deux pays, les pensions versées ont un lien avec les salaires perçus pendant la carrière, tout en intégrant divers mécanismes de solidarité (validation de droits pour maladie, maternité, chômage, minima de pensions).
En France comme en Allemagne, il existe deux concepts d’âge : un âge d’ouverture des droits à partir duquel un assuré peut liquider sa pension et un âge de référence à partir duquel un assuré peut liquider une pension sans pénalité. Ces bornes d’âge seront, après montée en charge des réformes en cours, plus élevées en Allemagne : l’âge d’ouverture des droits y
sera compris entre 63 et 67 ans et l’âge de référence y sera de 67 ans, tandis qu’en France, l’âge d’ouverture des droits sera de 62 ans et l’âge de référence sera compris entre 62 et 67 ans. Dans les deux pays, l’âge moyen de cessation d’activité est plus faible que ces âges légaux. Il est particulièrement bas en France (60 ans en 2009), mais proche de l’âge légal, ce qui suggère une transition quasi directe entre emploi et retraite ; il est plus élevé en Allemagne, (62 ans en 2009), mais plus éloigné des âges théoriques de liquidation.
2. Les systèmes de retraite assurent dans les deux pays un niveau de vie élevé et représentent un haut niveau de dépenses publiques.
La France et l’Allemagne consacrent une part élevée de leur richesse nationale aux dépenses de pensions (vieillesse-survie), mais la France une part plus importante : respectivement 13,6 % et 12,1 % en 2009, contre 11,7 % dans l’UE à 27. Cela traduit à la fois un niveau de pension plus généreux (le taux de remplacement est plus élevé en France) et une durée passée à la retraite plus élevée (liquidations plus précoces et espérance de vie plus élevée). Le « patrimoine retraite », somme actualisée des pensions de retraite, nettes de prélèvements, qu’un assuré peut espérer percevoir jusqu’à son décès, est ainsi 1,3 à 1,4 fois plus élevé en moyenne en France qu’en Allemagne pour une personne ayant effectué sa carrière au salaire moyen.
Au milieu des années 2000, le revenu moyen des personnes âgées de plus de 65 ans est comparable en France et en Allemagne, autour de 18 500 € par an. Il est, dans les deux pays, essentiellement composé de pensions de retraite, même si les revenus tirés du capital occupent une place deux fois plus importante, et croissante, en Allemagne.
En France comme en Allemagne, le niveau de vie des personnes âgées de plus de 65 ans (qui tient compte de l’ensemble des revenus, de la fiscalité et de la composition des ménages) est comparable à celui de l’ensemble de la population. Le taux de pauvreté des personnes âgées de plus de 65 ans est cependant plus élevé en Allemagne qu’en France.
L’indexation des pensions en France sur l’inflation garantit le maintien de leur pouvoir d’achat.
En Allemagne, la règle de revalorisation retenue n’apporte pas une telle garantie. Une clause de sauvegarde empêche toute baisse nominale des pensions, mais pas une baisse réelle. Dans les faits, les pensions allemandes ont, à plusieurs reprises ces dernières années, évolué moins rapidement que l’inflation.
3. France et Allemagne ont choisi d’apporter des réponses différentes aux défis posés par le vieillissement et la crise économique Les deux pays sont confrontés au vieillissement de leur population, du fait de l’arrivée à la retraite des générations du baby-boom et de l’allongement de l’espérance de vie. Toutefois, le défi démographique est plus important en Allemagne : si les espérances de vie sont proches dans les deux pays, la France bénéficie d’une natalité plus dynamique. La population allemande devrait diminuer sur les 50 ans à venir en raison d’un taux de fécondité et d’une immigration faibles, entraînant une forte dégradation du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités.
De façon plus conjoncturelle, les régimes de retraite des deux pays ont vu leur situation se dégrader suite à la crise économique de 2008 : les dépenses, exprimées en points de PIB ont augmenté ; les ressources, assises sur la masse salariale, ont baissé.
La France et l’Allemagne ont adopté des stratégies différentes pour répondre à l’enjeu posé par l’équilibre financier de leur système de retraite : réformes systémiques en Allemagne, avec la création d’un régime en point en 1992 et le développement des retraites individuelles privées depuis 2003 ; succession de réformes paramétriques en France depuis
1993.
Dans les deux pays, les trois leviers d’ajustement du système de retraite ont été mobilisés - apport de ressources, âge de liquidation et niveau des pensions -, tout en évitant de relever trop les cotisations sociales pour ne pas peser excessivement sur le coût du travail.
L’Allemagne a alterné mesures d’âge (en 1992 et 2007) et modération des pensions (2001 et 2004). En France, depuis la réforme de 1993 qui reposait largement sur le niveau des pensions et leur progression, les dernières réformes ont privilégié le recul de l’âge de liquidation (2003 et 2010).
Les deux pays ont connu de nombreuses réformes et ont tenté d’intégrer des facteurs d’ajustement automatique (intégration d’un facteur démographique dans la formule de revalorisation des pensions en Allemagne, indexation de la durée de référence sur les gains d’espérance de vie en France). L’Allemagne s’est dotée d’un cadre de pilotage de son
système de retraite en s’imposant des contraintes de taux de cotisation, de taux de remplacement et de niveau de réserves. "
7 - LES DISPOSITIFS D'EPARGNE RETRAITE
" L’Allemagne et la France ont fait le choix, au début des années 2000, de mettre en place des réformes visant à promouvoir l’épargne retraite, afin de compléter les pensions servies au titre des régimes de base.
1. Les dispositifs d’épargne retraite sont plus nombreux et apparaissent moins lisibles en France qu’en Allemagne.
En France, plusieurs dispositifs, aux régimes fiscalo-sociaux hétérogènes, coexistent. Si la réforme des retraites de 2003, en complétant l’offre existante par deux nouveaux produits (PERP et PERCO), tient compte de l’hétérogénéité des préférences, elle accentue l’effet d’empilement des dispositifs. Le système allemand, structuré autour d’un produit phare (le plan Riester), apparaît de ce point de vue plus lisible pour les souscripteurs.
2. Les systèmes de retraite par capitalisation sont plus développés en Allemagne qu’en France.
Les prestations issues de ces régimes y représentent 10 % des retraites contre 2 à 3 % en France. Cet écart s’explique principalement par la plus grande ancienneté des dispositifs mis en place au niveau des entreprises allemandes sous forme de « fonds de pension maison » pour compléter la retraite de leurs salariés.
L’analyse des données disponibles tend à montrer que l’Allemagne a atteint un taux de couverture supérieur à celui de la France (plus de la moitié de la population active est couverte en Allemagne contre environ 1/3 en France). En particulier, le nombre d’adhérents à des dispositifs individuels est plus de trois fois supérieur en Allemagne (14 millions de contrats
« Riester » à fin 2010 contre 4 millions de personnes équipées, tous produits individuels confondus, en France).
3. L’avantage fiscal associé à l’épargne retraite bénéficie à l’ensemble des épargnants en Allemagne, alors qu’il ne bénéficie qu’aux personnes imposables en France En Allemagne, l’avantage fiscal se traduit par une déduction du revenu imposable et une aide directe, sous forme de prime forfaitaire, dont peuvent bénéficier tous les souscripteurs. Si la déduction fiscale entraîne une réduction d’impôt supérieure à la prime, la différence est versée sous forme de crédit d’impôt. Le système est ainsi à la fois avantageux pour les classes moyennes et supérieures, grâce à la déduction fiscale, et pour les classes modestes –pas ou peu imposées- qui bénéficient d’une aide directe sous forme de prime. En France, seules les personnes imposables bénéficient, de fait, d’une réduction d’impôt sur le revenu.
4. Des dispositifs souvent détournés de leur objectif initial : dans les deux pays, l’épargne retraite peut servir à financer l’acquisition d’un logement. Mais seule la France autorise d’autres possibilités de sortie anticipée. Le déblocage des fonds épargnés pour l’achat d’un bien immobilier est possible dans les deux pays: de manière anticipée pour les plans Riester (formule Wohn-Riester) et le PERCO, au moment de la liquidation pour le PERP. En Allemagne, 490 000 personnes ont eu recours à la formule Wohn-Riester à fin 2010. En France, en 2009, sur 15 000 déblocages de PERCO, 60 % l’ont été de façon anticipée, pour un montant de 42 M€, essentiellement pour l’acquisition d’une résidence principale.
En revanche, toute autre possibilité de sortie anticipée est proscrite en Allemagne. En France, des sorties anticipées sont possibles en cas de surendettement, expiration des droits aux allocations chômage, invalidité, décès du conjoint. "
8 - LES POLITIQUES DE L'EMPLOI
" L’Allemagne est l’un des rares pays de l’OCDE où le taux de chômage a très peu augmenté durant la crise de 2008-2009 et a continué à refluer depuis. Ainsi en 2011, le taux de chômage était de 5,9 % en Allemagne contre 9,7 % en France (Eurostat). Le recours important à la rétention de main d’oeuvre (chômage partiel) et la réduction sensible de la durée du travail en Allemagne expliquent certainement pour beaucoup la bonne tenue de l’emploi à travers la crise. Pour autant, les politiques de l’emploi, et plus particulièrement les réformes du Service Public de l’Emploi (Hartz), ont contribué également à la décrue importante et continue du chômage allemand depuis 2005.
En proportion du PIB (et en excluant les allègements de charges sur les bas salaires), les dépenses allouées aux politiques de l’emploi étaient légèrement plus élevées en Allemagne qu’en France, en 2009. Si les dépenses actives80 représentent un volume équivalent, une part plus significative de celles-ci est allouée au service public de l’emploi en Allemagne quand la
France finance plus largement des emplois aidés.
Du côté des dépenses passives, le système français apparaît plus généreux. La grande majorité des indemnisés l’est au titre du régime d’assurance-chômage en France quand les demandeurs d’emploi allemands sortent plus rapidement de ce système pour basculer en nombre vers le régime de solidarité nationale.
En Allemagne, la durée d’indemnisation par l’assurance chômage est globalement deux fois moins longue et plafonnée à un niveau plus bas qu’en France. Ce choix s’est opéré au profit de moyens accrus alloués à l’accompagnement et au suivi des demandeurs d’emploi allemands. Cette stratégie de réallocation des moyens de l’indemnisation vers l’accompagnement semble payante en matière de chômage même si elle n’explique probablement qu’une partie de l’écart de l’évolution du taux de chômage entre les deux pays.
Par ailleurs, le choix, avec la réforme Hartz IV, d’un système d’assurance chômage moins généreux reporte une partie de l’effort vers la solidarité nationale. Celle-ci étant moins généreuse, en France comme en Allemagne, que l’assurance chômage, ceci contribue au développement de la précarité en Allemagne. (cf. Chapitre 5 pauvreté et minima sociaux).
Le mode de gouvernance diffère nettement entre les deux pays. En France, l’indemnisation et l’accompagnement relèvent de plusieurs donneurs d’ordre distincts : le régime d’assurancechômage, ie. l’Unedic, est sous la responsabilité des seuls partenaires sociaux, le régime de solidarité dépend de l’État et enfin, l’accompagnement revient à Pôle Emploi, qui est cogéré par l’État et les partenaires sociaux. Ainsi, la négociation de la convention paritaire de l’Unedic se fait indépendamment de celle tripartite de Pôle emploi.
À l’inverse, en Allemagne, l’Agence Fédérale pour l’Emploi (Bundesagentur für Arbeit), qui gère aussi bien l’indemnisation que l’accompagnement des demandeurs d’emploi, est cogérée par l’État et les partenaires sociaux. "
9 - LE CHOMAGE PARTIEL
" Le dispositif de chômage partiel permet aux entreprises rencontrant des difficultés en raison de la conjoncture économique ou de certains événements particuliers (difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistres ou intempéries exceptionnels, etc.) de réduire temporairement leur activité en diminuant les horaires de leurs salariés et leurs rémunérations, afin d’éviter les licenciements. Ce dispositif bénéficie d’une prise en charge partielle par l’État des allocations dont bénéficient les salariés sur leur temps chômé.
1. L’utilisation du chômage partiel pendant la crise apparaît plus massive en Allemagne qu’en France et a permis de mieux contenir la progression du taux de chômage.
• La part des salariés concernés par le dispositif était 6 fois supérieure en Allemagne qu’en France, avec 1,2 million de salariés concernés par le dispositif en Allemagne en 2009 (en moyenne annuelle) contre 0,2 million en France. Au pic de la crise (2e trimestre 2009), 1,5 million de salariés allemands étaient au chômage partiel, contre 250 000 salariés en France ;
• En dépit d’un choc conjoncturel plus prononcé en Allemagne qu’en France (recul du PIB en 2009 de -5,1 % en Allemagne contre -2,7 % en France), le taux de chômage allemand n’a augmenté que de +0,3 point en 2009 (passant à 7,8 %), contre +1,7 point en France (à 9,5 %).
2. L’utilisation relativement modeste du dispositif de chômage partiel en France peut être rattachée à des différences structurelles et institutionnelles.
• Le secteur industriel allemand, plus développé qu’en France, et la situation favorable des entreprises allemandes avant la crise expliquent en partie le recours massif au chômage partiel. Le secteur industriel est plus développé en Allemagne, avec une part de l’industrie dans l’emploi total de 22 % en Allemagne contre 14 % en France en 2007, dans un contexte global de diminution de l’emploi industriel. Or, ce sont les entreprises du secteur industriel qui ont principalement recours au chômage partiel. La bonne santé financière des entreprises allemandes avant la crise et l’existence de goulots d’étranglement sur la main d’oeuvre qualifiée ont également incité les employeurs allemands à recourir massivement
au chômage partiel pour garder leurs salariés en attendant la reprise ;
• Le recours au dispositif résulte nécessairement d’un accord collectif négocié avec les partenaires sociaux en Allemagne, alors qu’il résulte d’une décision unilatérale en France, avec simple consultation des partenaires sociaux. La spécificité du droit du travail allemand est qu’il place les partenaires sociaux au coeur de toute décision affectant les conditions de travail des salariés, ce qui permet une flexibilité « régulée et négociée » de l’organisation du temps de travail.
3. En Allemagne, le chômage partiel n’a été qu’un instrument parmi d’autres instruments de flexibilité interne
• Si la capacité de l’Allemagne à contenir le chômage pendant la crise doit beaucoup au dispositif de chômage partiel, d’autres mécanismes institutionnels sont intervenus. Ainsi, le chômage partiel n’explique que 25 % des 3,2 % de baisse des heures travaillées par tête en Allemagne entre 2008 et 2009. Le reste correspond à la diminution de la durée du travail à l’initiative des employeurs dans le cadre de conventions collectives existantes (23 %), à la réduction du volume des heures supplémentaires (21 %), à l’augmentation des temps partiels (17 %) et à l’utilisation des comptes épargne-temps
(14 %) ;
• Les entreprises allemandes ont ainsi utilisé prioritairement les outils de flexibilité interne dont elle disposait avant d’avoir recours au dispositif de chômage partiel, comme les comptes épargne-temps. En plus d’un cadre d’orientation générale apporté par la convention collective, il existe une véritable marge de manoeuvre aménagée au niveau de l’entreprise, au sein des comités d’entreprises (Betriebsrat), dont le rôle est prépondérant en Allemagne.
4. Le système d’indemnisation français paraît plus complexe que le système allemand • Le dispositif allemand traite l’allocation de chômage partiel comme une prestation sociale intégralement financée par l’assurance chômage, à la différence du système français dans lequel l’indemnité de chômage partiel n’est que partiellement remboursée à l’employeur par l’État, qui lui-même fait l’avance de la part financée par l’Unédic. En France et en Allemagne, la charge de trésorerie des allocations de chômage partiel pèse sur les employeurs ;
• L’indemnisation du chômage partiel est conforme en Allemagne aux règles d’indemnisation chômage classiques. À l’inverse, le système français d’indemnisation du chômage partiel apparaît plus complexe, tant pour le calcul de l’indemnisation que pour le partage des rôles entre financeurs (entreprises, État et Unédic) ;
• Les coûts supportés par l’employeur paraissent plus élevés en France, si l’on exclut les coûts résiduels et les compléments conventionnels, qui peuvent être relativement élevés en Allemagne. À l’exception du cas spécifique des salariés proches du SMIC, l’employeur français supporte un « reste à charge » plus important que son homologue allemand ;
• La complexité du dispositif français pourrait expliquer la plus faible utilisation du dispositif dans les petites entreprises en France.
5. Les salariés allemands et français ont globalement peu bénéficié de formations pendant leur période de chômage partiel
• Dans les deux pays, l’indemnisation du chômage partiel n’entraîne aucune obligation de formation, ni pour l’employeur ni pour le salarié. En outre, la période de chômage partiel est peu prévisible quant à son issue (reprise du travail à temps plein ou licenciement).
Or, les formations risquent d’entraver une augmentation du temps de travail en cas de reprise de l’activité, ce qui peut expliquer une certaine réticence à leur mise en place ;
• La période de chômage partiel n’a globalement pas été mise à profit pour accroitre la formation des salariés, que ce soit en France ou en Allemagne. En France, les raisons sont connues : le cadre juridique et la mise en oeuvre sont complexes du fait du cloisonnement entre les financements de la formation professionnelle. Mais, en Allemagne, où les incitations
à conjuguer chômage partiel et formation ont été renforcées pendant la crise, le même constat d’échec peut être fait : moins de 2 % des salariés en chômage partiel en 2009 suivaient une formation, et il s’agissait majoritairement de salariés qualifiés.
6. Le dispositif allemand a un coût important et un impact sur l’emploi à moyen terme incertain du fait des effets d’aubaine et de déplacement
• Le coût apparent apparaît plus élevé en Allemagne en raison de l’utilisation plus massive du dispositif : l’impact du dispositif de chômage partiel sur les finances publiques s’est élevé en 2009 à 4,6 Md€ en Allemagne contre 670 M€ en France, soit 7 fois plus en Allemagne qu’en France ;
• Le coût-efficacité du dispositif peut être limité par l’effet d’aubaine, qui intervient lorsque les subventions versées au titre du chômage partiel concernent des emplois que l’employeur aurait conservé même en l’absence d’aide. On ne dispose pas d’estimation robuste de cet effet ;
• Les effets en termes de préservation durable de l’emploi sont difficiles à appréhender à ce stade. En effet, le maintien du dispositif en Allemagne, alors que l’activité a redémarré, pourrait affaiblir le redéploiement de l’emploi à moyen terme du fait du maintien d’emplois non viables (effet de déplacement).
Pour celles et ceux qui voudraient en savoir encore plus : https://www.tresor.economie.gouv.fr/File/374396
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
La protection sociale. Comparaison France / Allemagne
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers Informations et analyses globales et comparatives
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- La pauvreté Comparaison France / Allemagne.
par pierre » Mar 18 Déc 2012 22:14 - 0 Réponses
- 1516 Vus
- Dernier message par pierre

Mar 18 Déc 2012 22:14
- La pauvreté Comparaison France / Allemagne.
-
- " Temps partiel et partage du travail : comparaison France / Allemagne " - Une étude de la Direction du Trésor
par causonsen » Mer 28 Jan 2015 21:26 - 0 Réponses
- 1392 Vus
- Dernier message par causonsen

Mer 28 Jan 2015 21:26
- " Temps partiel et partage du travail : comparaison France / Allemagne " - Une étude de la Direction du Trésor
-
- France / Allemagne 2014 - Un comparatif par Natixis
par causonsen » Lun 09 Juin 2014 12:59 - 0 Réponses
- 1657 Vus
- Dernier message par causonsen

Lun 09 Juin 2014 12:59
- France / Allemagne 2014 - Un comparatif par Natixis
-
- L’attractivité de Paris Ile-de-France pour les investissements internationaux rebondit
par voxpop » Lun 10 Fév 2014 17:56 - 0 Réponses
- 1300 Vus
- Dernier message par voxpop

Lun 10 Fév 2014 17:56
- L’attractivité de Paris Ile-de-France pour les investissements internationaux rebondit
-
- " What's the matter with France ", par Paul Krugman (The New York Times)
par causonsen » Jeu 28 Aoû 2014 16:21 - 0 Réponses
- 1543 Vus
- Dernier message par causonsen

Jeu 28 Aoû 2014 16:21
- " What's the matter with France ", par Paul Krugman (The New York Times)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité