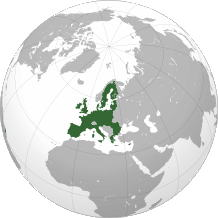Les réformes Hartz ne sont pas un modèle pour l’Europe selon le CER
Au début des années 2000, l’Allemagne était « l’homme malade de l’Europe » avec un taux de chômage de plus de 11%. Aujourd’hui celui-ci se situe à 3,9% et l’économie allemande est unanimement considérée comme un modèle de réussite. Dans la mythologie de l’économie orthodoxe, cette évolution est entièrement attribuée aux lois « Hartz » du gouvernement Schroeder de 2005. On considère que l’Allemagne a fait « les réformes nécessaires » pour assouplir son marché du travail et a été récompensée par la croissance et le plein emploi. Les détracteurs de ces réformes (qui sont très minoritaires dans les milieux politiques et patronaux en Allemagne) attribuent de leur côté le niveau élevé de pauvreté et de précarité en Allemagne aux effets de ces lois.
Déjà en 2014, une étude du Center for Economic Policy Research menée par quatre économistes allemands avait mis fortement en doute ce discours économique de cause à effet citée avec beaucoup de ferveur évangélique tant par les partisans que les détracteurs de ces lois ( CEPR = un réseau de 700 chercheurs basés dans 237 établissements universitaires dans 28 pays, principalement en Europe ; voir l’étude sur son « portail politique » http://voxeu.org/columns/topics ).
Le 20 juillet 2017 une nouvelle étude publiée par le Center for European Reform, signée par l’économiste Christian Odendahl, vient renforcer ces doutes ( CER = un laboratoire d’idées basé à Londres ; http://www.cer.eu/publications/archive/bulletin-article/2017/hartz-myth-drawing-lessons-germany ). Il considère que « les réformes Hartz ne constituaient pas un remède miracle. Plutôt que de les copier, le reste de l’Europe devrait tirer des leçons plus nuancées de l’expérience allemande ». Il poursuit : « L’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, qui s’est juré de restructurer le marché du travail en France, permettra de tester la validité de ce discours économique orthodoxe. S’il s’avère être faux, il se peut que le Président ne puisse pas tenir sa promesse de créer croissance et emploi, ouvrant ainsi la voie aux populismes de droite ou de gauche. »
Pour Odendahl, les réformes Hartz ne sont la cause principale ni de la réussite allemande, ni du fait que ce pays possède un des segments de bas salaires le plus important d’Europe.
Pour lui, quatre facteurs expliquent l’évolution économique de l’Allemagne à partir du milieu des années 2000 :
• Après le boom qui a suivi la réunification, le secteur allemand de la construction est entré dans un déclin prolongé. Entre 1994 et 2005, ce secteur est tombé de 8% à 4% du PIB, pesant ainsi sur la croissance économique. Par coïncidence il a entamé une nouvelle phase de montée juste au moment où les réformes Hartz sont entrées en vigueur. Son redémarrage a exercé un puissant effet bénéfique.
• Au moment de la mise en place des lois Hartz, les entreprises allemandes avaient déjà presque terminé une restructuration de plusieurs années pour s’adapter à la mondialisation en modifiant leurs pratiques de gestion et en délocalisant une partie de leur production vers des fournisseurs en Allemagne ou à l’étranger, notamment en Europe centrale et orientale. Cette transformation, qui a joué un rôle important dans la réussite allemande plus particulièrement en réduisant les coûts, a eu lieu indépendamment des réformes Hartz.
• A partir du milieu des années 1990, les représentants des salariés en Allemagne ont été d’accord pour limiter la croissance des salaires, aidant ainsi les entreprises allemandes à s’adapter à un niveau plus élevé de concurrence internationale et à préserver l’emploi. On peut dire que les réformes Hartz ont donné un tour de vis supplémentaire à ce mouvement de limitation salariale, mais la plus grande partie de cette évolution a eu lieu auparavant.
• Enfin le boom de l’économie mondiale tiré par les marchés émergents a été le moteur de la réussite allemande à l’exportation après 2004.
Pour l’auteur de l’étude, l’impact économique des lois Hartz a donc été relativement modeste par rapport aux effets qu’on leur prête habituellement. Mais quelles sont les leçons à tirer de l’expérience allemande pour le reste de l’Europe ?
D’abord, il faut tenir compte du contexte économique en choisissant le bon moment pour lancer des réformes. En réalité, ceci n’a pas été fait en Allemagne et le pays a eu beaucoup de chance de se trouver une fois les réformes faites au milieu des années 2000 dans une conjoncture mondiale favorable pour ses exportations. Actuellement avec le ralentissement en Chine et les incertitudes concernant la situation économique et politique américaine, le contexte s’annonce plus difficile. Des réformes importantes du marché du travail entreprises ailleurs en Europe dans ce contexte doivent donc être accompagnées d’une politique macroéconomique expansionniste.
Plutôt que de tenter de réformer profondément l’ensemble du marché du travail dans un contexte incertain comme l’a fait l’Allemagne, l’auteur préconise de se focaliser dans un premier temps sur les encouragements à l’investissement, la formation et l’allègement des prélèvements sociaux. Une fois l’économie relancée une dérégulation plus générale peut être entreprise.
Même si la limitation des salaires consentie par les représentants des salariés allemands a joué un rôle non négligeable dans l’adaptation de l’économie allemande à la mondialisation, l’auteur considère que les syndicats doivent aussi être assez forts pour exiger des hausses de salaires quand le contexte le justifie.
---
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Les réformes HARTZ ne sont pas un modèle pour l'Europe
2 messages
• Page 1 sur 1
Re: Les réformes HARTZ ne sont pas un modèle pour l'Europe
Extrait d'un entretien avec l'économiste allemand non-orthodoxe Wolfgang Streek (Médiapart du mardi 9 août 2017 ; il répond à la question de savoir si les réformes Hartz ont un rapport avec la réussite économique allemande) :
"Non, c’est une stupidité absolue que de le croire. C’est une invention des élites d’autres pays, françaises et italiennes en particulier. L’Allemagne irait bien aujourd'hui parce qu’elle a réussi à mener ces réformes il y a douze ans… On diffuse ce mythe afin de favoriser les réformes de libéralisation du marché du travail type Macron ou Renzi. C’est un mensonge complet.
Notre prospérité dépend en réalité des grandes entreprises de métallurgie. Or pas un ouvrier de ces entreprises ne connaît un niveau de salaire qui aurait été affecté par les réformes Hartz : leur rémunération reste très élevée ! Les réformes Hartz étaient une opération budgétaire : il s'agissait d'économiser sur l’assistance sociale et sur les indemnités chômage. Elles ne touchaient pas au marché du travail – à l’exception d’une petite mesure, celle sur le travail intérimaire qui a permis à des salariés se retrouvant au chômage technique d’aller travailler dans une autre entreprise. Ces réformes n'avaient rien à voir avec la sécurité de l’emploi ou la facilitation des licenciements".
"Non, c’est une stupidité absolue que de le croire. C’est une invention des élites d’autres pays, françaises et italiennes en particulier. L’Allemagne irait bien aujourd'hui parce qu’elle a réussi à mener ces réformes il y a douze ans… On diffuse ce mythe afin de favoriser les réformes de libéralisation du marché du travail type Macron ou Renzi. C’est un mensonge complet.
Notre prospérité dépend en réalité des grandes entreprises de métallurgie. Or pas un ouvrier de ces entreprises ne connaît un niveau de salaire qui aurait été affecté par les réformes Hartz : leur rémunération reste très élevée ! Les réformes Hartz étaient une opération budgétaire : il s'agissait d'économiser sur l’assistance sociale et sur les indemnités chômage. Elles ne touchaient pas au marché du travail – à l’exception d’une petite mesure, celle sur le travail intérimaire qui a permis à des salariés se retrouvant au chômage technique d’aller travailler dans une autre entreprise. Ces réformes n'avaient rien à voir avec la sécurité de l’emploi ou la facilitation des licenciements".
- slaïgo
- Messages: 8
- Enregistré le: Sam 02 Jan 2016 19:44
2 messages
• Page 1 sur 1
Retourner vers Analyses et informations
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- L'organisation de la sécurité en Europe
par gerald » Jeu 26 Nov 2015 20:02 - 1 Réponses
- 2504 Vus
- Dernier message par rousski

Ven 18 Déc 2015 19:31
- L'organisation de la sécurité en Europe
-
- Europe's economic suicide
par gerald » Lun 23 Avr 2012 15:58 - 2 Réponses
- 1565 Vus
- Dernier message par voxpop

Jeu 26 Avr 2012 11:36
- Europe's economic suicide
-
- Appel de Denis MacShane à un sursaut de l'Europe
par pierre » Mer 30 Nov 2016 20:52 - 0 Réponses
- 2295 Vus
- Dernier message par pierre

Mer 30 Nov 2016 20:52
- Appel de Denis MacShane à un sursaut de l'Europe
-
- Rapport Oxfam: inégalités et pauvreté en Europe
par gerald » Jeu 10 Sep 2015 10:35 - 0 Réponses
- 1432 Vus
- Dernier message par gerald

Jeu 10 Sep 2015 10:35
- Rapport Oxfam: inégalités et pauvreté en Europe
-
- La Lettre d'amour à l'Europe d'Emmanuel Grand
par gerald » Dim 30 Avr 2017 19:43 - 0 Réponses
- 2422 Vus
- Dernier message par gerald

Dim 30 Avr 2017 19:43
- La Lettre d'amour à l'Europe d'Emmanuel Grand
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité