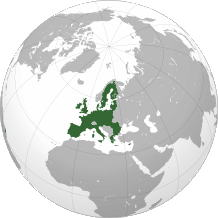Karine Berger, pour le PS, voit le TSCG en rose.
Sous le titre « Il faut voter le traité budgétaire européen », Karine Berger, économiste et membre du conseil national du PS, nous livre, dans Le Monde du 20 septembre, sa contribution au débat entre les partisans et les opposants au TSCG.
Disons tout de suite que l’on reste sur sa faim pour ce qui concerne l’argumentaire technique, qui se résume à quelques affirmations hasardeuses : « La sortie d’un seul pays (…) signerait la fin définitive de l’Union économique et monétaire. (…) L’euro n’a pas été inventé pour des raisons économiques. Il a été mis en place pour que des peuples cessent de s’entretuer. »
L‘argumentaire politique, quant à lui, se résume à souligner qu’un vote négatif mettrait François Hollande en position de faiblesse : « Qui peut imaginer qu’il serait encore en mesure de peser (…) à la table européenne (…) si, dans sa propre majorité, quelques voix lui faisaient défaut », et ceci quelques mois après que François Hollande ait pris, pendant la campagne présidentielle, une position ferme à l’encontre du traité. On ne voit pas bien ce qui autorise l’auteure à considérer que, grâce aux avancées qui auraient été arrachées en contrepartie de la composante budgétaire du traité, « l’union monétaire va (…) réaliser pour la première fois depuis 1954 une véritable politique keynésienne commune ». Se décider à dépenser des fonds structurels déjà budgétés, et dont on peut se demander pourquoi ils dormaient d’un aussi bon sommeil, ne traduit pas un grand volontarisme.
Demande-t-on au Parlement un vote de confiance à François Hollande ou un véritable débat sur une nouvelle étape de la construction / déconstruction européenne ?
Karine Berger : « ne comprend pas ce que veulent les partisans de l’abstention ou du vote contre le traité budgétaire ».
Nous allons tenter de le lui expliquer.
Le premier motif de rejet est que ce traité est superfétatoire, car il n’ajoute pas grand-chose aux dispositions préexistantes. La « règle d’or » date du traité de Maastricht. Une limitation du déficit budgétaire public à 3 % du PIB y figure explicitement, parmi les « critères de convergence » à respecter par les membres de la zone Euro. Faut-il rappeler que les traités européens ont force de loi dans les pays membres ? Le traité de Maastricht a été signé en février 1992. Ratifié par référendum en France en septembre 1992, il est entré en vigueur le 1er novembre 1993.
Le dispositif instauré a été ensuite affiné, en deux étapes principales :
- le pacte de stabilité et de croissance adopté par le Conseil européen à Amsterdam en juin 1997, qui a prévu une harmonisation des modes de calcul de la dette et du déficit publics et mis en place des procédures d’échange d’informations et d’avis sur les politiques économiques et les finances publiques des Etats membres
- le pacte de 2005, qui a assoupli les règles d’application des critères de Maastricht en permettant la prise en compte de contraintes conjoncturelles (récession par exemple) ainsi que le traitement différencié de certaines dépenses d’investissement ou exceptionnelles.
En somme, à peu près tout ce que l’on retrouve dans le TSCG.
Le second motif est qu’il ne sera pas plus appliqué que ne l’ont été les clauses budgétaires du traité de Maastricht et pour les mêmes raisons : clauses ambiguës (préparons-nous à des débats sans fin sur les notions de « déficit structurel, variations conjoncturelles, dépenses exceptionnelles, mesures ponctuelles et temporaires … ») , mesures coercitives inapplicables pour des raisons à la fois techniques (on ne tond pas un œuf) et politiques. Le fait que l’Allemagne, qui y trouvait à l’époque son intérêt, ait été, en 2005, un ardent promoteur des assouplissements aux règles du traité de Maastricht, nous offre une belle illustration du caractère contingent des grands principes …
Il y aura de la discipline budgétaire, bien sûr, mais elle résultera plus de la soumission de nos gouvernants à la pression des « marchés » et d’un retour à la raison de certains gestionnaires publics, que de ce nouveau traité européen. Pour la France, le projet de loi organique relative au pilotage des finances publiques pourrait se suffire à lui-même, avec l’avantage d’un vrai débat parlementaire, qui permettrait, pour reprendre une formule de Jacques Attali d’aller vers « un Etat fort, juste et efficace ; ce qui ne veut pas dire un Etat obèse ».
Le troisième, et principal, motif est que, dans ce contexte, le résultat essentiel du TSCG va être de donner une impulsion supplémentaire à la dérive technocratique et à la préséance de la finance au sein de l’Union européenne. C’est donc peu dire que nous ne partageons pas l’avis de Karine Berger lorsqu’elle déclare : « Sans lui (le traité et donc François Hollande), la Grèce, le Portugal et d’autres seront mis peu à peu de côté, abandonnés à la gestion de quelques « troïkas » désincarnées. ».
Comment ne pas voir que, avec le traité et avec le MES, l’Europe reconstitue les méthodes, et jusqu’au vocabulaire, du couple Banque mondiale / FMI et de ses « réformes et ajustements structurels » (dans le TSCG, on parle aussi de « meilleures pratiques », cela sonne mieux) ?
Le traité prétend préserver le rôle des institutions démocratiques et sociales, mais cela relève de la mascarade.
L’article 12 mérite d’être cité : « Les chefs d'État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l'euro se réunissent de manière informelle lors de sommets de la zone euro auxquels participe également le président de la Commission européenne. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer à ces réunions. (…) Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu. » Chaque mot compte ici : les règles de préséance et les pouvoirs respectifs sont clairs : l’un « participe », l’autre est « invité à participer » et le dernier (le seul qui ait une légitimité démocratique) « peut être invité à être entendu ».
Les mécanisme de correction répondent à des « principes communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature, l'ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre », mais on nous assure qu’ils « respectent pleinement les prérogatives des parlements nationaux » (ne pas rire).
Il y a, nous dit-on, « nécessité de respecter (…) le rôle spécifique des partenaires sociaux ». Ils n’ont pourtant, à ce stade, guère été respectés. Que l’on en juge : les syndicats de salariés se sont opposés en masse au traité et Bernadette Ségol, secrétaire générale de la Confédération européenne des syndicats (CES) a déclaré : « Ce Traité rassure peut-être les amis politiques de la Chancelière Merkel, mais sûrement pas les millions de chômeurs, de travailleurs pauvres et précaires en Europe, qui attendent en vain un véritable soutien de la part des institutions européennes. C’est pourquoi nous y sommes opposés ». Déclaration à laquelle il faut d’autant plus porter attention que c’est la première fois que la CES s’oppose à un traité européen. Sans doute la coupe est-elle pleine. Qu’en pense le PS, qui se déclare partisan du dialogue social ?
Cela n’empêche pas les attendus du traité de mettre en avant « la réalisation des objectifs de l'Union européenne en matière (…) de cohésion sociale. » Pourquoi se priver ?
Au chapitre des institutions, notons au passage le rôle dévolu à la Cour de justice européenne pour « infliger » des sanctions et l’apparition d’un mécanisme de délation par les bons élèves à l’encontre des mauvais qui, s’il fonctionne, devrait contribuer à maintenir une sympathique ambiance au sein de l’Union. Il fallait auparavant une majorité qualifiée au sein de la zone euro pour adopter des sanctions ; il faudra désormais une majorité qualifiée (non compris le pays délinquant) pour s’opposer à la Commission en la matière.
On nous dit que ce traité serait une nouvelle illustration de la politique des « petits pas », qui aurait si bien réussi à l’Union européenne. Jusqu’aux années 70 peut-être. Depuis que l’Union s’est convertie au dogme ultralibéral, au point d’en devenir le meilleur disciple, il est permis d’en douter. A chaque étape, il s’agit d’avaler quelques couleuvres au bénéfice de lendemains qui chantent. Il vient un moment où il faut dire stop. Les petits pas, c’est bien, sauf s’ils vous enfoncent dans la vase.
L’Union européenne a mieux à faire et à proposer aux peuples qui la composent que ce traité qui n’ouvre aucune perspective nouvelle, se contentant de rabâcher et consacrer le discours sur la croissance et la compétitivité. Une croissance dans laquelle tout compte, le pire et le meilleur, pourvu que cela se vende. Une course à la compétitivité dans laquelle tout le monde veut être le gagnant à l’export, avec comme résultat un développement ubuesque des échanges et transports internationaux (des salades de fruits frais « made in China » dans les supermarchés québécois et du granit des Indes pour rebâtir la place de la Cathédrale à Tréguier, en Bretagne …). Croître plutôt que prospérer, concurrencer plutôt que coopérer. Soumission à un capitalisme paroxystique, libéré de toute entrave, livré aux frasques et soubresauts des « marchés ».
Déjà passablement diminuée sur la scène internationale, l’Union affiche sa division, jusques et y compris au sein des institutions supposées orchestrer la mise en œuvre du nouveau traité. N’apprend-on pas que « la Commission européenne sera la première à porter plainte (devant la Cour européenne de justice !) contre la BCE si celle-ci transgresse son mandat » (Le Monde du 18 septembre 2012). Plutôt que d’envisager de porter plainte contre une banque centrale, nos dirigeants feraient mieux de se ressaisir du pouvoir monétaire, qu’ils n’auraient jamais du abandonner. Après l’abdication, le ridicule …
Les objectifs ambitieux du traité de Lisbonne en matière de politique environnementale, énergétique, de transport … sont restés lettre morte. La Chine supplante l’Europe en Afrique. « L’Europe, désargentée, peine à peser sur les suites du printemps arabe » (Le Monde du 20 septembre 2012), … Les inégalités s’accroissent, avec leur cortège de drames sociaux mais aussi d’inertie économique. Les émirats arabes, Qatar en tête, viennent au secours de nos banlieues déshéritées … Pendant que Karine Berger nous parle de « politique keynésienne commune pour l’Europe », celle-ci s’apprête à geler son budget pour les années à venir (1 % du PIB de l’Union à ce jour, soit environ 20 fois moins que le poids de l’état fédéral aux USA).
La « crise » est une épreuve, mais elle est aussi l’occasion de s’affranchir de ce rase-mottes politique et de remettre en ordre les objectifs et les pouvoirs : une finance servante de l’économie et non le contraire ; une économie en harmonie avec des objectifs sociaux ; un pouvoir politique pour contrôler le tout.
« Le vote du traité budgétaire européen témoignera de notre capacité à faire preuve d’un minimum de pragmatisme » nous dit Karine Berger. Non : d’un excès de pragmatisme et d’un déficit d’ambition et de courage, car le TSCG n’est qu’un témoignage supplémentaire de l’effarant contraste entre les prétentions verbales de l’Europe au progrès social, environnemental, démocratique et la réalité des mesures prises.
» Pour vous inscrire : Inscription » Si vous êtes déjà inscrit : Connexion » Pour nous contacter : Contact
Avec le TSCG, l’Union européenne se répète et s’enlise
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retourner vers Notes du portail
-
- { RELATED_TOPICS }
- Réponses
- Vus
- Dernier message
-
- Les propositions de Pierre Moscovici sur l'Union européenne
par voxpop » Mer 30 Oct 2013 00:05 - 6 Réponses
- 3776 Vus
- Dernier message par Oufti

Ven 09 Oct 2015 21:39
- Les propositions de Pierre Moscovici sur l'Union européenne
-
- L'union bancaire ou l’Europe par le petit bout de la lorgnette
1, 2par scripta manent » Jeu 28 Juin 2012 16:44 - 15 Réponses
- 6853 Vus
- Dernier message par voxpop

Mar 11 Nov 2014 21:14
- L'union bancaire ou l’Europe par le petit bout de la lorgnette
-
- QDQ - L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
1, 2par scripta manent » Ven 06 Avr 2012 17:27 - 14 Réponses
- 7428 Vus
- Dernier message par Oufti

Dim 14 Mai 2017 15:02
- QDQ - L’Initiative citoyenne européenne, un os à ronger
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité